 Hier soir, à 22h30, j’entends les voix des filles monter depuis le jardin qu’éclairent faiblement des lampions de couleur. Elles ont obtenu de leur père qu’il consente à aller chercher dans une pièce, rangée comme un inventaire à la Prévert, l’une de nos trois tentes. La première tente, verte, nous a servis pour la partie sud-américaine et nord-américaine de notre tour du monde. La toute première fois que nous l’avons dépliée, c’était sur une butte dans le Puy-de-Dôme. Nous étions partis marcher un week-end depuis la Loire où j’avais rejoint Stéphane après notre mariage. Nous avions marché de longues heures avec notre maison sur le dos et tout notre matériel. Il fallait commencer à nous tester dans les conditions de vie qui seraient les nôtres pendant de longs mois. Nous avions dîné face à un coucher de soleil magnifique mais le vent était glacial et je me rappelle que nous n’avions pas eu très chaud dans la nuit. Une fine pellicule de givre pailletait l’intérieur de la tente. Nous en deviendrions coutumiers lors des nuits passées dans la Cordillère des Andes et dans l’Himalaya.
Hier soir, à 22h30, j’entends les voix des filles monter depuis le jardin qu’éclairent faiblement des lampions de couleur. Elles ont obtenu de leur père qu’il consente à aller chercher dans une pièce, rangée comme un inventaire à la Prévert, l’une de nos trois tentes. La première tente, verte, nous a servis pour la partie sud-américaine et nord-américaine de notre tour du monde. La toute première fois que nous l’avons dépliée, c’était sur une butte dans le Puy-de-Dôme. Nous étions partis marcher un week-end depuis la Loire où j’avais rejoint Stéphane après notre mariage. Nous avions marché de longues heures avec notre maison sur le dos et tout notre matériel. Il fallait commencer à nous tester dans les conditions de vie qui seraient les nôtres pendant de longs mois. Nous avions dîné face à un coucher de soleil magnifique mais le vent était glacial et je me rappelle que nous n’avions pas eu très chaud dans la nuit. Une fine pellicule de givre pailletait l’intérieur de la tente. Nous en deviendrions coutumiers lors des nuits passées dans la Cordillère des Andes et dans l’Himalaya.
 La deuxième tente, jaune, est une tente Northface conçue pour les expéditions en haute-montagne. Sa toile est assez résistante pour supporter de violentes rafales de vent. C’est sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, sur une plage, face au Pacifique, non loin d’un restaurant, que nous y avons dormi la toute première fois. Nous n’avions pas prévu de marches en montagne mais cette tente est grande, incroyablement fonctionnelle avec toutes ses poches latérales et nous la transportions dans les sacoches accrochées sur nos vélos. Une jolie surprise nous attendait cette nuit-là. Alors que nous nous étions endormis sous un ciel magnifiquement étoilé, nous avons été tirés de notre sommeil profond (les heures de vélo quand on est chargés comme des baudets-surtout moi qui porte un bout de prénom qui doit prédestiner à ce genre d’exercice-permettent de trouver facilement la voie de l’endormissement) par un orage violent et une pluie diluvienne. L’eau frappait furieusement sur le toit de la tente et, assez vite, elle s’est infiltrée par les coutures. Nous n’avions pas lu toute la notice. Il convenait de les étancher avant utilisation. Dès le lendemain, Stéphane a acheté du silicone et en a enduit toutes les coutures qui sont devenues noires.
La deuxième tente, jaune, est une tente Northface conçue pour les expéditions en haute-montagne. Sa toile est assez résistante pour supporter de violentes rafales de vent. C’est sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, sur une plage, face au Pacifique, non loin d’un restaurant, que nous y avons dormi la toute première fois. Nous n’avions pas prévu de marches en montagne mais cette tente est grande, incroyablement fonctionnelle avec toutes ses poches latérales et nous la transportions dans les sacoches accrochées sur nos vélos. Une jolie surprise nous attendait cette nuit-là. Alors que nous nous étions endormis sous un ciel magnifiquement étoilé, nous avons été tirés de notre sommeil profond (les heures de vélo quand on est chargés comme des baudets-surtout moi qui porte un bout de prénom qui doit prédestiner à ce genre d’exercice-permettent de trouver facilement la voie de l’endormissement) par un orage violent et une pluie diluvienne. L’eau frappait furieusement sur le toit de la tente et, assez vite, elle s’est infiltrée par les coutures. Nous n’avions pas lu toute la notice. Il convenait de les étancher avant utilisation. Dès le lendemain, Stéphane a acheté du silicone et en a enduit toutes les coutures qui sont devenues noires.
 La troisième tente, bleue, a été achetée voici trois ans en vue de nos sorties en pleine nature avec les enfants. Elle a été très employée par les filles et leurs amies qui y ont souvent dormi l’été quand, tandis que nous travaillions, notre maison se transformait en colonie ! A l’époque, les filles n’avaient pas encore de téléphone portable. Elles transportaient la moitié de leur bibliothèque dans la tente ainsi qu’un nombre incalculables de coussins et de peluches. C’est dans cette tente que, par une nuit polaire, nous avons tous dormi l’année dernière, en février, avant que Stéphane ne parte traverser un bout du lac Baïkal. Depuis quelques mois, elle est en Balagne, à Lumio, petit village en pierres accroché à la montagne et surplombant la baie de Calvi. L’été passé, nous l’avons plantée dans un camping, au bord de la Restonica, avant de partir à l’assaut du lac de Melo. Cette nuit-là fut une nuit aussi étoilée que blanche. Quand notre matelas ne se dégonflait pas, des Italiens faisaient claquer les portes de leur voiture et des Allemands refaisaient le monde entre deux éclats de rire. Je m’amusais de sentir monter, heure par heure, l’exaspération de Stéphane ponctuée par les battements de queue de notre Fantôme, notre berger australien, notre quatrième enfant qui était attaché à une corde. C’est dans un état de délabrement très avancé que nous avions réussi à gagner le lac de Melo.
La troisième tente, bleue, a été achetée voici trois ans en vue de nos sorties en pleine nature avec les enfants. Elle a été très employée par les filles et leurs amies qui y ont souvent dormi l’été quand, tandis que nous travaillions, notre maison se transformait en colonie ! A l’époque, les filles n’avaient pas encore de téléphone portable. Elles transportaient la moitié de leur bibliothèque dans la tente ainsi qu’un nombre incalculables de coussins et de peluches. C’est dans cette tente que, par une nuit polaire, nous avons tous dormi l’année dernière, en février, avant que Stéphane ne parte traverser un bout du lac Baïkal. Depuis quelques mois, elle est en Balagne, à Lumio, petit village en pierres accroché à la montagne et surplombant la baie de Calvi. L’été passé, nous l’avons plantée dans un camping, au bord de la Restonica, avant de partir à l’assaut du lac de Melo. Cette nuit-là fut une nuit aussi étoilée que blanche. Quand notre matelas ne se dégonflait pas, des Italiens faisaient claquer les portes de leur voiture et des Allemands refaisaient le monde entre deux éclats de rire. Je m’amusais de sentir monter, heure par heure, l’exaspération de Stéphane ponctuée par les battements de queue de notre Fantôme, notre berger australien, notre quatrième enfant qui était attaché à une corde. C’est dans un état de délabrement très avancé que nous avions réussi à gagner le lac de Melo.
 Pour nos enfants, pas de premiers signes de printemps sans tente déployée dans le jardin. Le lavage de la piscine par le trio ne devrait pas tarder. De mon côté, j’attends le moment où notre épouvantable voisine me hélera de derrière la haie pour me sommer de procéder à son entretien et me jettera tout à trac au visage les articles 668 et suivants du Code civil. Nous n’avons vraiment pas une chance : notre voisine est LA personne la plus odieuse de tout le village. Sa méchanceté est légendaire. On ne compte plus le nombre de personnes qu’elle a fait pleurer. C’est une femme aigrie qui se plait à déverser sa bile sur les gens de préférence gentils. Après qu’elle m’ait à plusieurs reprises insultée de manière très grossière, je lui ai dit que je ne lui adresserai plus jamais la parole et ne répondrai plus à ses questions. Comme elle est au nombre de ces êtres sanguins qui vous agonisent d’injures, ne s’en excusent jamais et, quelques jours plus tard, vous sourient comme si rien ne s’était passé, je ne suis pas certaine qu’elle se le rappellera.
Pour nos enfants, pas de premiers signes de printemps sans tente déployée dans le jardin. Le lavage de la piscine par le trio ne devrait pas tarder. De mon côté, j’attends le moment où notre épouvantable voisine me hélera de derrière la haie pour me sommer de procéder à son entretien et me jettera tout à trac au visage les articles 668 et suivants du Code civil. Nous n’avons vraiment pas une chance : notre voisine est LA personne la plus odieuse de tout le village. Sa méchanceté est légendaire. On ne compte plus le nombre de personnes qu’elle a fait pleurer. C’est une femme aigrie qui se plait à déverser sa bile sur les gens de préférence gentils. Après qu’elle m’ait à plusieurs reprises insultée de manière très grossière, je lui ai dit que je ne lui adresserai plus jamais la parole et ne répondrai plus à ses questions. Comme elle est au nombre de ces êtres sanguins qui vous agonisent d’injures, ne s’en excusent jamais et, quelques jours plus tard, vous sourient comme si rien ne s’était passé, je ne suis pas certaine qu’elle se le rappellera.
 Dans une autre vie, je travaillais en qualité de consultante au Comité directeur pour la bioéthique au Conseil de l’Europe. J’étais étudiante en thèse et vacataire d’enseignement à l’Université. Toutes les semaines, mes cours dispensés, je me rendais à la gare de l’Est et prenais place dans un TGV dont je descendais en gare de Strasbourg. La mère d’un amoureux d’une amie d’enfance dont le fils aîné était mort dans des conditions très douloureuses quelques mois auparavant avait la gentillesse de m’y accueillir et de m’héberger. J’ai beaucoup appris au contact d’Andrée, une femme brillante, engagée, musicienne, très sportive, qui, à l’époque, dirigeait le plus important cabinet de radiologie de la ville. Andrée est la première personne à m’avoir invitée à m’écouter davantage, à être à l’écoute de mes désirs profonds, à apprendre à me considérer comme une « priorité ». Andrée a semé des graines précieuses. Josette, mon ancien professeur de philosophie et Catherine, mon ancien directeur de thèse, sont désormais les deux personnes qui, régulièrement, me rappellent de faire lever les graines semées à Strasbourg. Si je reviens sur ce petit bout de mon histoire, c’est qu’un soir, je parlais à Andrée d’un livre que venaient de publier deux psychiatres qui, à l’époque, avaient mes faveurs : François Lelord et Christophe André. Ce livre s’intitulait « Comment gérer les personnalités difficiles ? ». Si j’apprécie toujours autant François Lelord dont le parcours me fascine, je me suis lassée de Christophe André qui, dans sa médiation, semble s’être un peu perdu. J’ai beaucoup de mal avec les gens aussi intelligents soient-ils qui exploitent un filon jusqu’au tarissement. Tous les ans, désormais, Christophe André nous gratifie d’un ouvrage sur la méditation. Comment méditer jour après jour, méditer trois minutes par jour…Cela me rappelle Yann Arthus Bertrand et ses photos de la terre vue du ciel. Il les avait déclinées sous toutes leurs formes. Je me demande si, bientôt, on nous vendra des rouleaux de papier toilette avec des conseils méditatifs inscrits dessus. Je parlais de ce livre à Andrée et, du tac au tac, elle m’a répondu : « Anne-Lorraine, n’achetez pas ce livre et, surtout, n’apprenez pas à gérer les personnalités difficiles. Tenez-vous loin d’elles ! » Andrée ne connaissait que trop le sujet, elle avait été mariée avec un de ces hommes dont le charisme et la réussite dissimulaient une nature manipulatrice. Séparée de son mari, Andrée mettrait des années à dénouer les liens l’unissant à cet être moralement dangereux. Le procès irait jusqu’en cassation.
Dans une autre vie, je travaillais en qualité de consultante au Comité directeur pour la bioéthique au Conseil de l’Europe. J’étais étudiante en thèse et vacataire d’enseignement à l’Université. Toutes les semaines, mes cours dispensés, je me rendais à la gare de l’Est et prenais place dans un TGV dont je descendais en gare de Strasbourg. La mère d’un amoureux d’une amie d’enfance dont le fils aîné était mort dans des conditions très douloureuses quelques mois auparavant avait la gentillesse de m’y accueillir et de m’héberger. J’ai beaucoup appris au contact d’Andrée, une femme brillante, engagée, musicienne, très sportive, qui, à l’époque, dirigeait le plus important cabinet de radiologie de la ville. Andrée est la première personne à m’avoir invitée à m’écouter davantage, à être à l’écoute de mes désirs profonds, à apprendre à me considérer comme une « priorité ». Andrée a semé des graines précieuses. Josette, mon ancien professeur de philosophie et Catherine, mon ancien directeur de thèse, sont désormais les deux personnes qui, régulièrement, me rappellent de faire lever les graines semées à Strasbourg. Si je reviens sur ce petit bout de mon histoire, c’est qu’un soir, je parlais à Andrée d’un livre que venaient de publier deux psychiatres qui, à l’époque, avaient mes faveurs : François Lelord et Christophe André. Ce livre s’intitulait « Comment gérer les personnalités difficiles ? ». Si j’apprécie toujours autant François Lelord dont le parcours me fascine, je me suis lassée de Christophe André qui, dans sa médiation, semble s’être un peu perdu. J’ai beaucoup de mal avec les gens aussi intelligents soient-ils qui exploitent un filon jusqu’au tarissement. Tous les ans, désormais, Christophe André nous gratifie d’un ouvrage sur la méditation. Comment méditer jour après jour, méditer trois minutes par jour…Cela me rappelle Yann Arthus Bertrand et ses photos de la terre vue du ciel. Il les avait déclinées sous toutes leurs formes. Je me demande si, bientôt, on nous vendra des rouleaux de papier toilette avec des conseils méditatifs inscrits dessus. Je parlais de ce livre à Andrée et, du tac au tac, elle m’a répondu : « Anne-Lorraine, n’achetez pas ce livre et, surtout, n’apprenez pas à gérer les personnalités difficiles. Tenez-vous loin d’elles ! » Andrée ne connaissait que trop le sujet, elle avait été mariée avec un de ces hommes dont le charisme et la réussite dissimulaient une nature manipulatrice. Séparée de son mari, Andrée mettrait des années à dénouer les liens l’unissant à cet être moralement dangereux. Le procès irait jusqu’en cassation.
 Je sais combien les techniques de méditation ont pu faire, font et feront du bien à un très grand nombre de personne. Je préfère l’approche de Fabrice Midal à celle de Christophe André. Je vous ai déjà parlé de ce livre que j’ai adoré et ai découvert grâce à l’une de mes anciennes patientes, une femme animée par une insatiable curiosité comme, souvent, les maîtres des écoles, « Foutez-vous la paix ! et commencez à vivre ». Certaines approches de la méditation ne sont pas adaptées aux occidentaux et, parfois, la méditation peut apporter plus de stress que d’apaisement quand le discours manque de liberté. Par ailleurs, on compte parmi les maîtres en méditation un certain nombre de gourous. C’est malheureusement aussi le cas dans la sophrologie. A la méditation, je préfère la contemplation à laquelle je m’adonne tous les matins depuis que notre berger australien est entré dans notre vie et que le cabinet s’est développé. Tous les matins, par tous les temps et, quand les jours s’étirent, de plus en plus tôt pour vivre la montée de l’aube, je suis sur mon vélo, celui qui a connu les aventures néo-zélandaises. Fantôme caracole en tête. Il n’a pas un esprit de suiveur ! Il faut le voir faire la course avec le VTT de Stéphane quand celui-ci file dans les pentes.
Je sais combien les techniques de méditation ont pu faire, font et feront du bien à un très grand nombre de personne. Je préfère l’approche de Fabrice Midal à celle de Christophe André. Je vous ai déjà parlé de ce livre que j’ai adoré et ai découvert grâce à l’une de mes anciennes patientes, une femme animée par une insatiable curiosité comme, souvent, les maîtres des écoles, « Foutez-vous la paix ! et commencez à vivre ». Certaines approches de la méditation ne sont pas adaptées aux occidentaux et, parfois, la méditation peut apporter plus de stress que d’apaisement quand le discours manque de liberté. Par ailleurs, on compte parmi les maîtres en méditation un certain nombre de gourous. C’est malheureusement aussi le cas dans la sophrologie. A la méditation, je préfère la contemplation à laquelle je m’adonne tous les matins depuis que notre berger australien est entré dans notre vie et que le cabinet s’est développé. Tous les matins, par tous les temps et, quand les jours s’étirent, de plus en plus tôt pour vivre la montée de l’aube, je suis sur mon vélo, celui qui a connu les aventures néo-zélandaises. Fantôme caracole en tête. Il n’a pas un esprit de suiveur ! Il faut le voir faire la course avec le VTT de Stéphane quand celui-ci file dans les pentes.
 Tous les matins, par tous les temps, Fantôme et moi quittons la maison et sillonnons les environs. Pendant cette sortie, je ne pense plus à rien. Je suis seulement dans la contemplation de ce qui m’entoure. J’observe tout : les arbres, les tiges, les racines, les écorces, les bourgeons, les fleurs, les insectes, les chevreuils, les lapins, les oiseaux, les grenouilles, les poules d’eau, les chevaux, les moutons, les papillons, la terre, ses sillons, les silex, les céréales qui poussent, les ballots de paille, les coquelicots, les bleuets, les boutons d’or, la cigüe étoilée, les nuages, les couleurs du ciel. J’écoute le chant du vent dans les feuilles, au-dessus des têtes des épis de blé ou d’orge, des grenouilles, des pics verts, des pies, des corneilles, des grues cendrées. Je sens l’odeur du blé mur, de l’herbe humide, des foins coupés, de la terre chaude mouillée par une pluie d’orage, du lilas, de l’humus, des champignons. Parfois, je descends de mon vélo et je m’allonge dans l’herbe. Il m’arrive de retirer mes baskets et m’amuser à sentir l’herbe sous la plante de mes pieds. Alors, toujours, je pense à Alphonse Daudet et à son sous-préfet aux champs qui composait des vers et mâchouillait des violettes sur la route d’un comice agricole. Je ramasse des mûres. Je déguste des cerises. Je casse une noix fraîche et la mange après lui avoir retiré sa petite peau amère.
Tous les matins, par tous les temps, Fantôme et moi quittons la maison et sillonnons les environs. Pendant cette sortie, je ne pense plus à rien. Je suis seulement dans la contemplation de ce qui m’entoure. J’observe tout : les arbres, les tiges, les racines, les écorces, les bourgeons, les fleurs, les insectes, les chevreuils, les lapins, les oiseaux, les grenouilles, les poules d’eau, les chevaux, les moutons, les papillons, la terre, ses sillons, les silex, les céréales qui poussent, les ballots de paille, les coquelicots, les bleuets, les boutons d’or, la cigüe étoilée, les nuages, les couleurs du ciel. J’écoute le chant du vent dans les feuilles, au-dessus des têtes des épis de blé ou d’orge, des grenouilles, des pics verts, des pies, des corneilles, des grues cendrées. Je sens l’odeur du blé mur, de l’herbe humide, des foins coupés, de la terre chaude mouillée par une pluie d’orage, du lilas, de l’humus, des champignons. Parfois, je descends de mon vélo et je m’allonge dans l’herbe. Il m’arrive de retirer mes baskets et m’amuser à sentir l’herbe sous la plante de mes pieds. Alors, toujours, je pense à Alphonse Daudet et à son sous-préfet aux champs qui composait des vers et mâchouillait des violettes sur la route d’un comice agricole. Je ramasse des mûres. Je déguste des cerises. Je casse une noix fraîche et la mange après lui avoir retiré sa petite peau amère.
 Tous les sens en éveil, cette contemplation de la nature me ressource et m’apaise et si une pensée s’invite, je la laisse filer tel un nuage poussé par le vent. Cette capacité à prendre le temps de contempler tout ce qui nous entoure, d’être dans la pleine conscience de tous les petits bonheurs du quotidien nous permet de ne plus subir le temps. Le temps s’expanse au rythme de notre conscience. C’est l’un des choses que je m’efforce de transmettre à toutes les personnes qui poussent la petite porte d’Ar-Men et viennent s’allonger sur le canapé tendu d’un tissu venu du Nord de l’Inde et qui, dix-sept ans plus tard, en a conservé l’odeur intacte. Son odeur restitue à elle seule l’ambiance dans les rues de Leh, la capitale du Ladakh, en septembre, alors qu’approchent les premières neiges, le temps du repli dans le ventre des petites maisons.
Tous les sens en éveil, cette contemplation de la nature me ressource et m’apaise et si une pensée s’invite, je la laisse filer tel un nuage poussé par le vent. Cette capacité à prendre le temps de contempler tout ce qui nous entoure, d’être dans la pleine conscience de tous les petits bonheurs du quotidien nous permet de ne plus subir le temps. Le temps s’expanse au rythme de notre conscience. C’est l’un des choses que je m’efforce de transmettre à toutes les personnes qui poussent la petite porte d’Ar-Men et viennent s’allonger sur le canapé tendu d’un tissu venu du Nord de l’Inde et qui, dix-sept ans plus tard, en a conservé l’odeur intacte. Son odeur restitue à elle seule l’ambiance dans les rues de Leh, la capitale du Ladakh, en septembre, alors qu’approchent les premières neiges, le temps du repli dans le ventre des petites maisons.
 Cet été, c’est maintenant certain, les tentes vont reprendre du service. Nous réalisons enfin un de mes projets de marche en partant mettre nos pas dans ceux de Stevenson. Cela fait cent-quarante ans que Stevenson entreprenait ce périple avec son ânesse Modestine pour soigner un chagrin d’amour. Le désir de marcher avec des amis et des ânes m’est venu voici deux ans tandis qu’étendus dans l’herbe du pré d’un camping municipal nous comptions les étoiles filantes tout en écoutant un groupe de Belges revisitant le répertoire de Michel Sardou. Ce n’est pas cet aspect qui m’avait séduite mais le fait qu’ils étaient une large bande joyeuse de parents et d’enfants découvrant les Causses avec des ânes dont nous partagions le pré.
Cet été, c’est maintenant certain, les tentes vont reprendre du service. Nous réalisons enfin un de mes projets de marche en partant mettre nos pas dans ceux de Stevenson. Cela fait cent-quarante ans que Stevenson entreprenait ce périple avec son ânesse Modestine pour soigner un chagrin d’amour. Le désir de marcher avec des amis et des ânes m’est venu voici deux ans tandis qu’étendus dans l’herbe du pré d’un camping municipal nous comptions les étoiles filantes tout en écoutant un groupe de Belges revisitant le répertoire de Michel Sardou. Ce n’est pas cet aspect qui m’avait séduite mais le fait qu’ils étaient une large bande joyeuse de parents et d’enfants découvrant les Causses avec des ânes dont nous partagions le pré.
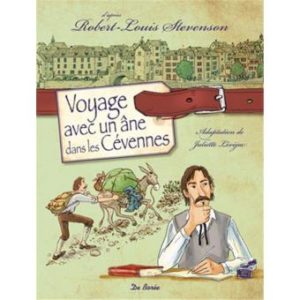 Quand nous serons dans le Gard, dans la bonne et vieille maison de Pont-Saint-Esprit, j’irai chercher sur les étagères poussiéreuses de l’une des innombrables bibliothèques, le livre dans lequel l’Ecossais Robert Louis Stevenson raconte son aventure avec son ânesse, « voyage avec un âne dans les Cévennes ». Je le lirai par épisodes le soir aux enfants et, sur la carte que j’ai achetée l’année dernière, nous suivrons les étapes. Cet été, début août, nous marcherons de Saint-Jean-du-Gard à Florac. Nous ne verrons donc que la partie cévenole. Le Mont Lozère, le Gévaudan et le Velay seront pour une prochaine fois. Les ânes ont la réputation, non usurpée, d’être des animaux affreusement têtus. Je sais que les bâter correctement et, surtout, les faire avancer ne sont pas des tâches faciles. Je suis certaine que nous allons passer de merveilleux moments avec les amis qui ont répondu à l’appel et tous les enfants.
Quand nous serons dans le Gard, dans la bonne et vieille maison de Pont-Saint-Esprit, j’irai chercher sur les étagères poussiéreuses de l’une des innombrables bibliothèques, le livre dans lequel l’Ecossais Robert Louis Stevenson raconte son aventure avec son ânesse, « voyage avec un âne dans les Cévennes ». Je le lirai par épisodes le soir aux enfants et, sur la carte que j’ai achetée l’année dernière, nous suivrons les étapes. Cet été, début août, nous marcherons de Saint-Jean-du-Gard à Florac. Nous ne verrons donc que la partie cévenole. Le Mont Lozère, le Gévaudan et le Velay seront pour une prochaine fois. Les ânes ont la réputation, non usurpée, d’être des animaux affreusement têtus. Je sais que les bâter correctement et, surtout, les faire avancer ne sont pas des tâches faciles. Je suis certaine que nous allons passer de merveilleux moments avec les amis qui ont répondu à l’appel et tous les enfants.
 Enfant, scout, je n’ai pas aimé les campements dans les champs détrempés prêtés par des agriculteurs sarthois. J’ai détesté le manque d’hygiène, la boue dans les tentes et les sacs de couchage humides. J’ai découvert la vie dans la nature avec Stéphane et j’ai tout adoré: l’air frais la nuit dans la tente, les bruits de la nature (sauf en Colombie Britannique où la forêt était infestée d’ours), les bains dans les rivières, les douches sous les cascades, la préparation des repas dans des petites popotes, la magie des crépuscules et des aubes, le linge tendu sur un fil entre deux branches. Nous allons retrouver tous ces moments cet été, des moments simples, loin du confort moderne et de la logistique qui l’accompagne. Bref, la liberté!
Enfant, scout, je n’ai pas aimé les campements dans les champs détrempés prêtés par des agriculteurs sarthois. J’ai détesté le manque d’hygiène, la boue dans les tentes et les sacs de couchage humides. J’ai découvert la vie dans la nature avec Stéphane et j’ai tout adoré: l’air frais la nuit dans la tente, les bruits de la nature (sauf en Colombie Britannique où la forêt était infestée d’ours), les bains dans les rivières, les douches sous les cascades, la préparation des repas dans des petites popotes, la magie des crépuscules et des aubes, le linge tendu sur un fil entre deux branches. Nous allons retrouver tous ces moments cet été, des moments simples, loin du confort moderne et de la logistique qui l’accompagne. Bref, la liberté!
 Je laisse le mot de la fin à Stevenson: « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager; je voyage pour le plaisir du voyage. L’essentiel est de bouger; d’éprouver d’un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, et de sentir sous ses pieds le granit terrestre avec, par endroits, le coupant du silex. »
Je laisse le mot de la fin à Stevenson: « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager; je voyage pour le plaisir du voyage. L’essentiel est de bouger; d’éprouver d’un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, et de sentir sous ses pieds le granit terrestre avec, par endroits, le coupant du silex. »
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner