 Dimanche, nous entrerons dans le temps de l’Avent, un temps de lumière, de partage et d’espérance. Ce matin, après une grande sortie avec Fantôme, j’ai rentré la crèche que Louis et son papa ont fabriquée l’année dernière. Elle était dehors. Dans le bas d’un placard, plongés dans l’obscurité, les santons provençaux, emmaillotés dans des feuilles de Sopalin, vont bientôt retrouver la lumière du jour. Tous les ans, au salon des santons qui se tient à Sceaux où vit ma mère, nous achetons des santons pour les enfants. Le jour où ils quitteront la maison, je les leur donnerai. Victoire a ramassé des feuilles d’automne qui finissent de sécher dans un catalogue « Maison du monde ». Les feuilles seront posées sous la crèche. Elles formeront un tapis. De la mousse viendra couvrir le dessus de la crèche et la première bougie du temps de l’Avent sera allumée. Les enfants adorent faire la crèche, redécouvrir les santons, le moulin, le pigeonnier et mon vieux Ravi au bras cassé que je conserve religieusement. Il a mon âge. Des santons m’avaient été offerts à ma naissance.
Dimanche, nous entrerons dans le temps de l’Avent, un temps de lumière, de partage et d’espérance. Ce matin, après une grande sortie avec Fantôme, j’ai rentré la crèche que Louis et son papa ont fabriquée l’année dernière. Elle était dehors. Dans le bas d’un placard, plongés dans l’obscurité, les santons provençaux, emmaillotés dans des feuilles de Sopalin, vont bientôt retrouver la lumière du jour. Tous les ans, au salon des santons qui se tient à Sceaux où vit ma mère, nous achetons des santons pour les enfants. Le jour où ils quitteront la maison, je les leur donnerai. Victoire a ramassé des feuilles d’automne qui finissent de sécher dans un catalogue « Maison du monde ». Les feuilles seront posées sous la crèche. Elles formeront un tapis. De la mousse viendra couvrir le dessus de la crèche et la première bougie du temps de l’Avent sera allumée. Les enfants adorent faire la crèche, redécouvrir les santons, le moulin, le pigeonnier et mon vieux Ravi au bras cassé que je conserve religieusement. Il a mon âge. Des santons m’avaient été offerts à ma naissance.
 A pas comptés, nous allons entrer dans ce temps merveilleux que nous ne résumerons pas à une liste de cadeaux au Père Noël, à une orgie programmée de nourriture et à des décorations scintillantes. Nous allons ouvrir un peu plus nos cœurs aux autres, à ceux qui pourraient avoir besoin de nous. Comme tous les ans, les enfants vont donner des jouets, des vêtements et nous veillerons à aider aux collectes des associations pour les longs mois d’hiver. Le bonheur ne vaut que s’il est partagé. Tout ce que nous donnons nous rend plus riches. Je pense souvent à ces deux phrases et je me les répète comme un moine bouddhiste le ferait avec des mantras. Quand Louis sera entré au collège, nous proposerons d’aider à préparer et à servir le repas de Noël organisé par les restos du cœur ou le secours catholique.
A pas comptés, nous allons entrer dans ce temps merveilleux que nous ne résumerons pas à une liste de cadeaux au Père Noël, à une orgie programmée de nourriture et à des décorations scintillantes. Nous allons ouvrir un peu plus nos cœurs aux autres, à ceux qui pourraient avoir besoin de nous. Comme tous les ans, les enfants vont donner des jouets, des vêtements et nous veillerons à aider aux collectes des associations pour les longs mois d’hiver. Le bonheur ne vaut que s’il est partagé. Tout ce que nous donnons nous rend plus riches. Je pense souvent à ces deux phrases et je me les répète comme un moine bouddhiste le ferait avec des mantras. Quand Louis sera entré au collège, nous proposerons d’aider à préparer et à servir le repas de Noël organisé par les restos du cœur ou le secours catholique.
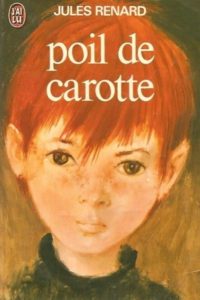 Est-ce parce que je me sentais différente en raison de nos déménagements successifs et du métier d’un père qui nous privait de toute vie vraiment privée mais j’ai toujours été sensible à la détresse des enfants qui n’avaient pas d’ami et étaient même rejetés par les autres. Je m’attachais à les faire admettre par le groupe et mettais un point d’honneur à les inviter à mes anniversaires. Nos enfants ont dû hériter de moi car ils sont également très sensibles à ceux qui sont mis de côté et, parfois, victimes de brimades. Ils n’hésitent pas à prendre la défense de ceux qui en ont besoin.
Est-ce parce que je me sentais différente en raison de nos déménagements successifs et du métier d’un père qui nous privait de toute vie vraiment privée mais j’ai toujours été sensible à la détresse des enfants qui n’avaient pas d’ami et étaient même rejetés par les autres. Je m’attachais à les faire admettre par le groupe et mettais un point d’honneur à les inviter à mes anniversaires. Nos enfants ont dû hériter de moi car ils sont également très sensibles à ceux qui sont mis de côté et, parfois, victimes de brimades. Ils n’hésitent pas à prendre la défense de ceux qui en ont besoin.
 Les derniers chiffres sur la pauvreté en France son tombés récemment et ils sont terribles ! Il suffit de se promener dans les rues des grandes villes, de prendre le métro pour constater que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté augmente tous les ans. Il ne faut pas croire que dans nos campagnes la pauvreté ne soit pas aussi importante mais elle ne se voit pas. Elle est souvent cachée. Ce sont les instituteurs qui s’en rendent compte dans le manque de soins apportés aux enfants, devant le nombre de mères quittant le monde du travail pour ne plus jamais y revenir, le retour en force de maladies qu’on croyait enterrées et que les médecins ont beaucoup de mal à diagnostiquer car ils ne les ont étudiées que de manière théorique.
Les derniers chiffres sur la pauvreté en France son tombés récemment et ils sont terribles ! Il suffit de se promener dans les rues des grandes villes, de prendre le métro pour constater que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté augmente tous les ans. Il ne faut pas croire que dans nos campagnes la pauvreté ne soit pas aussi importante mais elle ne se voit pas. Elle est souvent cachée. Ce sont les instituteurs qui s’en rendent compte dans le manque de soins apportés aux enfants, devant le nombre de mères quittant le monde du travail pour ne plus jamais y revenir, le retour en force de maladies qu’on croyait enterrées et que les médecins ont beaucoup de mal à diagnostiquer car ils ne les ont étudiées que de manière théorique.
 La misère, c’est ce qui tourmente le plus nos enfants quand nous allons à Paris. Avant de partir nous promener ou de nous enfoncer dans les entrailles de la terre, nous remplissons les poches de nos manteaux de pièces. Nous les donnons à ceux qui en ont besoin : la vieille dame rom aux sourires d’or assise à côté de l’une des boulangeries de la rue Mouffetard, une boulangerie où l’on vous vend une baguette dite « sauvage » , l’homme jeune, dans le wagon du RER, qui ne s’est pas lavé depuis bien longtemps et qui rêve de pouvoir reprendre ses études pour devenir un grand chef, le malheureux qui dort sur un sac de couchage miteux près d’une bouche de métro et qui ne demande rien, le grand barbu, assis sur le trottoir du boulevard Saint-Michel et qui a posé une couverture sur son chien, la jeune mère rom qui tient son bébé contre elle et à laquelle les enfants disent bonjour en roumain. Même quand ils n’ont pas d’argent à donner, j’ai appris à nos trois enfants à dire bonjour et à sourire, à ne pas se dérober à ceux qui finissent par inspirer de la pitié ou du dégout. Ne plus exister, c’est le sentiment que ressentent beaucoup de sans abris. Ils sont si nombreux à vivre dehors, à être exploités, à ne pas baisser les bras, à espérer une vie meilleure. Ils sont si nombreux à s’alcooliser non pas parce qu’ils aiment l’alcool mais parce que l’alcool reste encore le plus sûr moyen d’oublier, de rejoindre un paradis artificiel. Quand j’habitais à Paris, les jours de grande fatigue, ces jours où on n’a plus de peau, ces jours où le cœur est à vif, je fondais en larmes à la vue d’une maman rom avec son bébé ou d’un sans domicile fixe endormi avec, à côté de lui, ses maigres affaires et une bouteille de vin vide.
La misère, c’est ce qui tourmente le plus nos enfants quand nous allons à Paris. Avant de partir nous promener ou de nous enfoncer dans les entrailles de la terre, nous remplissons les poches de nos manteaux de pièces. Nous les donnons à ceux qui en ont besoin : la vieille dame rom aux sourires d’or assise à côté de l’une des boulangeries de la rue Mouffetard, une boulangerie où l’on vous vend une baguette dite « sauvage » , l’homme jeune, dans le wagon du RER, qui ne s’est pas lavé depuis bien longtemps et qui rêve de pouvoir reprendre ses études pour devenir un grand chef, le malheureux qui dort sur un sac de couchage miteux près d’une bouche de métro et qui ne demande rien, le grand barbu, assis sur le trottoir du boulevard Saint-Michel et qui a posé une couverture sur son chien, la jeune mère rom qui tient son bébé contre elle et à laquelle les enfants disent bonjour en roumain. Même quand ils n’ont pas d’argent à donner, j’ai appris à nos trois enfants à dire bonjour et à sourire, à ne pas se dérober à ceux qui finissent par inspirer de la pitié ou du dégout. Ne plus exister, c’est le sentiment que ressentent beaucoup de sans abris. Ils sont si nombreux à vivre dehors, à être exploités, à ne pas baisser les bras, à espérer une vie meilleure. Ils sont si nombreux à s’alcooliser non pas parce qu’ils aiment l’alcool mais parce que l’alcool reste encore le plus sûr moyen d’oublier, de rejoindre un paradis artificiel. Quand j’habitais à Paris, les jours de grande fatigue, ces jours où on n’a plus de peau, ces jours où le cœur est à vif, je fondais en larmes à la vue d’une maman rom avec son bébé ou d’un sans domicile fixe endormi avec, à côté de lui, ses maigres affaires et une bouteille de vin vide.
 Pour le long week-end du 11 novembre, en famille, nous avions pris la clé des villes et étions à Paris. La campagne, quand les mauvais jours s’installent, me pèse beaucoup. Dimanche matin, nous étions dans le métro, ligne 7, celle qui traverse la capitale du nord-est au sud-est. Elle va de la Courneuve à mairie d’Ivry ou Villejuif. Nous étions à la station Censier-Daubenton. Nous avions des billets pour la cité des sciences à onze heures. Nous allions découvrir une passionnante exposition sur le Moyen Age, une autre sur la ville, assister à une séance au planétarium et découvrir l’intérieur de l’Argonaute. Un sacré programme ! Les Parisiens sont rarement des lève-tôt alors qu’ils ont la chance d’habiter une ville qui ne dort jamais. Personne sur le quai. Nous sommes montés dans un wagon et nous nous sommes installés sur les strapontins. Victoire était à côté de moi et, de l’autre côté, face à nous, Céleste, Stéphane et Louis, sur les genoux de son père. J’ai tout de suite vu le malheureux qui sommeillait sur une banquette. Mes yeux ont d’abord rencontré ses pieds, des pieds larges comme des pattes d’éléphants peinant à tenir dans des tongs à la fois trop étroites et trop petites. La plante de ses pieds était fendue par de profondes crevasses blanches. Il portait un jogging noir et une grosse doudoune bleu foncé. Sa tête qui disparaissait en partie dans la capuche reposait sur la vitre. Il avait dû prendre place dans le wagon quand le métro s’était remis à circuler. Au moins, il avait chaud et il pouvait dormir. Les couloirs des métros sont toujours si pleins de courants d’air froid. Devant lui, un sac Franprix contenant une bouteille de Pepsi vide.
Pour le long week-end du 11 novembre, en famille, nous avions pris la clé des villes et étions à Paris. La campagne, quand les mauvais jours s’installent, me pèse beaucoup. Dimanche matin, nous étions dans le métro, ligne 7, celle qui traverse la capitale du nord-est au sud-est. Elle va de la Courneuve à mairie d’Ivry ou Villejuif. Nous étions à la station Censier-Daubenton. Nous avions des billets pour la cité des sciences à onze heures. Nous allions découvrir une passionnante exposition sur le Moyen Age, une autre sur la ville, assister à une séance au planétarium et découvrir l’intérieur de l’Argonaute. Un sacré programme ! Les Parisiens sont rarement des lève-tôt alors qu’ils ont la chance d’habiter une ville qui ne dort jamais. Personne sur le quai. Nous sommes montés dans un wagon et nous nous sommes installés sur les strapontins. Victoire était à côté de moi et, de l’autre côté, face à nous, Céleste, Stéphane et Louis, sur les genoux de son père. J’ai tout de suite vu le malheureux qui sommeillait sur une banquette. Mes yeux ont d’abord rencontré ses pieds, des pieds larges comme des pattes d’éléphants peinant à tenir dans des tongs à la fois trop étroites et trop petites. La plante de ses pieds était fendue par de profondes crevasses blanches. Il portait un jogging noir et une grosse doudoune bleu foncé. Sa tête qui disparaissait en partie dans la capuche reposait sur la vitre. Il avait dû prendre place dans le wagon quand le métro s’était remis à circuler. Au moins, il avait chaud et il pouvait dormir. Les couloirs des métros sont toujours si pleins de courants d’air froid. Devant lui, un sac Franprix contenant une bouteille de Pepsi vide.
 Plus je regardais cet homme qui pouvait avoir entre quarante et cinquante ans et qui, lui, ne voyait personne, et plus je sentais monter en moi une profonde tristesse. Je me disais que cet homme avait eu des parents, une maman qui l’avait porté au chaud de son corps pendant neuf mois, que cette maman l’avait mis au monde, l’avait serré dans ses bras, caressé, embrassé, nourri, aimé ou bien alors, au contraire, cette maman n’avait pas eu envie de lui et elle l’avait rejeté, maltraité, battu, humilié et peut-être abandonné. Le seul fait de me dire que cet homme avait été un bébé qui pouvait espérer une belle vie faisait monter en moi à la fois de la tristesse et de la colère. Je me suis toujours révoltée contre l’injustice de la cigogne qui dépose ses paquets dans des familles si tristes, si mal-aimantes, si désespérées. On lit, parfois, que c’est l’âme du bébé qui choisit sa mère. Cette idée ne me satisfait pas comme toute notion de bon ou de mauvais karma !
Plus je regardais cet homme qui pouvait avoir entre quarante et cinquante ans et qui, lui, ne voyait personne, et plus je sentais monter en moi une profonde tristesse. Je me disais que cet homme avait eu des parents, une maman qui l’avait porté au chaud de son corps pendant neuf mois, que cette maman l’avait mis au monde, l’avait serré dans ses bras, caressé, embrassé, nourri, aimé ou bien alors, au contraire, cette maman n’avait pas eu envie de lui et elle l’avait rejeté, maltraité, battu, humilié et peut-être abandonné. Le seul fait de me dire que cet homme avait été un bébé qui pouvait espérer une belle vie faisait monter en moi à la fois de la tristesse et de la colère. Je me suis toujours révoltée contre l’injustice de la cigogne qui dépose ses paquets dans des familles si tristes, si mal-aimantes, si désespérées. On lit, parfois, que c’est l’âme du bébé qui choisit sa mère. Cette idée ne me satisfait pas comme toute notion de bon ou de mauvais karma !
J’étais la seule à avoir vu cet homme. Stéphane et les enfants ne l’avaient pas vu. Victoire, à mes côtés, jouait sur son téléphone. Un calme tout dominical régnait dans le wagon et l’homme sommeillant s’est mis à tousser, à tousser de plus en plus et à cracher des glaires qui retombaient sur sa doudoune. Il gardait ses paupières closes. Il ne voulait pas entrer en contact avec le monde extérieur. La toux redoublait. Les crachats aussi. La nausée me gagnait et je voyais que cette vision devenait insoutenable pour Victoire. J’ai fait signe à Stéphane et, à la station suivante, nous avons changé de compartiment. Quand nous sommes descendus à la Villette, le monsieur était désormais seul. Tous les autres passagers avaient fui. Je n’aurais pas été capable d’aller le voir et de lui demander s’il avait besoin de quelque chose.
 Alors, je pensais à notre cousin Jean-Guilhem Xerri dont je me sens si proche bien que nous ne nous voyions presque jamais et dont j’admire l’engagement et la qualité d’écoute en dépit de sa nature très personnelle. On ne s’en rend pas toujours compte mais les gens ne s’écoutent pas les uns les autres. Ils se parlent mais ne s’écoutent pas. Ecouter l’autre, c’est ouvrir en soi un espace d’accueil total. C’est s’oublier soi-même. C’est ne pas faire que la parole de l’autre nous rappelle à nous-même. La vraie écoute est aussi rare que la vraie générosité, celle qui n’attend aucun retour, pas même une valorisation de lui-même pour celui qui donne. Jean-Guilhem est capable de cette écoute et si je pensais à lui si fort ce matin-là, c’est parce que je savais qu’il n’aurait pas changé de place et qu’il aurait été vers cet homme. Jean-Guilhem a, pendant plus de vingt ans, arpenté le macadam parisien, la nuit, pour aller rencontrer des hommes et des femmes en situation de totale précarité, des âmes qui n’attendaient plus rien de personne. Il a mené cette action de terrain tout en exerçant son métier de médecin biologiste des hôpitaux de Paris. Il a été ensuite nommé président de l’association pour laquelle il oeuvrait « Aux captifs, la libération ». Jean-Guilhem a côtoyé des âmes blessées, des corps malades, salis, violés. Il a su passer au-dessus de la vision si déstabilisante de ces êtres vivant dans la rue. Des hommes et des femmes, jeunes, vieux, dans la force de l’âge, qui ne peuvent plus se laver, changer de vêtements. Des gens dont l’odeur peut être vraiment épouvantable. Il m’a dit que ce qui était très dur et très triste c’était de voir combien la rue abimait les femmes dans leur féminité.
Alors, je pensais à notre cousin Jean-Guilhem Xerri dont je me sens si proche bien que nous ne nous voyions presque jamais et dont j’admire l’engagement et la qualité d’écoute en dépit de sa nature très personnelle. On ne s’en rend pas toujours compte mais les gens ne s’écoutent pas les uns les autres. Ils se parlent mais ne s’écoutent pas. Ecouter l’autre, c’est ouvrir en soi un espace d’accueil total. C’est s’oublier soi-même. C’est ne pas faire que la parole de l’autre nous rappelle à nous-même. La vraie écoute est aussi rare que la vraie générosité, celle qui n’attend aucun retour, pas même une valorisation de lui-même pour celui qui donne. Jean-Guilhem est capable de cette écoute et si je pensais à lui si fort ce matin-là, c’est parce que je savais qu’il n’aurait pas changé de place et qu’il aurait été vers cet homme. Jean-Guilhem a, pendant plus de vingt ans, arpenté le macadam parisien, la nuit, pour aller rencontrer des hommes et des femmes en situation de totale précarité, des âmes qui n’attendaient plus rien de personne. Il a mené cette action de terrain tout en exerçant son métier de médecin biologiste des hôpitaux de Paris. Il a été ensuite nommé président de l’association pour laquelle il oeuvrait « Aux captifs, la libération ». Jean-Guilhem a côtoyé des âmes blessées, des corps malades, salis, violés. Il a su passer au-dessus de la vision si déstabilisante de ces êtres vivant dans la rue. Des hommes et des femmes, jeunes, vieux, dans la force de l’âge, qui ne peuvent plus se laver, changer de vêtements. Des gens dont l’odeur peut être vraiment épouvantable. Il m’a dit que ce qui était très dur et très triste c’était de voir combien la rue abimait les femmes dans leur féminité.
Tous les jours, par son action, son écoute, son engagement, Jean-Guilhem marche vraiment sur les pas du Christ. Il n’est pas dans l’égo, comme le sont malheureusement trop souvent les présidents des associations caritatives. Il ne recherche pas la gloire et les honneurs. C’est sa foi qui l’anime, une foi dont il témoignait dans son dernier livre « à quoi sert un chrétien » et qui s’est vu décerner le prix humanisme chrétien en 2015. Est-ce que mon cousin serait le même homme s’il n’était pas porté par cette foi puissante ? Je pense pouvoir répondre par l’affirmative car le besoin d’engagement est si fort enraciné en lui qu’il aurait forcément mis son énergie exceptionnelle au service des autres et, parmi les autres, les plus fragiles, les malades et les démunis. Lors de l’un de nos trop rares déjeuners que nous partagions à Paris, non loin de son lieu de travail, nous nous entendions sur l’importance de la confiance à placer en celui qui a besoin d’être aidé et dans l’écoute qui n’est jamais neutre mais toujours bienveillante !
Je terminerai ma chronique avec un propos de Jean-Guilhem illustrant à merveille la relation à l’autre : « Un jour, je vois un gars avec un pied complètement bousillé et je lui demande : « Tu n’as pas mal au pied ? » « Mon pied a mal, peut-être, me répond-il, mais moi je n’ai pas mal ! » : d’une certaine manière, il n’était même plus en relation avec son propre corps ! C’est pourquoi l’essentiel, c’est effectivement d’entrer en relation avec la personne.
Quand on travaille avec les gens de la rue, il faut se rappeler qu’on n’est pas là pour résoudre un problème mais pour accompagner une personne qui, à un moment donné, a un problème à résoudre. Ce qu’il faut travailler en priorité, c’est la qualité de l’écoute et de la relation car c’est le fait d’être présent à l’autre qui l’aide à être présent à lui-même.”
 Que ce temps de l’Avent qui vient soit pour nous tous un temps d’écoute vraie, d’attention portée aux autres et de retour sur nous. Tous les jours, nous sommes perfectibles. Ne nous croyions jamais “arrivés”. Nous sommes toujours en mouvement, en mouvement jusqu’au dernier souffle!
Que ce temps de l’Avent qui vient soit pour nous tous un temps d’écoute vraie, d’attention portée aux autres et de retour sur nous. Tous les jours, nous sommes perfectibles. Ne nous croyions jamais “arrivés”. Nous sommes toujours en mouvement, en mouvement jusqu’au dernier souffle!
Alors, femmes et homes de bonne volonté, EN MARCHE!
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner


