 Depuis lundi matin, Fantôme et moi avons repris nos escapades matinales à travers champs. Même si l’Europe a connu une vague de froid mordant, on sent que le printemps n’est plus très loin. On l’entend dans la manière dont les oiseaux chantent aux premières lueurs du jour. Ils mettent dans leurs stries tant d’énergie et de joie! La famille de tourterelles a repris sa place dans un nid situé sous le petit auvent de la porte d’entrée. La belle boule de gui que Stéphane y avait accrochée avant Noël est toujours là. J’espère que, cette année, nous ne découvrirons aucun oisillon chassé de son petit lit par une vilaine bourrasque de vent du nord. Je ne sais pas si les tulipes que ma filleule m’avait gentiment rapportées d’Amsterdam mais qu’elle a tardées à m’offrir réussiront à pousser leurs tiges fines vers le ciel.
Depuis lundi matin, Fantôme et moi avons repris nos escapades matinales à travers champs. Même si l’Europe a connu une vague de froid mordant, on sent que le printemps n’est plus très loin. On l’entend dans la manière dont les oiseaux chantent aux premières lueurs du jour. Ils mettent dans leurs stries tant d’énergie et de joie! La famille de tourterelles a repris sa place dans un nid situé sous le petit auvent de la porte d’entrée. La belle boule de gui que Stéphane y avait accrochée avant Noël est toujours là. J’espère que, cette année, nous ne découvrirons aucun oisillon chassé de son petit lit par une vilaine bourrasque de vent du nord. Je ne sais pas si les tulipes que ma filleule m’avait gentiment rapportées d’Amsterdam mais qu’elle a tardées à m’offrir réussiront à pousser leurs tiges fines vers le ciel.
 Louis est resté chez sa mamie, la maman de son papa, dans l’Ain, au pays des poulets pattes bleues et de la crème AOP de la laiterie Ettrez. Louis était si heureux de passer quelques jours en tête à tête avec sa mamie! Il a pour sa mamie un attachement très particulier. Il aime son esprit moderne, sa nature baroque. Il apprécie qu’elle joue avec lui au circuit reçu à Noël, au Monopoly. Il était triste, depuis deux étés, de ne pas être avec elle, en Corse ou dans l’Ain. Mais, la cohabitation entre les filles et leur cousine, Louise, toutes trois entrées en adolescence, est très complexe. Les filles, elles, sont à Sceaux chez leur grand-mère depuis hier. Elles ont beaucoup de plaisir à aller à Paris. Ce ne sont pas les expositions qui les attirent mais les vitrines des boutiques! Au programme de leur petit séjour, l’exposition « Fujita » au musée Maillol et le grand Trianon à Versailles. Mercredi, elles retrouvent leur tante et leur toute petite cousine, dans le septième, rue Récamier, pour aller visiter l’exposition que la fondation EDF consacre au numérique. Ensuite, elles pourront marcher jusqu’au jardin du Luxembourg et, chemin faisant, pousser la boutique du Palais des thés de la rue du Cherche-Midi et y acheter du thé des lords récemment apprécié chez leur mamie. Le trio fond littéralement devant Charlotte qui soufflera sa première bougie le 16 juin. Je me répète mais cette petite fille apporte tant de bonheur et d’amour dans notre famille! La complicité qui l’unit à sa grande soeur, Margot, jeune étudiante de dix-sept ans, est incroyable!
Louis est resté chez sa mamie, la maman de son papa, dans l’Ain, au pays des poulets pattes bleues et de la crème AOP de la laiterie Ettrez. Louis était si heureux de passer quelques jours en tête à tête avec sa mamie! Il a pour sa mamie un attachement très particulier. Il aime son esprit moderne, sa nature baroque. Il apprécie qu’elle joue avec lui au circuit reçu à Noël, au Monopoly. Il était triste, depuis deux étés, de ne pas être avec elle, en Corse ou dans l’Ain. Mais, la cohabitation entre les filles et leur cousine, Louise, toutes trois entrées en adolescence, est très complexe. Les filles, elles, sont à Sceaux chez leur grand-mère depuis hier. Elles ont beaucoup de plaisir à aller à Paris. Ce ne sont pas les expositions qui les attirent mais les vitrines des boutiques! Au programme de leur petit séjour, l’exposition « Fujita » au musée Maillol et le grand Trianon à Versailles. Mercredi, elles retrouvent leur tante et leur toute petite cousine, dans le septième, rue Récamier, pour aller visiter l’exposition que la fondation EDF consacre au numérique. Ensuite, elles pourront marcher jusqu’au jardin du Luxembourg et, chemin faisant, pousser la boutique du Palais des thés de la rue du Cherche-Midi et y acheter du thé des lords récemment apprécié chez leur mamie. Le trio fond littéralement devant Charlotte qui soufflera sa première bougie le 16 juin. Je me répète mais cette petite fille apporte tant de bonheur et d’amour dans notre famille! La complicité qui l’unit à sa grande soeur, Margot, jeune étudiante de dix-sept ans, est incroyable!
 Nous sommes rentrés chez nous le dimanche en fin d’après-midi. A l’aller comme au retour, les conditions de circulation furent dantesques! Au retour, nous avons mis six heures pour parcourir cent-trente-six kilomètres. Sur une route en lacets très étroite, des conducteurs s’arrêtaient pour mettre leurs chaînes et provoquaient des ralentissements. J’ai eu tout le loisir d’observer les vacanciers installer les différents matériels conçus pour circuler sur une route enneigée. Les chaussettes à neige- invention norvégienne- extrêmement faciles à poser ont l’avantage de ne pas abimer les jantes et de ne pas perturber les systèmes de sécurité électronique. Les chaînes à neige métalliques sont soit à tension manuelle soit à tension automatique. Les premières, les moins chères, sont difficiles à installer et nécessitent une certaine dextérité. Il est donc préférable d’avoir essayé de les monter avant de se retrouver au bord de la route, les mains dans la neige avec une femme qui râle et des enfants qui essaient de percer les mystères de la notice d’utilisation écrite en coréen! Les secondes, plus coûteuses, se montent en moins d’une minute et s’adaptent automatiquement à la tension dés que la voiture se met en marche. On trouve aussi des chaînes dites « alternatives »: chaînes textiles et araignées. Les chaînes textiles sont à mi-chemin entre la chaîne métallique et la chaussette. Elles sont faciles à monter car elles s’enfilent telle une housse sur la roue. Les araignée sont présentées comme le nec plus ultra en matière de chaînes car leur montage est facile, rapide, qu’elles n’endommagent pas les jantes et ont une durée de vie plus longue. Ces chaînes se présentent sous la forme de pieuvre ou d’araignée munie de griffe ou de crampons offrant une adhérence maximale sur neige et sur verglas. Les chaînes à neige König K-Summit ont un montage frontal et semblent être les plus faciles à installer mais leur prix est assez dissuasif, en moyenne plus de quatre-cent euros quand les chaînes métalliques à tension coûtent quinze euros!
Nous sommes rentrés chez nous le dimanche en fin d’après-midi. A l’aller comme au retour, les conditions de circulation furent dantesques! Au retour, nous avons mis six heures pour parcourir cent-trente-six kilomètres. Sur une route en lacets très étroite, des conducteurs s’arrêtaient pour mettre leurs chaînes et provoquaient des ralentissements. J’ai eu tout le loisir d’observer les vacanciers installer les différents matériels conçus pour circuler sur une route enneigée. Les chaussettes à neige- invention norvégienne- extrêmement faciles à poser ont l’avantage de ne pas abimer les jantes et de ne pas perturber les systèmes de sécurité électronique. Les chaînes à neige métalliques sont soit à tension manuelle soit à tension automatique. Les premières, les moins chères, sont difficiles à installer et nécessitent une certaine dextérité. Il est donc préférable d’avoir essayé de les monter avant de se retrouver au bord de la route, les mains dans la neige avec une femme qui râle et des enfants qui essaient de percer les mystères de la notice d’utilisation écrite en coréen! Les secondes, plus coûteuses, se montent en moins d’une minute et s’adaptent automatiquement à la tension dés que la voiture se met en marche. On trouve aussi des chaînes dites « alternatives »: chaînes textiles et araignées. Les chaînes textiles sont à mi-chemin entre la chaîne métallique et la chaussette. Elles sont faciles à monter car elles s’enfilent telle une housse sur la roue. Les araignée sont présentées comme le nec plus ultra en matière de chaînes car leur montage est facile, rapide, qu’elles n’endommagent pas les jantes et ont une durée de vie plus longue. Ces chaînes se présentent sous la forme de pieuvre ou d’araignée munie de griffe ou de crampons offrant une adhérence maximale sur neige et sur verglas. Les chaînes à neige König K-Summit ont un montage frontal et semblent être les plus faciles à installer mais leur prix est assez dissuasif, en moyenne plus de quatre-cent euros quand les chaînes métalliques à tension coûtent quinze euros!
 Avec son Volvo 4×4 et ses pneus neige, Stéphane a la chance de ne pas avoir à installer de chaînes pour franchir le col du Lautaret et redescendre jusqu’à Grenoble. C’est à la hauteur de Bourg d’Oisans que nous assistons à la pagaille maximale. Des dizaines de voitures stationnent les unes derrières les autres dans le sens de la montée et de la descente, ralentissant la circulation des autres véhicules. A l’aller, des hommes et des femmes s’évertuent à installer leurs chaînes dont ils découvrent la notice pour la toute première fois. Les vacanciers s’entraident. Des couples se disputent. Des belles-mères critiquent leur gendre. Des gendres se demandent pourquoi ils partent encore en vacances avec leur belle-mère. On voit aussi des femmes qui, en plus d’aimer conduire, sont expertes dans l’art de chaîner tandis que les maris, au chaud, sont plongés dans la lecture du magasine « M », supplément du Monde. Dans le sens Grenoble, les chaînes sont démontées et rangées. On sent de la tension mais elle est plutôt due aux cinq heures mises pour arriver là!
Avec son Volvo 4×4 et ses pneus neige, Stéphane a la chance de ne pas avoir à installer de chaînes pour franchir le col du Lautaret et redescendre jusqu’à Grenoble. C’est à la hauteur de Bourg d’Oisans que nous assistons à la pagaille maximale. Des dizaines de voitures stationnent les unes derrières les autres dans le sens de la montée et de la descente, ralentissant la circulation des autres véhicules. A l’aller, des hommes et des femmes s’évertuent à installer leurs chaînes dont ils découvrent la notice pour la toute première fois. Les vacanciers s’entraident. Des couples se disputent. Des belles-mères critiquent leur gendre. Des gendres se demandent pourquoi ils partent encore en vacances avec leur belle-mère. On voit aussi des femmes qui, en plus d’aimer conduire, sont expertes dans l’art de chaîner tandis que les maris, au chaud, sont plongés dans la lecture du magasine « M », supplément du Monde. Dans le sens Grenoble, les chaînes sont démontées et rangées. On sent de la tension mais elle est plutôt due aux cinq heures mises pour arriver là!
 Nos enfants sont plutôt paisibles et, à l’arrière, comme toujours, Fantôme ne dit rien et offre son beau visage noir, blanc et brun aux gens prisonniers des voitures. Avant d’arriver à Grenoble, les enfants commencent à s’agiter. Ils se mettent à chanter à tue-tête des airs des années 80 entrecoupés de morceaux de jazz. On se dit qu’on n’arrivera jamais à Grenoble!
Nos enfants sont plutôt paisibles et, à l’arrière, comme toujours, Fantôme ne dit rien et offre son beau visage noir, blanc et brun aux gens prisonniers des voitures. Avant d’arriver à Grenoble, les enfants commencent à s’agiter. Ils se mettent à chanter à tue-tête des airs des années 80 entrecoupés de morceaux de jazz. On se dit qu’on n’arrivera jamais à Grenoble!
 Mardi, je suis presque venue à bout des cinq machines de linge à faire tourner. Les gants de ski sèchent sur le dessus des radiateurs de la cuisine entre les tranches de pain destinées à Baba, l’étalon que Fantôme et moi allons voir presque tous les matins. Je le sais triste depuis que sa famille deux pattes a quitté le Loiret pour l’Yonne. Demain, enfin, je pourrai ranger dans les cantines combinaisons, chaussettes et moufles. Elles y dormiront sagement dans un parfum d’anti-mites jusqu’à l’année prochaine.
Mardi, je suis presque venue à bout des cinq machines de linge à faire tourner. Les gants de ski sèchent sur le dessus des radiateurs de la cuisine entre les tranches de pain destinées à Baba, l’étalon que Fantôme et moi allons voir presque tous les matins. Je le sais triste depuis que sa famille deux pattes a quitté le Loiret pour l’Yonne. Demain, enfin, je pourrai ranger dans les cantines combinaisons, chaussettes et moufles. Elles y dormiront sagement dans un parfum d’anti-mites jusqu’à l’année prochaine.
 Le samedi, nous devions arriver dans l’Ain pour le goûter mais, finalement, le goûter s’est transformé en un dîner très chaleureux. Dans la voiture, Stéphane pestait: » Quelle idée de vouloir aller si loin! », « Regarde-moi tous ces abrutis qui se mettent n’importe où pour chaîner! », « C’est la dernière fois que nous rentrons un samedi! » , » L’année prochaine, on ira skier dans le Massif Central! ». Comme à l’aller, ses remarques m’agacent et finissent par me faire sortir non pas de mes chaînes mais de mes gonds. Je comprends que Stéphane soit fatigué par une si longue route. Je comprends qu’il est mal au dos, qu’il en est plein le dos. C’est moi qui lui ai fait découvrir en juin 1998 le Queyras ainsi que le Finistère qu’avec les années, il a fini par aimer autant que moi. Je suis attirée par les lieux reculés qui ont su conserver leur âme, n’ont pas été pervertis par le dieu argent. Des endroits où on rencontre des gens « normaux », des gens qui aiment la nature et ont à coeur de la préserver. Cela me désole mais le tourisme de masse est en passe de dénaturer le Finistère. A la Toussaint, à Quimper, sur la place de la cathédrale saint Corentin, une pharmacienne me disait « vous avez vu ce monde. On ne se sent plus chez nous! ». Le Queyras est encore plus difficile d’accès que le Finistère. Pour gagner Saint Véran, Ceillac ou Château-Queyras, il faut atteindre Grenoble en franchissant le col du Lautaret ou le col de l’Izoard et, de Grenoble, aller jusqu’à Briançon ou Gap et, encore, s’armer de courage pour serpenter dans la montagne.
Le samedi, nous devions arriver dans l’Ain pour le goûter mais, finalement, le goûter s’est transformé en un dîner très chaleureux. Dans la voiture, Stéphane pestait: » Quelle idée de vouloir aller si loin! », « Regarde-moi tous ces abrutis qui se mettent n’importe où pour chaîner! », « C’est la dernière fois que nous rentrons un samedi! » , » L’année prochaine, on ira skier dans le Massif Central! ». Comme à l’aller, ses remarques m’agacent et finissent par me faire sortir non pas de mes chaînes mais de mes gonds. Je comprends que Stéphane soit fatigué par une si longue route. Je comprends qu’il est mal au dos, qu’il en est plein le dos. C’est moi qui lui ai fait découvrir en juin 1998 le Queyras ainsi que le Finistère qu’avec les années, il a fini par aimer autant que moi. Je suis attirée par les lieux reculés qui ont su conserver leur âme, n’ont pas été pervertis par le dieu argent. Des endroits où on rencontre des gens « normaux », des gens qui aiment la nature et ont à coeur de la préserver. Cela me désole mais le tourisme de masse est en passe de dénaturer le Finistère. A la Toussaint, à Quimper, sur la place de la cathédrale saint Corentin, une pharmacienne me disait « vous avez vu ce monde. On ne se sent plus chez nous! ». Le Queyras est encore plus difficile d’accès que le Finistère. Pour gagner Saint Véran, Ceillac ou Château-Queyras, il faut atteindre Grenoble en franchissant le col du Lautaret ou le col de l’Izoard et, de Grenoble, aller jusqu’à Briançon ou Gap et, encore, s’armer de courage pour serpenter dans la montagne.
 Le Queyras est une région absolument magnifique. Les mélèzes, toute l’année, offre des couleurs étonnantes, surtout en automne quand leurs épines ont la couleur du caramel ou du miel. Avant la construction du village de Tignes (2100 mètres), plus tard noyé pour laisser sa place à un immense domaine skiable, Saint Véran était le plus haut village habité d’Europe (2040 mètres), « là où les coqs picorent les étoiles ». Je me sens très attachée à cette région. C’est à Saint Véran que j’ai séjourné quinze jours avec les élèves de ma classe de CM1. A l’époque, de magnifiques Saint Bernard promenaient leurs silhouettes massives dans les rues du village. Ils étaient encore utilisés pour se porter au secours des personnes ensevelies par des avalanches. Dans la rue de l’église, la rue principale, j’avais acheté des petits sujets en bois peints pour mes parents et ma soeur. Ils sont toujours dans la chambre de notre mère, dans le Gard, dans la bonne et vieille maison de Pont. Je n’ai pas oublié cette fève que j’avais avalée tout rond de peur d’avoir à choisir un roi ni cette courbe de température sur du papier millimétré que j’avais faite à l’envers ni ce moment de panique quand, dans une tempête de neige, j’avais perdu mon groupe et ne réussissais plus à percevoir les limites de la piste. Les réflexions de Stéphane me blessent car j’ai bien peu l’opportunité de quitter mon Ar-Men, de voir autre chose que les limites d’un plateau aussi beau soit-il quand le ciel se charge de couleurs africaines, que les têtes du blé mûr ondulent sous la caresse du vent ou qu’un jeune chevreuil et sa mère sont à l’arrêt sous un pommier dans les premiers feux d’un jour naissant.
Le Queyras est une région absolument magnifique. Les mélèzes, toute l’année, offre des couleurs étonnantes, surtout en automne quand leurs épines ont la couleur du caramel ou du miel. Avant la construction du village de Tignes (2100 mètres), plus tard noyé pour laisser sa place à un immense domaine skiable, Saint Véran était le plus haut village habité d’Europe (2040 mètres), « là où les coqs picorent les étoiles ». Je me sens très attachée à cette région. C’est à Saint Véran que j’ai séjourné quinze jours avec les élèves de ma classe de CM1. A l’époque, de magnifiques Saint Bernard promenaient leurs silhouettes massives dans les rues du village. Ils étaient encore utilisés pour se porter au secours des personnes ensevelies par des avalanches. Dans la rue de l’église, la rue principale, j’avais acheté des petits sujets en bois peints pour mes parents et ma soeur. Ils sont toujours dans la chambre de notre mère, dans le Gard, dans la bonne et vieille maison de Pont. Je n’ai pas oublié cette fève que j’avais avalée tout rond de peur d’avoir à choisir un roi ni cette courbe de température sur du papier millimétré que j’avais faite à l’envers ni ce moment de panique quand, dans une tempête de neige, j’avais perdu mon groupe et ne réussissais plus à percevoir les limites de la piste. Les réflexions de Stéphane me blessent car j’ai bien peu l’opportunité de quitter mon Ar-Men, de voir autre chose que les limites d’un plateau aussi beau soit-il quand le ciel se charge de couleurs africaines, que les têtes du blé mûr ondulent sous la caresse du vent ou qu’un jeune chevreuil et sa mère sont à l’arrêt sous un pommier dans les premiers feux d’un jour naissant.
 J’avais un peu d’appréhension à l’idée de retourner dans la maison de mes beaux-parents où ma belle-mère s’est lancée, un peu à son corps défendant, dans des travaux très importants. Après les travaux en Haute-Corse qui l’avaient énormément accaparée, j’espérais qu’elle pourrait enfin avoir du temps pour elle (profiter de la Balagne dans la durée, voyager avec ses petits-enfants, s’engager dans une association caritative, rencontrer de nouvelles personnes) et passerait moins en coup de vent dans le Loiret. J’avais peur de ne pas retrouver la maison. J’y ai passé de nombreux étés avec un, puis deux et enfin trois enfants. J’ai connu la maison avant la piscine, le potager, les aménagements du jardin. Sans voiture, souvent seule, j’avais imaginé toutes sortes d’histoires amusantes pour égayer notre odyssée quotidienne de la maison au coeur du village. Je sais que, lorsqu’ils seront devenus parents, nos enfants parleront à nos petits-enfants de la forêt des guillis, des grosses molaires plantées dans la terre, de la boite aux lettres aux secrets et, à l’église, au moment de Noël, du petit ange qui dit « merci » avec la tête quand on glisse une pièce dans la fente ouverte entre ses deux ailes. Nous avons tous nos névroses. L’une des miennes consiste à avoir du mal à voir les lieux que j’aime changer. J’en sais l’origine: depuis ma naissance, je n’ai presque jamais été chez moi et ai beaucoup déménagé. Je ressens un besoin fort d’ancrage et de repères. Mais, dès que j’ai franchi le seuil de la cuisine, toutes mes peurs se sont envolées. La maison est magnifique, pleine de lumière, chaleureuse. Tous ces travaux n’ont absolument pas altéré son âme. Par-dessus tout, et c’est le plus important, ma belle-mère se sent enfin bien chez elle, en accord avec son besoin de lumière et d’ouverture sur la nature.
J’avais un peu d’appréhension à l’idée de retourner dans la maison de mes beaux-parents où ma belle-mère s’est lancée, un peu à son corps défendant, dans des travaux très importants. Après les travaux en Haute-Corse qui l’avaient énormément accaparée, j’espérais qu’elle pourrait enfin avoir du temps pour elle (profiter de la Balagne dans la durée, voyager avec ses petits-enfants, s’engager dans une association caritative, rencontrer de nouvelles personnes) et passerait moins en coup de vent dans le Loiret. J’avais peur de ne pas retrouver la maison. J’y ai passé de nombreux étés avec un, puis deux et enfin trois enfants. J’ai connu la maison avant la piscine, le potager, les aménagements du jardin. Sans voiture, souvent seule, j’avais imaginé toutes sortes d’histoires amusantes pour égayer notre odyssée quotidienne de la maison au coeur du village. Je sais que, lorsqu’ils seront devenus parents, nos enfants parleront à nos petits-enfants de la forêt des guillis, des grosses molaires plantées dans la terre, de la boite aux lettres aux secrets et, à l’église, au moment de Noël, du petit ange qui dit « merci » avec la tête quand on glisse une pièce dans la fente ouverte entre ses deux ailes. Nous avons tous nos névroses. L’une des miennes consiste à avoir du mal à voir les lieux que j’aime changer. J’en sais l’origine: depuis ma naissance, je n’ai presque jamais été chez moi et ai beaucoup déménagé. Je ressens un besoin fort d’ancrage et de repères. Mais, dès que j’ai franchi le seuil de la cuisine, toutes mes peurs se sont envolées. La maison est magnifique, pleine de lumière, chaleureuse. Tous ces travaux n’ont absolument pas altéré son âme. Par-dessus tout, et c’est le plus important, ma belle-mère se sent enfin bien chez elle, en accord avec son besoin de lumière et d’ouverture sur la nature.
 Après une semaine de repas presqu’exclusivement composés de féculents, de céréales et de légumes, les enfants sont ravis de trouver, pour le dîner, deux belles pintades à la peau craquante à souhait servies avec une purée maison et des petits-pois. Le lendemain, nous restons déjeuner. C’est la fête des grands-mères. Je pense à la seule grand-mère que j’ai connue, ma grand-mère maternelle qui soufflerait ses cent bougies ce quatre mars. Une femme merveilleuse, au caractère de fer, comme la plupart des femmes nées des cendres de la première guerre mondiale et qui traverseraient toutes les horreurs du second conflit mondial. Sa volonté était inflexible. Elle n’avait peur de rien. Surdouée, venue au monde avec un don très particulier, celui de l’oreille absolue, elle était capable de jouer sans partition tout morceau de musique entendu. Pendant les presque trois années que j’ai partagées avec elle au début de mes études de droit, j’ai été immergée dans la musique classique. Je n’ai jamais oublié l’écoute qu’elle m’avait proposé du tableau final du « Dialogues des carmélites » de Poulenc. Pianiste, chanteuse lyrique, elle a, à la fin de la guerre qui lui avait pris son mari, pu entrer à l’Opéra de Paris et est devenue l’assistante des différents directeurs. C’est auprès de Georges Auric qu’elle a vécu ses plus belles années.
Après une semaine de repas presqu’exclusivement composés de féculents, de céréales et de légumes, les enfants sont ravis de trouver, pour le dîner, deux belles pintades à la peau craquante à souhait servies avec une purée maison et des petits-pois. Le lendemain, nous restons déjeuner. C’est la fête des grands-mères. Je pense à la seule grand-mère que j’ai connue, ma grand-mère maternelle qui soufflerait ses cent bougies ce quatre mars. Une femme merveilleuse, au caractère de fer, comme la plupart des femmes nées des cendres de la première guerre mondiale et qui traverseraient toutes les horreurs du second conflit mondial. Sa volonté était inflexible. Elle n’avait peur de rien. Surdouée, venue au monde avec un don très particulier, celui de l’oreille absolue, elle était capable de jouer sans partition tout morceau de musique entendu. Pendant les presque trois années que j’ai partagées avec elle au début de mes études de droit, j’ai été immergée dans la musique classique. Je n’ai jamais oublié l’écoute qu’elle m’avait proposé du tableau final du « Dialogues des carmélites » de Poulenc. Pianiste, chanteuse lyrique, elle a, à la fin de la guerre qui lui avait pris son mari, pu entrer à l’Opéra de Paris et est devenue l’assistante des différents directeurs. C’est auprès de Georges Auric qu’elle a vécu ses plus belles années.
 Le Queyras, en février, nous avait habitués à un ciel limpide, des pique-niques sur les pistes, du ski en polaire et des apéritifs à la terrasse, exposée plein sud. Un froid coupant nous saisit tous et la neige tombe en abondance. Le mercredi matin, au réveil, la neige a redessiné le paysage. Les branches des mélèzes ploient sous la neige. De belles bosses ont fait leur apparition sur les pistes. Les voitures sont presque tout à fait ensevelies sous cinquante centimètres d’une neige aussi fine et légère que du sucre glace. On se croirait au Canada. A l’aide de grande pelle, chacun déneige qui les marches qui mènent à son chalet qui le devant de son garage. Fantôme s’enfonce dans la neige jusqu’à la poitrine. Avancer dans toute cette poudreuse lui demande un très gros effort et, sous l’un de ses coussinets, une crevasse s’est réveillée. Je le sais aux petites tâches de sang qu’il laisse derrière lui. La température chute à -22°. Bientôt, je lirai que quatre sans abris se sont endormis dans un sommeil sans retour.
Le Queyras, en février, nous avait habitués à un ciel limpide, des pique-niques sur les pistes, du ski en polaire et des apéritifs à la terrasse, exposée plein sud. Un froid coupant nous saisit tous et la neige tombe en abondance. Le mercredi matin, au réveil, la neige a redessiné le paysage. Les branches des mélèzes ploient sous la neige. De belles bosses ont fait leur apparition sur les pistes. Les voitures sont presque tout à fait ensevelies sous cinquante centimètres d’une neige aussi fine et légère que du sucre glace. On se croirait au Canada. A l’aide de grande pelle, chacun déneige qui les marches qui mènent à son chalet qui le devant de son garage. Fantôme s’enfonce dans la neige jusqu’à la poitrine. Avancer dans toute cette poudreuse lui demande un très gros effort et, sous l’un de ses coussinets, une crevasse s’est réveillée. Je le sais aux petites tâches de sang qu’il laisse derrière lui. La température chute à -22°. Bientôt, je lirai que quatre sans abris se sont endormis dans un sommeil sans retour.
 Malgré le froid, nous arrivons à dévaler les pistes sur une neige absolument merveilleuse. Nous profitons de marches matinales pour admirer, dans les petits villages, les maisons traditionnelles si caractéristiques qu’elles ont été décrites dans les plus grands ouvrages d’architecture rurale. Nous ne nous lassons pas de la richesse des cadrans solaires et des phrases qui sont toujours une leçon de vie, nous appellent à la sagesse, nous invitent à vivre le temps présent, à savourer pleinement chaque instant de notre existence. Dans un restaurant, nous nous régalons d’une fondue tandis que les enfants croquent avec avidité dans leurs côtelettes d’agneau. Quand on a eu la chance de découvrir les villages des hauts plateaux andins et de l’Himalaya, on peut aisément comprendre le genre de vie que menaient les habitants du Queyras: une vie très dure en hiver, une vie de replis loin du monde faite de longues veillées au coin du feu, dans les odeurs des animaux réchauffant les chalets, avec, seulement, quelques mois de joie, du dégel aux premières neiges, des mois dédiés aux travaux des champs. Du côté maternel, un des berceaux est queyrassin. La famille Carle habitait le village de Ceillac. La vie y était si difficile en hiver que l’un de ses membres a décidé de descendre dans la vallée en tant que colporteur. J’imagine qu’il a dû longer la Durance. Ses pas l’ont mené jusqu’à un petit village gardois surplombant la Cèze. Il y est tombé amoureux d’une jeune fille et n’est plus retourné dans sa montagne natale. La femme de mon arrière-arrière grand-père, confiseur et traiteur à Pont-Saint-Esprit, se prénommait Louise Carle. Sur les daguerréotypes rangés dans la bibliothèque du petit salon, on la découvre assise sur une chaise en paille devant le pas de la porte. C’est une toute petite femme dont le corps se résume à une épure. Ses trois premiers fils sont morts bébés alors qu’ils étaient en garde chez une nourrice. Elle a mis encore au monde trois fils. Auguste, qui devait reprendre l’affaire familiale, a été tué aux Dardanelles. Son mari n’a pas supporté la mort de son fils. Sur le cliché, on devine une femme fatiguée, éprouvée par les épreuves qui ne redoute pas la mort.
Malgré le froid, nous arrivons à dévaler les pistes sur une neige absolument merveilleuse. Nous profitons de marches matinales pour admirer, dans les petits villages, les maisons traditionnelles si caractéristiques qu’elles ont été décrites dans les plus grands ouvrages d’architecture rurale. Nous ne nous lassons pas de la richesse des cadrans solaires et des phrases qui sont toujours une leçon de vie, nous appellent à la sagesse, nous invitent à vivre le temps présent, à savourer pleinement chaque instant de notre existence. Dans un restaurant, nous nous régalons d’une fondue tandis que les enfants croquent avec avidité dans leurs côtelettes d’agneau. Quand on a eu la chance de découvrir les villages des hauts plateaux andins et de l’Himalaya, on peut aisément comprendre le genre de vie que menaient les habitants du Queyras: une vie très dure en hiver, une vie de replis loin du monde faite de longues veillées au coin du feu, dans les odeurs des animaux réchauffant les chalets, avec, seulement, quelques mois de joie, du dégel aux premières neiges, des mois dédiés aux travaux des champs. Du côté maternel, un des berceaux est queyrassin. La famille Carle habitait le village de Ceillac. La vie y était si difficile en hiver que l’un de ses membres a décidé de descendre dans la vallée en tant que colporteur. J’imagine qu’il a dû longer la Durance. Ses pas l’ont mené jusqu’à un petit village gardois surplombant la Cèze. Il y est tombé amoureux d’une jeune fille et n’est plus retourné dans sa montagne natale. La femme de mon arrière-arrière grand-père, confiseur et traiteur à Pont-Saint-Esprit, se prénommait Louise Carle. Sur les daguerréotypes rangés dans la bibliothèque du petit salon, on la découvre assise sur une chaise en paille devant le pas de la porte. C’est une toute petite femme dont le corps se résume à une épure. Ses trois premiers fils sont morts bébés alors qu’ils étaient en garde chez une nourrice. Elle a mis encore au monde trois fils. Auguste, qui devait reprendre l’affaire familiale, a été tué aux Dardanelles. Son mari n’a pas supporté la mort de son fils. Sur le cliché, on devine une femme fatiguée, éprouvée par les épreuves qui ne redoute pas la mort.
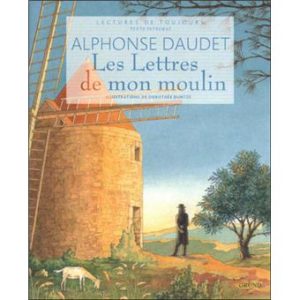 Le soir, dans la chambre toute en bois d’un chalet sorti de terre dans les années soixante-dix par la volonté de deux couples amis tombés amoureux de ce bout de montagne sauvage, je relis des « lettres de mon moulin ». Depuis l’adolescence, je me replonge régulièrement dans l’oeuvre d’Alphonse Daudet et de Guy de Maupassant. Dans ce recueil que j’avais pris pour les filles, je découvre deux textes que je ne connaissais pas « le phare des Sanguinaires » et « L’agonie de la « Sémillante » « . « La mule du Pape » me fait toujours autant sourire. « Le secret de maître Cornille » me fait monter les larmes aux yeux. Je fais toujours l’impasse sur « la chèvre de monsieur Seguin » dont j’ai récemment découvert une interprétation très particulière: la chèvre serait en réalité une enfant et monsieur Seguin son père qui la conduirait dans la montagne pour abuser d’elle… »Les Vieux » me bouleversent. C’est « les étoiles, récit d’un berger provençal » que j’ai le plus de bonheur à relire ici, dans le Queyras, où, quand les nuits sont claires, on a vraiment l’impression que les astres sont à portée de la main.
Le soir, dans la chambre toute en bois d’un chalet sorti de terre dans les années soixante-dix par la volonté de deux couples amis tombés amoureux de ce bout de montagne sauvage, je relis des « lettres de mon moulin ». Depuis l’adolescence, je me replonge régulièrement dans l’oeuvre d’Alphonse Daudet et de Guy de Maupassant. Dans ce recueil que j’avais pris pour les filles, je découvre deux textes que je ne connaissais pas « le phare des Sanguinaires » et « L’agonie de la « Sémillante » « . « La mule du Pape » me fait toujours autant sourire. « Le secret de maître Cornille » me fait monter les larmes aux yeux. Je fais toujours l’impasse sur « la chèvre de monsieur Seguin » dont j’ai récemment découvert une interprétation très particulière: la chèvre serait en réalité une enfant et monsieur Seguin son père qui la conduirait dans la montagne pour abuser d’elle… »Les Vieux » me bouleversent. C’est « les étoiles, récit d’un berger provençal » que j’ai le plus de bonheur à relire ici, dans le Queyras, où, quand les nuits sont claires, on a vraiment l’impression que les astres sont à portée de la main.
 L’an prochain, je ne sais pas si Stéphane aura le courage de reprendre la route pour affronter ce long, très long voyage qui mène à cette région vraiment magique. Dans le fond de mon coeur, déjà, je l’espère! Je vous laisse avec un extrait des « étoiles, récit d’un berger provençal » qui explique pourquoi certains, parmi nous, aiment tant la nuit. « Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu’à l’heure où nous dormons, un monde merveilleux s’éveille dans la solitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument des petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement; et il y a dans l’air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l’on entendait les branches grandir, l’herbe pousser. Le jour, c’est la vie des êtres; mais la nuit, c’est la vie des choses. Quand on n’en a pas l’habitude, ça fait peur… ».
L’an prochain, je ne sais pas si Stéphane aura le courage de reprendre la route pour affronter ce long, très long voyage qui mène à cette région vraiment magique. Dans le fond de mon coeur, déjà, je l’espère! Je vous laisse avec un extrait des « étoiles, récit d’un berger provençal » qui explique pourquoi certains, parmi nous, aiment tant la nuit. « Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu’à l’heure où nous dormons, un monde merveilleux s’éveille dans la solitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument des petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement; et il y a dans l’air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l’on entendait les branches grandir, l’herbe pousser. Le jour, c’est la vie des êtres; mais la nuit, c’est la vie des choses. Quand on n’en a pas l’habitude, ça fait peur… ».
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner




Merci Annelo, toi également