 Ce matin, je marchais seule sur le plateau. Fantôme, encore fragile, avait manqué de motivation. Stéphane, lui, était charrette pour finir avec Nicolas de répondre à de nouveaux appels à projets. En passant devant la maison de P qui a perdu M à la fin du mois de juillet, mes yeux étaient attirés par l’un des sapins en bois imaginé par Aline et Christophe pour Noël. M avait lutté si fort contre la terrible maladie qui l’avait rendue prisonnière de son corps et privée de l’usage de la parole pour voir grandir son petit-fils. Cette femme si dynamique et passionnée ne pouvait que l’observer quand elle aurait aimé l’emmener faire du vélo, lui apprendre à peindre, à prendre soin d’un jardin et d’un potager. Ce sera leur premier Noël sans M. Les fêtes sont dures à traverser quand un être cher manque à l’appel. Le premier Noël sans notre père, en 1999, je l’ai vécu avec Stéphane depuis Wanaka, sur l’ile du sud de la Nouvelle-Zélande. J’étais malade après avoir bu dans la mauvaise gourde une eau pas encore filtrée. J’avais beaucoup de fièvre. On avait remisé les tentes pour une petite chambre. Le 31 décembre, nous faisions du canyoning. J’ai rarement eu autant froid!
Ce matin, je marchais seule sur le plateau. Fantôme, encore fragile, avait manqué de motivation. Stéphane, lui, était charrette pour finir avec Nicolas de répondre à de nouveaux appels à projets. En passant devant la maison de P qui a perdu M à la fin du mois de juillet, mes yeux étaient attirés par l’un des sapins en bois imaginé par Aline et Christophe pour Noël. M avait lutté si fort contre la terrible maladie qui l’avait rendue prisonnière de son corps et privée de l’usage de la parole pour voir grandir son petit-fils. Cette femme si dynamique et passionnée ne pouvait que l’observer quand elle aurait aimé l’emmener faire du vélo, lui apprendre à peindre, à prendre soin d’un jardin et d’un potager. Ce sera leur premier Noël sans M. Les fêtes sont dures à traverser quand un être cher manque à l’appel. Le premier Noël sans notre père, en 1999, je l’ai vécu avec Stéphane depuis Wanaka, sur l’ile du sud de la Nouvelle-Zélande. J’étais malade après avoir bu dans la mauvaise gourde une eau pas encore filtrée. J’avais beaucoup de fièvre. On avait remisé les tentes pour une petite chambre. Le 31 décembre, nous faisions du canyoning. J’ai rarement eu autant froid!
 Après être passée devant la maison de Marie et de Pascal, j’avais longé celle de Muguette et je les avais imaginées Pépette et elle au chaud de la cuisine attendant Eugène pour le café. Cette année, je n’apporterai pas de jacinthes bleues à Muguette. Elle ne me dira pas qu’elle n’a pas le coeur à décorer sa maison depuis qu’André est mort. Elle ne me racontera pas comment André installait des guirlandes électriques tout autour du toit et combien le sapin était joli. J’ai pensé aux moutons que je m’étais promis d’aller voir. Depuis mars, ils sont dans une ferme pédagogique à 15 kilomètres. J’avais écrit aux propriétaires pour savoir quand on pouvait venir mais ils ne m’ont jamais répondu.
Après être passée devant la maison de Marie et de Pascal, j’avais longé celle de Muguette et je les avais imaginées Pépette et elle au chaud de la cuisine attendant Eugène pour le café. Cette année, je n’apporterai pas de jacinthes bleues à Muguette. Elle ne me dira pas qu’elle n’a pas le coeur à décorer sa maison depuis qu’André est mort. Elle ne me racontera pas comment André installait des guirlandes électriques tout autour du toit et combien le sapin était joli. J’ai pensé aux moutons que je m’étais promis d’aller voir. Depuis mars, ils sont dans une ferme pédagogique à 15 kilomètres. J’avais écrit aux propriétaires pour savoir quand on pouvait venir mais ils ne m’ont jamais répondu.

J’ai continué sur le chemin qui passe entre les champs. Tout était gris et humide. Mes semelles s’enfonçaient dans la boue et le bas de mon pantalon commençait à prendre l’eau. Mes yeux cherchaient de la beauté quelque part. Je pensais à la vie que les paysans avaient menée pendant de longs siècles. Ici, dans les années 70, on trouvait encore des fermes avec de la terre battue sur le sol. L’une des institutrices des enfants retraitée depuis 10 ans me racontait l’état de misère de certains enfants qu’elle lavait et habillait avec des vêtements propres. Comme toujours, la terre brune me renvoyait à la Grande guerre. L’un de mes amis m’avait fait part du souhait de son fils d’aller à Verdun avec lui après Noël. Verdun est un lieu très chargé et en hiver, cela doit être triste à moins d’avoir un temps de montagne froid et sec. Le grand-paternel de cet ami est revenu très affaibli du front où il avait été gazé et son plus jeune fils a été élevé par sa femme et le reste de la fratrie. Notre grand-père, lui, est resté, tout petit, quatre ans loin de son père fait prisonnier et sa mère écrivait à son mari tous les jours. Toutes les lettres sont dans la maison de Pont, dans le Gard. Auguste, l’un des oncles de notre grand-mère maternelle, est mort aux Dardanelles.
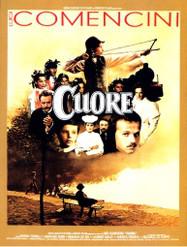 Tout en cheminant, je me rappelais cette très belle série vue avec notre père à Noël à Pont-Saint-Esprit. Elle racontait l’histoire de camarades italiens partis se battre. Le nom était Cuore devenu Les Belles Années pour la France. Elle a été réalisée par Comencini et diffusée en 1984. Le présent et le passé se croisaient et on les voyait quand ils étaient écoliers avec des instituteurs très sévères mais capables de rester après la classe pour aider un élève en difficulté. Les enfants issus des milieux bourgeois et les enfants issus de milieux moins privilégiés partageaient le même quotidien et s’aidaient beaucoup. Ainsi, un de leurs camarades ayant taché son cahier avec de l’encre car il était obligé de travailler la nuit après avoir épaulé ses parents, les autres élèves avaient trouvé un nouveau cahier et avaient tout recopié proprement. La Grande guerre faisait des enfants de bourgeois des officiers et des enfants d’artisans ou de paysans des soldats ou des conducteurs de locomotive. Dans tous les cas, ils étaient nombreux à ne pas rentrer. J’avais 15 ans quand j’ai vu cette série et elle m’a profondément marquée car je suis très sensible aux injustices sociales et à cette forme de déterminisme qui a longtemps fait qu’on ne pouvait pas aspirer à une vie meilleure. Malheureusement, cela recommence et c’est révoltant! Céleste avait ainsi deux camarades qui partaient en première année de médecine à Tours. La première était la fille d’un psychiatre et la seconde avait des parents qui ne pouvaient pas l’aider. La première avait cette chance inouïe de pouvoir ne penser qu’à ses études. La seconde avait dû faire un emprunt et avait un petit travail. Les deux jeunes filles ont réussi! La maman de la première, première de sa fratrie a pouvoir aller au lycée en Kabylie, s’efforçait de venir en aide à la seconde.
Tout en cheminant, je me rappelais cette très belle série vue avec notre père à Noël à Pont-Saint-Esprit. Elle racontait l’histoire de camarades italiens partis se battre. Le nom était Cuore devenu Les Belles Années pour la France. Elle a été réalisée par Comencini et diffusée en 1984. Le présent et le passé se croisaient et on les voyait quand ils étaient écoliers avec des instituteurs très sévères mais capables de rester après la classe pour aider un élève en difficulté. Les enfants issus des milieux bourgeois et les enfants issus de milieux moins privilégiés partageaient le même quotidien et s’aidaient beaucoup. Ainsi, un de leurs camarades ayant taché son cahier avec de l’encre car il était obligé de travailler la nuit après avoir épaulé ses parents, les autres élèves avaient trouvé un nouveau cahier et avaient tout recopié proprement. La Grande guerre faisait des enfants de bourgeois des officiers et des enfants d’artisans ou de paysans des soldats ou des conducteurs de locomotive. Dans tous les cas, ils étaient nombreux à ne pas rentrer. J’avais 15 ans quand j’ai vu cette série et elle m’a profondément marquée car je suis très sensible aux injustices sociales et à cette forme de déterminisme qui a longtemps fait qu’on ne pouvait pas aspirer à une vie meilleure. Malheureusement, cela recommence et c’est révoltant! Céleste avait ainsi deux camarades qui partaient en première année de médecine à Tours. La première était la fille d’un psychiatre et la seconde avait des parents qui ne pouvaient pas l’aider. La première avait cette chance inouïe de pouvoir ne penser qu’à ses études. La seconde avait dû faire un emprunt et avait un petit travail. Les deux jeunes filles ont réussi! La maman de la première, première de sa fratrie a pouvoir aller au lycée en Kabylie, s’efforçait de venir en aide à la seconde.
 Je cheminais avec toutes ces pensées et continuais de chercher un éclat de beauté dans un paysage triste. Je pensais rentrer bredouille quand un chevreuil est passé devant moi. La beauté avait brutalement surgi! En rentrant à la maison, j’ai retrouvé des cartes postales des univers imaginés par Mathilde Bossé et que j’avais découvert en 2016 lors d’un marché de Noël dans la maison de F, propriétaire de la ferme de la Rougerie. Aline et Christophe y exposaient leurs jeux en bois. Un feu crépitait dans la cheminée. L’ambiance était très agréable. Aux beaux jours, on pouvait louer la yourte ou la cabane dans les bois. Et puis, le mari de F avait fait le choix de remplacer le maire, mort en cours de mandat, et il avait cessé de seconder sa femme dans ses projets. Il avait rempilé pour un second mandant s’investissant de plus en plus dans sa vie d’élu. F avait manqué d’énergie pour faire vivre leur maison seule. Je me suis demandée ce que Mathilde Bossé était devenue. Elle imagine la vie d’une famille d’araignées. C’est une conteuse. Elle créé des univers fabuleux dans des armoires où tout est fait main. Je lui ai écrit pour prendre de ses nouvelles. Le Covid a fait tant de mal!
Je cheminais avec toutes ces pensées et continuais de chercher un éclat de beauté dans un paysage triste. Je pensais rentrer bredouille quand un chevreuil est passé devant moi. La beauté avait brutalement surgi! En rentrant à la maison, j’ai retrouvé des cartes postales des univers imaginés par Mathilde Bossé et que j’avais découvert en 2016 lors d’un marché de Noël dans la maison de F, propriétaire de la ferme de la Rougerie. Aline et Christophe y exposaient leurs jeux en bois. Un feu crépitait dans la cheminée. L’ambiance était très agréable. Aux beaux jours, on pouvait louer la yourte ou la cabane dans les bois. Et puis, le mari de F avait fait le choix de remplacer le maire, mort en cours de mandat, et il avait cessé de seconder sa femme dans ses projets. Il avait rempilé pour un second mandant s’investissant de plus en plus dans sa vie d’élu. F avait manqué d’énergie pour faire vivre leur maison seule. Je me suis demandée ce que Mathilde Bossé était devenue. Elle imagine la vie d’une famille d’araignées. C’est une conteuse. Elle créé des univers fabuleux dans des armoires où tout est fait main. Je lui ai écrit pour prendre de ses nouvelles. Le Covid a fait tant de mal!
 Dans quelques jours, je serai à Paris et aurai la joie d’emmener notre petite nièce découvrir l’exposition que le musée du quai Branly consacre aux kimonos. Très récemment, Victoire et moi avions beaucoup aimé l’exposition Black Indians. Nous irons aussi prendre un bain dans les années 80 au MAD et écouter les chants des animaux à la philarmonie de Paris. Je vais profiter de ma soeur et de ses enfants. Céleste, elle, travaillera à la maison de retraite. C’est dommage mais, au moins, dimanche matin, je pourrai l’accompagner jusqu’à la gare de Saint Lazare car le métro n’est pas très rassurant à 7 heures du matin! Je verrai aussi notre maman avec laquelle j’irai au Louvre découvrir les splendeurs des oasis d’Ouzbékistan. L’IMA consacre également une exposition à ce pays d’Asie Centrale où nous avions le projet d’aller au printemps de cette année. L’un de nos cousins y est en poste. Bien sûr, nous irons rêver devant les vitrines de Noël tout en sachant que ce Noël sera compliqué pour tant de familles. J’ai participé aux collectes du Secours catholique, de la Banque alimentaire, du Secours populaire et des Restaurants du coeur. J’achète toujours des couches pour les bébés, des chocolats pour les enfants et des boites de saucisses aux lentilles car c’est chaud, nourrissant et sain.
Dans quelques jours, je serai à Paris et aurai la joie d’emmener notre petite nièce découvrir l’exposition que le musée du quai Branly consacre aux kimonos. Très récemment, Victoire et moi avions beaucoup aimé l’exposition Black Indians. Nous irons aussi prendre un bain dans les années 80 au MAD et écouter les chants des animaux à la philarmonie de Paris. Je vais profiter de ma soeur et de ses enfants. Céleste, elle, travaillera à la maison de retraite. C’est dommage mais, au moins, dimanche matin, je pourrai l’accompagner jusqu’à la gare de Saint Lazare car le métro n’est pas très rassurant à 7 heures du matin! Je verrai aussi notre maman avec laquelle j’irai au Louvre découvrir les splendeurs des oasis d’Ouzbékistan. L’IMA consacre également une exposition à ce pays d’Asie Centrale où nous avions le projet d’aller au printemps de cette année. L’un de nos cousins y est en poste. Bien sûr, nous irons rêver devant les vitrines de Noël tout en sachant que ce Noël sera compliqué pour tant de familles. J’ai participé aux collectes du Secours catholique, de la Banque alimentaire, du Secours populaire et des Restaurants du coeur. J’achète toujours des couches pour les bébés, des chocolats pour les enfants et des boites de saucisses aux lentilles car c’est chaud, nourrissant et sain.
 Ce matin, par hasard, grâce à la chronique de Jérôme Garcin, de l’Obs, j’ai découvert l’existence d’Edith Bruck, écrivain née en Hongrie en 1931, déportée avec tous les siens, devenue italienne et qui a noué avec le pape François une amitié profonde. La manière dont elle a témoigné dans Le pain perdu de ce qu’elle avait vécu à Auschwitz fait qu’elle est souvent comparée à Primo Levi. La lecture de Si j’étais un homme quand j’étais étudiante et deuxième année de droit m’a marquée. Ce livre m’avait été prêté par Franck, un garçon curieux qui se promenait toujours avec de nombreux livres dans son sac à dos. Edith Bruck vient d’écrire un livre C’est moi, François dans lequel elle fait part de cette amitié avec le pape François. Voici ce que Jérôme Garcin écrivait: « Le livre a tellement ému le Saint-Père qu’il a souhaité la rencontrer. Tout de blanc vêtu, il est arrivé avec deux cadeaux : une petite menora et un « gigantesque » Talmud. Il a d’abord dit « pardon », avant d’ajouter : « Je voudrais vous demander pardon à vous et au peuple juif, martyr de la Shoah. » Edith Bruck a eu le sentiment d’être envahie par une « chaleur blanche ». Tout en partageant un gâteau à la ricotta, il l’a interrogée sur sa déportation, elle lui a fait part de ses doutes, il lui a murmuré : « Dieu est une recherche constante. »
Ce matin, par hasard, grâce à la chronique de Jérôme Garcin, de l’Obs, j’ai découvert l’existence d’Edith Bruck, écrivain née en Hongrie en 1931, déportée avec tous les siens, devenue italienne et qui a noué avec le pape François une amitié profonde. La manière dont elle a témoigné dans Le pain perdu de ce qu’elle avait vécu à Auschwitz fait qu’elle est souvent comparée à Primo Levi. La lecture de Si j’étais un homme quand j’étais étudiante et deuxième année de droit m’a marquée. Ce livre m’avait été prêté par Franck, un garçon curieux qui se promenait toujours avec de nombreux livres dans son sac à dos. Edith Bruck vient d’écrire un livre C’est moi, François dans lequel elle fait part de cette amitié avec le pape François. Voici ce que Jérôme Garcin écrivait: « Le livre a tellement ému le Saint-Père qu’il a souhaité la rencontrer. Tout de blanc vêtu, il est arrivé avec deux cadeaux : une petite menora et un « gigantesque » Talmud. Il a d’abord dit « pardon », avant d’ajouter : « Je voudrais vous demander pardon à vous et au peuple juif, martyr de la Shoah. » Edith Bruck a eu le sentiment d’être envahie par une « chaleur blanche ». Tout en partageant un gâteau à la ricotta, il l’a interrogée sur sa déportation, elle lui a fait part de ses doutes, il lui a murmuré : « Dieu est une recherche constante. »
Depuis ce jour, ils se téléphonent, prient l’un pour l’autre, se soucient l’un de l’autre. « Comment va votre genou ? », lui demande souvent cette éternelle orpheline qui rêverait d’être adoptée par l’homme en blanc, au regard si bon. Non sans une troublante culpabilité : « Est-ce que moi, juive, je peux éprouver un amour immédiat pour le plus grand représentant de ceux qui, pendant des millénaires, nous ont persécutés ? » Le 27 janvier dernier, Edith Bruck est allée embrasser, en pleurant, le pape au Vatican. Elle l’appelle désormais « ma barbe à papa ». Il lui a offert, pareille au talit que son père portait à la synagogue, une longue écharpe en laine. Elle était d’un « blanc aveuglant ».
 Victoire est allée voir Simone avec Lucie. Elles sont sorties du film très émues. Victoire m’a dit que le film évoquait plus le passé de rescapée de la mort de Simone Veil que son parcours de militante pour les droits des femmes et la construction d’une Europe unie. Stéphane lui a offert qu’ils regardent ensemble La vie est belle. Leur professeur d’histoire a projeté à sa classe Nuit et brouillard d’Alain Resnais avec la voix de Michel Bouquet. Je ne le verrai jamais. Notre histoire familiale nous rend ultra sensible s’agissant de la déportation. Je viens de commencer la lecture de Viktor E. Frankl Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie. Professeur de neurologie et de psychiatrie à la faculté de médecine de Vienne, Viktor E. Frankl fut l’élève de Freud et d’Adler. Son expérience des camps lui a permis de comprendre l’importance de trouver un sens à sa vie pour avoir l’envie et le courage de continuer. La logothérapie a révolutionné la psychothérapie et je n’avais jamais entendu parler de ce monsieur avant que l’un des couples qui anime le groupe de l’aumônerie des lycéens me dise avoir envoyé ses enfants à une logothérapeute lyonnaise fabuleuse: Martine Salleron. Quand j’aurai fini le livre, je vous en parlerai.
Victoire est allée voir Simone avec Lucie. Elles sont sorties du film très émues. Victoire m’a dit que le film évoquait plus le passé de rescapée de la mort de Simone Veil que son parcours de militante pour les droits des femmes et la construction d’une Europe unie. Stéphane lui a offert qu’ils regardent ensemble La vie est belle. Leur professeur d’histoire a projeté à sa classe Nuit et brouillard d’Alain Resnais avec la voix de Michel Bouquet. Je ne le verrai jamais. Notre histoire familiale nous rend ultra sensible s’agissant de la déportation. Je viens de commencer la lecture de Viktor E. Frankl Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie. Professeur de neurologie et de psychiatrie à la faculté de médecine de Vienne, Viktor E. Frankl fut l’élève de Freud et d’Adler. Son expérience des camps lui a permis de comprendre l’importance de trouver un sens à sa vie pour avoir l’envie et le courage de continuer. La logothérapie a révolutionné la psychothérapie et je n’avais jamais entendu parler de ce monsieur avant que l’un des couples qui anime le groupe de l’aumônerie des lycéens me dise avoir envoyé ses enfants à une logothérapeute lyonnaise fabuleuse: Martine Salleron. Quand j’aurai fini le livre, je vous en parlerai.
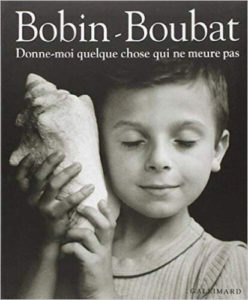 Dimanche, ce sera le deuxième dimanche de l’Avent. Je termine ma chronique avec une phrase de Christian Bobin extraite du premier livre que j’ai lu grâce à Constance Le Très-Bas: « Plus il aime et plus il se connaît indigne d’aimer. C’est qu’il n’y a pas de progrès en amour, pas de perfection que l’on pourrait un jour atteindre. Il n’y a pas d’amour adulte, mûr et raisonnable. Il n’y a devant l’amour aucun adulte, que des enfants, que cet esprit d’enfance qui est abandon, insouciance, esprit de la perte d’esprit. L’âge additionne. L’expérience accumule.La raison construit. L’esprit d’enfance est toujours neuf, repart toujours aux débuts du monde, aux premiers pas de l’amour. » Christian Bobin était un homme tout à fait à part et parfaitement inclassable. Par certains côtés, il peut faire penser à François Cheng. Il a collaboré avec Edouard Boubat et était très proche de Lydie Dattas. Une très belle âme s’est réveillée dans la lumière de l’éternité.
Dimanche, ce sera le deuxième dimanche de l’Avent. Je termine ma chronique avec une phrase de Christian Bobin extraite du premier livre que j’ai lu grâce à Constance Le Très-Bas: « Plus il aime et plus il se connaît indigne d’aimer. C’est qu’il n’y a pas de progrès en amour, pas de perfection que l’on pourrait un jour atteindre. Il n’y a pas d’amour adulte, mûr et raisonnable. Il n’y a devant l’amour aucun adulte, que des enfants, que cet esprit d’enfance qui est abandon, insouciance, esprit de la perte d’esprit. L’âge additionne. L’expérience accumule.La raison construit. L’esprit d’enfance est toujours neuf, repart toujours aux débuts du monde, aux premiers pas de l’amour. » Christian Bobin était un homme tout à fait à part et parfaitement inclassable. Par certains côtés, il peut faire penser à François Cheng. Il a collaboré avec Edouard Boubat et était très proche de Lydie Dattas. Une très belle âme s’est réveillée dans la lumière de l’éternité.
 Bonne semaine!
Bonne semaine!
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner



