 J’écris cette chronique sur la première page d’un ravissant cahier qu’une amie a eu la gentillesse de m’offrir à l’occasion de notre scorpionnade[1] de trois jours (son Adèle est aussi née voici un an sous le signe du scorpion le 31 octobre le même jour que ma première nièce Margot). Sur cette première page de ce cahier comme je les affectionne, avec des lignes horizontales, sans carreaux pour ne pas emprisonner la pensée, offert pour m’encourager à entrer dans ce projet d’écriture, mon premier roman dont le titre pourrait être, tant j’ai été choquée que l’un des succès éditoriaux de cette année s’intitule « la femme parfaite est une connasse » et que Canal + ait jugé élégant de demander à une comédienne, très talentueuse au demeurant, d’être la parfaite connasse de service, « le club des incorrigibles parfaites non connasses » se trouve une citation de François de La Rochefoucauld « le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter ».
J’écris cette chronique sur la première page d’un ravissant cahier qu’une amie a eu la gentillesse de m’offrir à l’occasion de notre scorpionnade[1] de trois jours (son Adèle est aussi née voici un an sous le signe du scorpion le 31 octobre le même jour que ma première nièce Margot). Sur cette première page de ce cahier comme je les affectionne, avec des lignes horizontales, sans carreaux pour ne pas emprisonner la pensée, offert pour m’encourager à entrer dans ce projet d’écriture, mon premier roman dont le titre pourrait être, tant j’ai été choquée que l’un des succès éditoriaux de cette année s’intitule « la femme parfaite est une connasse » et que Canal + ait jugé élégant de demander à une comédienne, très talentueuse au demeurant, d’être la parfaite connasse de service, « le club des incorrigibles parfaites non connasses » se trouve une citation de François de La Rochefoucauld « le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter ».
 Cette phrase résonne en moi fortement. A 44 ans depuis peu, je sais que je n’ai pas eu (c’est un cadeau de la vie inégalable) à chercher le bonheur. Il était là dés la première respiration comme si on était venus me déposer au début du chemin, du « buen camino » comme on dit sur les routes du pèlerinage qui conduit à Saint-Jacques de Compostelle. Cela ne veut pas dire que le parcours a été simple, loin s’en faut, et, très récemment, j’ai chaussé les crampons, sorti les cordes et franchi un sommet, mon K2 personnel, que j’ai craint de ne jamais atteindre. Je n’ai jamais autant cherché mon souffle, ne suis jamais autant entrée en moi-même pour y puiser les ressources nécessaires pour y arriver. En même temps, je n’avais pas le choix : soit je réussissais soit je dévissais !
Cette phrase résonne en moi fortement. A 44 ans depuis peu, je sais que je n’ai pas eu (c’est un cadeau de la vie inégalable) à chercher le bonheur. Il était là dés la première respiration comme si on était venus me déposer au début du chemin, du « buen camino » comme on dit sur les routes du pèlerinage qui conduit à Saint-Jacques de Compostelle. Cela ne veut pas dire que le parcours a été simple, loin s’en faut, et, très récemment, j’ai chaussé les crampons, sorti les cordes et franchi un sommet, mon K2 personnel, que j’ai craint de ne jamais atteindre. Je n’ai jamais autant cherché mon souffle, ne suis jamais autant entrée en moi-même pour y puiser les ressources nécessaires pour y arriver. En même temps, je n’avais pas le choix : soit je réussissais soit je dévissais !
 C’était d’autant plus violent que remontaient des abîmes tels que les a décrits si puissamment Laurent Gaudé dans « la porte des enfers » les deuils non vécus car impossibles, les morts symboliques, les départs et plus précisément celui d’une unique sœur par le sang emportant avec elle la fin des rêves de grandes réunions familiales, de ces messes qu’on voudrait parfaite et qui, à notre corps défendant, virent à « la bûche » façon Danielle Thompson tant nos sensibilités se heurtent ou alors parce que l’amour est trop fort et complexes les retrouvailles entre ceux qui n’ont pas d’autre choix que de projeter tout leur être dans la construction au présent de leur avenir et ceux qui n’en ont pas d’autre que de vivre dans les trois époques du temps qui ne fait plus qu’un, passé, présent, futur enlacés dans une danse tourbillonnante.
C’était d’autant plus violent que remontaient des abîmes tels que les a décrits si puissamment Laurent Gaudé dans « la porte des enfers » les deuils non vécus car impossibles, les morts symboliques, les départs et plus précisément celui d’une unique sœur par le sang emportant avec elle la fin des rêves de grandes réunions familiales, de ces messes qu’on voudrait parfaite et qui, à notre corps défendant, virent à « la bûche » façon Danielle Thompson tant nos sensibilités se heurtent ou alors parce que l’amour est trop fort et complexes les retrouvailles entre ceux qui n’ont pas d’autre choix que de projeter tout leur être dans la construction au présent de leur avenir et ceux qui n’en ont pas d’autre que de vivre dans les trois époques du temps qui ne fait plus qu’un, passé, présent, futur enlacés dans une danse tourbillonnante.
 Dans la nuit du samedi 9 novembre, debout sur une chaise, habillée telle Liza Minelli prêtant sa voix et sa silhouette ondulante à Sally Bowles et capable de chanter « Willkommen, bienvenue, welcome ! Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée, happy to see you, bleibe, reste, stay ! Wir sagen Willcommen, bienvenue, welcome, in cabaret, au cabaret, to cabaret ! » entourée de trois scorpions de choc, deux femmes et un homme, que j’aime profondément, qui tous trois rendent mon quotidien meilleur, réussissent par leur délicatesse, leur présence à alléger le fardeau quand il est trop lourd, je me suis adressée à une assemblée de 70 personnes qui nous pressaient de prendre la parole. Le planteur était passé par là si bien que je n’avais pas le trac et que mon émotion ne se trahissait pas dans le timbre de ma voix. Je leur ai dit que voici 8 ans, j’avais pleuré en arrivant au milieu des champs de maïs réussissant à pousser dans une terre aussi dure que les silex sur lesquels notre chien s’entaille les coussinets, que j’avais souffert de me sentir prisonnière d’une voiture quand j’aimais tant marcher dans Paris des heures durant jusqu’à en avoir les pieds aussi malmenés que ceux de la danseuse qui évolue en équilibre sur ses pointes, que j’avais cru perdre la raison quand j’avais cessé de donner mes cours, que j’avais fait l’expérience de la solitude subie quand mon mari avait décidé de tenter sa chance en Roumanie, pays encore très inhospitalier après le long règne des Ceausescu et que c’était toujours le cœur gros et lourd qu’il quittait son foyer, sa famille, pour monter dans un avion qui le déposerait à Budapest et de Budapest prendrait place dans un train qui mettrait au moins 7 heures à rejoindre Cluj-Napoca, la première ville étudiante du pays et que tant que la Roumanie ne serait pas entrée dans l’Union européenne, son associé et lui auraient à essuyer les contrôles musclés des douaniers hongrois et roumains.
Dans la nuit du samedi 9 novembre, debout sur une chaise, habillée telle Liza Minelli prêtant sa voix et sa silhouette ondulante à Sally Bowles et capable de chanter « Willkommen, bienvenue, welcome ! Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée, happy to see you, bleibe, reste, stay ! Wir sagen Willcommen, bienvenue, welcome, in cabaret, au cabaret, to cabaret ! » entourée de trois scorpions de choc, deux femmes et un homme, que j’aime profondément, qui tous trois rendent mon quotidien meilleur, réussissent par leur délicatesse, leur présence à alléger le fardeau quand il est trop lourd, je me suis adressée à une assemblée de 70 personnes qui nous pressaient de prendre la parole. Le planteur était passé par là si bien que je n’avais pas le trac et que mon émotion ne se trahissait pas dans le timbre de ma voix. Je leur ai dit que voici 8 ans, j’avais pleuré en arrivant au milieu des champs de maïs réussissant à pousser dans une terre aussi dure que les silex sur lesquels notre chien s’entaille les coussinets, que j’avais souffert de me sentir prisonnière d’une voiture quand j’aimais tant marcher dans Paris des heures durant jusqu’à en avoir les pieds aussi malmenés que ceux de la danseuse qui évolue en équilibre sur ses pointes, que j’avais cru perdre la raison quand j’avais cessé de donner mes cours, que j’avais fait l’expérience de la solitude subie quand mon mari avait décidé de tenter sa chance en Roumanie, pays encore très inhospitalier après le long règne des Ceausescu et que c’était toujours le cœur gros et lourd qu’il quittait son foyer, sa famille, pour monter dans un avion qui le déposerait à Budapest et de Budapest prendrait place dans un train qui mettrait au moins 7 heures à rejoindre Cluj-Napoca, la première ville étudiante du pays et que tant que la Roumanie ne serait pas entrée dans l’Union européenne, son associé et lui auraient à essuyer les contrôles musclés des douaniers hongrois et roumains.
 A cette époque, les filles avaient respectivement 2 ans et demi et un an. Je me désespérais de boucler un jour cette thèse deux fois déjà arrêtée et dans laquelle je pataugeais à qui mieux mieux depuis de trop longues années subissant les réformes de la loi relative au don des éléments et des produits du corps humain, lisant, jusqu’à l’écoeurement des rapports de missions parlementaires ! Le matin, je déposais les filles à la crèche et le soir je les récupérais. Entre ces deux temps forts, j’évoluais entre les dons du vivant de la personne tels les dons de rein, de sang, de sperme, d’ovule et les dons post mortem. J’essayais de comprendre comment il serait possible d’imaginer une nouvelle catégorie juridique pour ces éléments et ces produits issus du corps humain qui ne seraient ni des personnes ni des choses mais une catégorie sui generis dont on ferait découler un régime protecteur. Il me semblait fondamental que soit préservée l’essence humaine de ces éléments et de ces produits que le principe de l’anonymat permettait d’oublier. Maintenant, alors qu’on envisage, un jour, de laisser des femmes prêter leur utérus à d’autres le temps d’une grossesse qui ne sera bientôt plus qu’une gestation, et avant l’ultime étape, celle de l’utérus artificiel, je me dis que je perdais mon temps !
A cette époque, les filles avaient respectivement 2 ans et demi et un an. Je me désespérais de boucler un jour cette thèse deux fois déjà arrêtée et dans laquelle je pataugeais à qui mieux mieux depuis de trop longues années subissant les réformes de la loi relative au don des éléments et des produits du corps humain, lisant, jusqu’à l’écoeurement des rapports de missions parlementaires ! Le matin, je déposais les filles à la crèche et le soir je les récupérais. Entre ces deux temps forts, j’évoluais entre les dons du vivant de la personne tels les dons de rein, de sang, de sperme, d’ovule et les dons post mortem. J’essayais de comprendre comment il serait possible d’imaginer une nouvelle catégorie juridique pour ces éléments et ces produits issus du corps humain qui ne seraient ni des personnes ni des choses mais une catégorie sui generis dont on ferait découler un régime protecteur. Il me semblait fondamental que soit préservée l’essence humaine de ces éléments et de ces produits que le principe de l’anonymat permettait d’oublier. Maintenant, alors qu’on envisage, un jour, de laisser des femmes prêter leur utérus à d’autres le temps d’une grossesse qui ne sera bientôt plus qu’une gestation, et avant l’ultime étape, celle de l’utérus artificiel, je me dis que je perdais mon temps !
 Bien sûr, samedi 9 novembre, debout sur ma chaise, je ne me suis pas lancée dans un cours sur l’éthique médicale et je ne leur ai pas davantage dit que je m’étais mise à me parler à moi-même comme le faisait notre grand-mère dans les années qui avaient suivi sa retraite de l’Opéra de Paris. Elevée par une mère qui doit avoir du sang anglais, je n’aime pas partager mes petits malheurs et mes grandes douleurs et alors que la sage-femme finissait ses travaux d’aiguille à vif après la naissance de notre seconde fille, je l’interrogeais sur ses recettes de petits gâteaux de Noël car j’avais compris qu’elle était une Alsacienne expatriée dans le Gard. Une manière comme une autre de penser à autre chose. J’étais déjà sophrologue sans le savoir !
Bien sûr, samedi 9 novembre, debout sur ma chaise, je ne me suis pas lancée dans un cours sur l’éthique médicale et je ne leur ai pas davantage dit que je m’étais mise à me parler à moi-même comme le faisait notre grand-mère dans les années qui avaient suivi sa retraite de l’Opéra de Paris. Elevée par une mère qui doit avoir du sang anglais, je n’aime pas partager mes petits malheurs et mes grandes douleurs et alors que la sage-femme finissait ses travaux d’aiguille à vif après la naissance de notre seconde fille, je l’interrogeais sur ses recettes de petits gâteaux de Noël car j’avais compris qu’elle était une Alsacienne expatriée dans le Gard. Une manière comme une autre de penser à autre chose. J’étais déjà sophrologue sans le savoir !
 Debout, dans le scintillement des lumières, j’ai exprimé mon attachement aux êtres qui ont, finalement, décidé de m’accepter, moi, la « hors cadre », la « pas vraiment comme les autres », la nomade, la sans racines, hormis un bout de terre breton et une vieille maison de famille gardoise, qui aime tant les peuples voyageurs, rêve de découvrir l’Irlande en famille à bord d’une roulotte tirée par de bons chevaux de labour, d’en profiter pour aller saluer Michel Déon dans sa retraite avant qu’il ne soit définitivement lassé des poneys, du bourbon, des rentrées solennelles de l’Académie, des salons littéraires et des admiratrices, de faire la connaissance de Lydie Dattas, l’orfèvre des mots et de son ex-mari, Alexandre Romanès né Bouglione, père du premier cirque tzigane d’Europe et merveilleux poète. Est-ce parce qu’il m’a semblé ne pas avoir de chez moi, de vivre dans les cartons que j’ai développé cette passion pour les Tziganes, les Touaregs, les peuples pour lesquels le concept de frontière est inique ? Mais, à la différence des gens du voyage, j’aspirais à me sédentariser et chaque nouveau départ était vécu comme un déracinement. Je n’avais pas la chance d’avoir leur culture, d’être venue au monde avec des ailes accrochées au-dessus des omoplates, de ne pas m’attacher à autre chose qu’à mon clan, ma famille élargie.
Debout, dans le scintillement des lumières, j’ai exprimé mon attachement aux êtres qui ont, finalement, décidé de m’accepter, moi, la « hors cadre », la « pas vraiment comme les autres », la nomade, la sans racines, hormis un bout de terre breton et une vieille maison de famille gardoise, qui aime tant les peuples voyageurs, rêve de découvrir l’Irlande en famille à bord d’une roulotte tirée par de bons chevaux de labour, d’en profiter pour aller saluer Michel Déon dans sa retraite avant qu’il ne soit définitivement lassé des poneys, du bourbon, des rentrées solennelles de l’Académie, des salons littéraires et des admiratrices, de faire la connaissance de Lydie Dattas, l’orfèvre des mots et de son ex-mari, Alexandre Romanès né Bouglione, père du premier cirque tzigane d’Europe et merveilleux poète. Est-ce parce qu’il m’a semblé ne pas avoir de chez moi, de vivre dans les cartons que j’ai développé cette passion pour les Tziganes, les Touaregs, les peuples pour lesquels le concept de frontière est inique ? Mais, à la différence des gens du voyage, j’aspirais à me sédentariser et chaque nouveau départ était vécu comme un déracinement. Je n’avais pas la chance d’avoir leur culture, d’être venue au monde avec des ailes accrochées au-dessus des omoplates, de ne pas m’attacher à autre chose qu’à mon clan, ma famille élargie.
 Debout, devant cette assemblée comme je les aime dans laquelle les êtres ont des parcours de vie, parfois, radicalement opposés où l’avocat côtoie le cuisinier, la jeune moscovite le franco-américain, la réalisatrice de documentaires l’assistante maternelle agréée, où tous les êtres issus d’histoires différentes sont unis par la même l’ouverture d’esprit, la gentillesse et un respect profond pour l’autre, j’étais heureuse d’annoncer solennellement qu’il faudrait désormais compter avec moi et accepter de me voir vieillir car je posais mes bagages, allais offrir à nos enfants ce que ma sœur et moi n’avons pas connu : un berceau, des amis dans la durée et un tremplin pour partir à la conquête du monde tant il est vrai qu’il est plus facile de s’en aller quand on sait pouvoir revenir dans un endroit aux contours réconfortants. J’imagine nos enfants devenus parents à leur tour, partis, qui sait, vivre en Nouvelle-Zélande, dans le Finistère ou en Corse, revenant voir la maison de leur enfance et se promenant avec leurs propres enfants sur ce chemin que nous avons emprunté des milliers de fois et émus à la vue du vieux noyer, de la mare qui se couvre de nénuphars au printemps, des colombes s’envolant toujours de ce jardin perdu au milieu des champs et des moutons du gîte du Javot où nous étions réunis.
Debout, devant cette assemblée comme je les aime dans laquelle les êtres ont des parcours de vie, parfois, radicalement opposés où l’avocat côtoie le cuisinier, la jeune moscovite le franco-américain, la réalisatrice de documentaires l’assistante maternelle agréée, où tous les êtres issus d’histoires différentes sont unis par la même l’ouverture d’esprit, la gentillesse et un respect profond pour l’autre, j’étais heureuse d’annoncer solennellement qu’il faudrait désormais compter avec moi et accepter de me voir vieillir car je posais mes bagages, allais offrir à nos enfants ce que ma sœur et moi n’avons pas connu : un berceau, des amis dans la durée et un tremplin pour partir à la conquête du monde tant il est vrai qu’il est plus facile de s’en aller quand on sait pouvoir revenir dans un endroit aux contours réconfortants. J’imagine nos enfants devenus parents à leur tour, partis, qui sait, vivre en Nouvelle-Zélande, dans le Finistère ou en Corse, revenant voir la maison de leur enfance et se promenant avec leurs propres enfants sur ce chemin que nous avons emprunté des milliers de fois et émus à la vue du vieux noyer, de la mare qui se couvre de nénuphars au printemps, des colombes s’envolant toujours de ce jardin perdu au milieu des champs et des moutons du gîte du Javot où nous étions réunis.
 Dans la voiture, le 11 au soir, les enfants fatigués m’ont demandé si j’avais vécu là mon plus bel anniversaire et sans une once d’hésitation, je leur ai répondu « oui ! ». Cette chronique est dédiée à tous ces êtres merveilleux que j’ai rencontrés ici, qui m’ont fait l’honneur de me regarder comme une amie et que j’aime avec la fidélité granitique qui caractérise certains bretons !
Dans la voiture, le 11 au soir, les enfants fatigués m’ont demandé si j’avais vécu là mon plus bel anniversaire et sans une once d’hésitation, je leur ai répondu « oui ! ». Cette chronique est dédiée à tous ces êtres merveilleux que j’ai rencontrés ici, qui m’ont fait l’honneur de me regarder comme une amie et que j’aime avec la fidélité granitique qui caractérise certains bretons !
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner


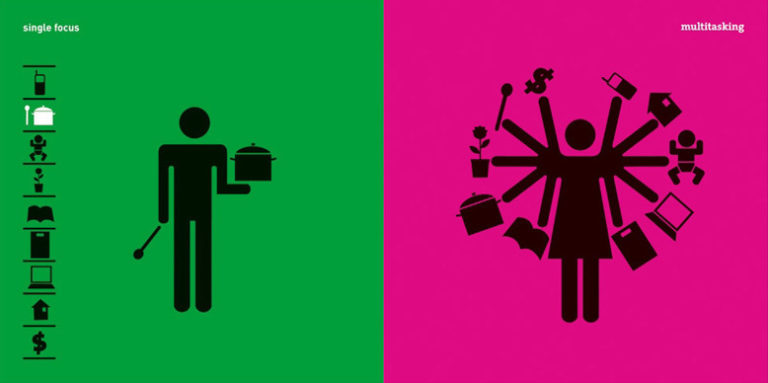
Bonsoir, je découvre avec beaucoup de plaisir votre blog et me régale en lisant vos deniers écrits. J’aime beaucoup votre plume et m’abonne sans tarder au fil de discussion. A très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. Séverine