Ma passion pour les cartes postales est née dans l’enfance et ne s’est jamais démentie. Si ma mémoire est bonne, la première fois que j’ai reçu une carte, c’était pour mon troisième anniversaire. Elle représentait une superbe vache, à la robe chocolat et aux yeux bleus, ourlés de cils aussi longs que ceux d’Elizabeth Taylor dans « Cléopâtre ». Quand on pressait son ventre mou, un « meuh » vigoureux se faisait entendre. Je l’ai toujours. Elle est rangée dans une de ces nombreuses boites à chaussures transformées en boites à trésors.
Pour assouvir ma passion, j’ai passé des centaines d’heures à faire tourner les portants métalliques de certaines librairies papeteries de la rue Soufflot, de la rue des Ecoles ou du boulevard Saint Germain. J’en ai laissé filer, aussi, des métros et des RER, à la station Châtelet-Les Halles, incapable que j’étais de m’arracher à une toute petite boutique remarquablement bien fournie en cartes postales. En plus du plaisir d’en envoyer aux grands et aux petits, les cartes sont, pour moi, un merveilleux moyen de conserver une trace tangible d’une flânerie citadine, d’une exposition réussie ou encore d’un séjour hexagonal ou étranger.
Aujourd’hui, j’ai envie de vous faire voyager dans l’univers de quelques cartes postales qui ne quittent jamais mon bureau. Chacune suggère une histoire que je vais vous raconter.
 Paris, hiver 1948. Le photographe Edouard Boubat immortalise un enfant devant une vitrine. Au début, je croyais que c’était un petit garçon, sans doute parce que cet enfant me faisait penser à mon fils. En fait, c’est une petite fille. Elle n’a guère plus de trois ans. Elle porte un manteau de laine dont le col est relevé pour protéger nuque et gorge du vent froid. La photo ne nous le dit pas mais je ne serais pas surprise que les trottoirs soient couverts de neige. Une écharpe écossaise, nouée sous le menton, fait aussi office de bonnet. Des petites mèches ondulées, aux reflets dorés, s’en échappent. La petite fille a de grands yeux bruns et de hautes paupières que délimitent deux traits de sourcils fins. Elle a les joues rondes, des joues sur lesquelles les baisers se posent avant de rebondir. Sa bouche, aux lèvres pleines, est entr’ouverte. Le bout de son nez est collé sur la vitre. L’air qu’elle expire forme de la buée et jette un flou sur la partie droite de son visage. La petite fille est devant une librairie. La lecture d’une photo peut-être subjective mais là, je crois pouvoir affirmer que l’expression du regard profond est triste. Je me demande ce qui lui fait envie dans les objets exposés dans la vitrine et la rend si grave. Ce qu’elle convoite est-il inaccessible ? Derrière la petite fille, un peu en retrait, se tient un homme dont on ne voit que le manteau et une écharpe. Sans doute son père.
Paris, hiver 1948. Le photographe Edouard Boubat immortalise un enfant devant une vitrine. Au début, je croyais que c’était un petit garçon, sans doute parce que cet enfant me faisait penser à mon fils. En fait, c’est une petite fille. Elle n’a guère plus de trois ans. Elle porte un manteau de laine dont le col est relevé pour protéger nuque et gorge du vent froid. La photo ne nous le dit pas mais je ne serais pas surprise que les trottoirs soient couverts de neige. Une écharpe écossaise, nouée sous le menton, fait aussi office de bonnet. Des petites mèches ondulées, aux reflets dorés, s’en échappent. La petite fille a de grands yeux bruns et de hautes paupières que délimitent deux traits de sourcils fins. Elle a les joues rondes, des joues sur lesquelles les baisers se posent avant de rebondir. Sa bouche, aux lèvres pleines, est entr’ouverte. Le bout de son nez est collé sur la vitre. L’air qu’elle expire forme de la buée et jette un flou sur la partie droite de son visage. La petite fille est devant une librairie. La lecture d’une photo peut-être subjective mais là, je crois pouvoir affirmer que l’expression du regard profond est triste. Je me demande ce qui lui fait envie dans les objets exposés dans la vitrine et la rend si grave. Ce qu’elle convoite est-il inaccessible ? Derrière la petite fille, un peu en retrait, se tient un homme dont on ne voit que le manteau et une écharpe. Sans doute son père.
Cette photo sent encore la guerre, toujours si longue à s’éloigner, les morts qui ne reviendront plus ou alors pour hanter les nuits des vivants, les villes bombardées, les années de privation. Comme Mary Poppins, je voudrais pouvoir dessiner, sur le sol, cette photo, avec de gros bâtons de craie de couleurs, sauter dedans à pieds joints et me retrouver de l’autre côté de l’image. Je pourrais savoir ce que regarde cette petite fille qui m’est devenue, avec les années, si familière et, qui sait, faire en sorte que la mélancolie qui assombrit ses yeux doux disparaisse. Cette photo me touche particulièrement sans doute parce qu’elle me renvoie instantanément à une autre enfant, photographiée sensiblement à la même époque. Elle a un manteau, des gants, une écharpe et de jolies petites tresses. Elle tient un ballon dans ses mains. Elle regarde au loin, offrant à l’œil de l’objectif, une longue nuque fragile. Elle y cherche son père au pays des fantômes.
Paris, 1955. Robert Doisneau photographie Jacques Prévert. Il pose devant l’atelier du photographe. Il est adossé à un mur dont la peinture évoque les ocres rouges du Roussillon. Prévert regarde en l’air. Il a une cigarette au bec. Son feutre, son long manteau et ses chaussures fines et bien cirées sont noirs. Sous son manteau, on devine un complet chiné beige. Il porte une chemise blanche et une cravate grenat. Ses mains sont cachées dans ses poches. Deux balais de sorcière, constitués d’un manche en bois brut et de brindilles retenues en petit fagot, sont posés contre une porte-fenêtre, à la droite de Prévert. Un Christ en croix a été collé sur l’un des deux balais. Sur le mur de l’atelier, Jacques Prévert a réalisé un dessin d’une facture très enfantine. C’est un diablotin dédicacé à Robert Doisneau en des termes simples : « A Doisneau. Jacques Prévert son ami ». Le ton est encore facétieux mais le poète a vieilli. Sur son visage dont les traits s’affaissent passe comme un nuage de lassitude. Quand Doisneau sera satisfait de ses photos, j’imagine les deux compères attablés dans le ventre chaud d’un petit bistrot de quartier et se régalant d’un plat de petit salé aux lentilles. J’imagine encore Prévert levant son verre de vin rouge et lançant à Doisneau : « Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple ».
Deauville, 1963, Robert Doisneau, cliché en noir et blanc. La marée monte formant des vaguelettes, déposant de l’écume blanche sur le rivage et faisant danser les coquillages. Un homme est endormi dans un transat, dans une position abandonnée. Sa tête, coiffée d’un canotier, repose sur le côté droit. Ses mains retombent paresseusement sur les pages d
’un journal largement ouvert. La marée a déjà eu raison du bas de son pantalon de toile et d’un pan de son quotidien. A gauche de la photo, une femme, maillot blanc une pièce, bras musclés, cheveux cendrés mi-longs, s’amuse à prendre en photo le bel endormi. Cette photo sent l’été, l’insouciance d’un pays en plein essor économique, et un je ne sais quoi de british. Si on prête l’oreille, on peut entendre son rire à elle, un rire franc et haut perché que les cris perçants des mouettes ne parviennent pas à couvrir. Puisque pour moi, l’homme de la photo est anglais, je sais qu’il ne jurera pas en découvrant son pantalon et son journal imbibés d’eau de mer. Avec une dignité exemplaire, il se relèvera, rajustera son canotier, repliera transat et journal et se tournera vers sa moqueuse compagne pour lui demander : « ma chère, ne serait-ce pas l’heure d’une tasse de thé ? ».
Pas de date sur la dernière photo reproduite en carte postale. Je l’ai achetée à Vannes, pendant les vacances de la Toussaint 2008. Le photographe s’appelle Philipp Plisson. Il a saisi Ernestine, en plein effort, sur sa barque, baptisée Marie-Galante. Il précise qu’Ernestine est la terreur des palourdes et des praires du golfe du Morbihan. La lumière est superbe. C’est une lumière dorée de fin de journée. Elle éclaire, par en dessous, la coque rouge, les rames, les mains rugueuses de la pêcheuse et son visage travaillé au sel des embruns. Imperceptiblement, ses yeux sérieux et ses lèvres fines sourient au photographe. Ses cheveux étaient blonds avant d’être grignotés par les années argentées. Je suis sûre qu’elle appartient à la grande famille des taiseux, qu’elle croit en Dieu, en la virginité de Marie, en à la résurrection des morts, que ses enfants et ses petits enfants ont tourné le dos à la mer, qu’elle n’aime que les galettes de blé noir recouvertes de beurre salé, que ses placards de cuisine sont bien pourvus en boites de sardine de garde et de pâté Hénaff, qu’elle a, au fond de sa vareuse, un marron d’Inde, gage de bonne santé et qu’elle parle encore le Breton avec les « anciens ». D’Ernestine se dégage une vraie sérénité, celle des personnes dont la vie, résolument ancrée dans le présent, a été bien remplie et qui ne redoute pas de partir. Sa modestie lui interdit de se croire indispensable.
Voilà, notre voyage s’achève. Je remercie Ernestine et le couple de Deauville, Jacques Prévert et la petite fille.
Anne-Lorraine Guillou-Brunner



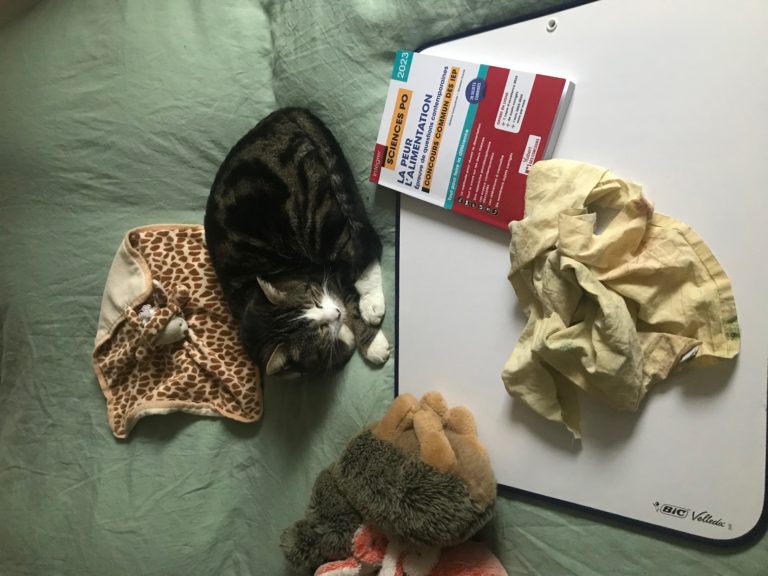
Je vous remercie très chaleureusement pour vos messages. Je suis très touchée. Je m’efforce de publier un billet une fois par semaine. Je vous dis à très bientôt.