 Il est neuf heures et onze minutes quand le train s’ébranle au départ de la gare de Paris Bercy. Le ciel est bas. Le brouillard enveloppe les têtes carrées des immeubles. Dans le wagon règne une ambiance feutrée. Tous les passagers sont assis dans le sens de la marche. Bientôt, certains laisseront leurs paupières tomber sur leurs yeux et poursuivront leur nuit. La dame, à côté de moi, de l’autre côté du couloir, corrige des copies. Nous sommes le 11 novembre, le jour de l’armistice. Tout à l’heure, dans un café, en prenant un petit déjeuner, je regardais flotter au vent les drapeaux plantés à l’avant des bus. Le matin, avant de partir de chez ma soeur, j’avais lu que notre Président de la République inaugurerait la sculpture installée dans le jardin Eugénie-Djendi du parc André-Citroen rendant hommage aux soldats français tombés en « Opex ». C’est à dire en opérations extérieures. Dans le même article, le journaliste rapportait des propos de l’Elysée estimant que cette sculpture prenait place dans « l’écosystème mémoriel ». Les mots d’un conseiller normalien versé dans l’écologie?
Il est neuf heures et onze minutes quand le train s’ébranle au départ de la gare de Paris Bercy. Le ciel est bas. Le brouillard enveloppe les têtes carrées des immeubles. Dans le wagon règne une ambiance feutrée. Tous les passagers sont assis dans le sens de la marche. Bientôt, certains laisseront leurs paupières tomber sur leurs yeux et poursuivront leur nuit. La dame, à côté de moi, de l’autre côté du couloir, corrige des copies. Nous sommes le 11 novembre, le jour de l’armistice. Tout à l’heure, dans un café, en prenant un petit déjeuner, je regardais flotter au vent les drapeaux plantés à l’avant des bus. Le matin, avant de partir de chez ma soeur, j’avais lu que notre Président de la République inaugurerait la sculpture installée dans le jardin Eugénie-Djendi du parc André-Citroen rendant hommage aux soldats français tombés en « Opex ». C’est à dire en opérations extérieures. Dans le même article, le journaliste rapportait des propos de l’Elysée estimant que cette sculpture prenait place dans « l’écosystème mémoriel ». Les mots d’un conseiller normalien versé dans l’écologie?
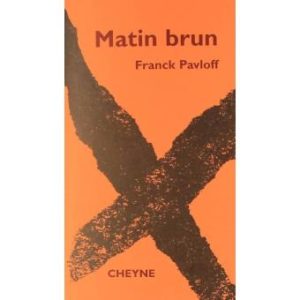 Le devoir de mémoire est fondamental. Le devoir de toutes les mémoires. Par un tour de passe-passe étrange, certains évènements tragiques tirent la couverture à eux. C’est ainsi qu’après les attentats du 13 novembre 2015, petit à petit, c’est la tragédie du Bataclan qui l’a emporté. On a semblé mettre de côté l’horreur des terrasses du 10e arrondissement et de Saint Denis. Dans les pays, où on n’a pas su faire de retour sur des atrocités commises, où il n’y a pas eu de place pour un pardon, on voit réapparaître des pensées nauséabondes. En France, dans les collèges, la lecture de Matin brun demeure essentielle.
Le devoir de mémoire est fondamental. Le devoir de toutes les mémoires. Par un tour de passe-passe étrange, certains évènements tragiques tirent la couverture à eux. C’est ainsi qu’après les attentats du 13 novembre 2015, petit à petit, c’est la tragédie du Bataclan qui l’a emporté. On a semblé mettre de côté l’horreur des terrasses du 10e arrondissement et de Saint Denis. Dans les pays, où on n’a pas su faire de retour sur des atrocités commises, où il n’y a pas eu de place pour un pardon, on voit réapparaître des pensées nauséabondes. En France, dans les collèges, la lecture de Matin brun demeure essentielle.
 Ce sont 549 militaires français qui sont morts depuis 1963. Ils ont perdu la vie au Tchad, au Mali, au Rwanda, dans les Balkans, au Liban, en Afghanistan, au Burkina-Faso ou bien encore en Syrie. Ils sont morts loin des leurs mais, et c’est malgré tout un réconfort pour les familles, leurs corps ont pu être rapatriés et enterrés dans la terre de France. Bien sûr, je pense à l’un des frères du grand-père maternel de notre mère, Auguste, embarqué depuis le port de Marseille et mort aux Dardanelles. Je pense à la détresse de ses parents, à la souffrance de ses trois frères. Je pense au père de notre mère dont le corps n’est jamais revenu du camp de concentration de Mauthausen. Je pense à ce que devait ressentir son beau-père, Emile, le frère d’Auguste, quand, le matin, à Courcelles, il montait dans le 84, en descendait à la station Sèvres-Babylone et, au Lutétia, réquisitionné par la Croix-Rouge, espérait trouver le nom du mari de sa fille, du père de sa première petite-fille sur la liste des rescapés de l’enfer. C’est toujours le coeur lourd qu’il reprenait le 84. Deux fantômes l’accompagnaient.
Ce sont 549 militaires français qui sont morts depuis 1963. Ils ont perdu la vie au Tchad, au Mali, au Rwanda, dans les Balkans, au Liban, en Afghanistan, au Burkina-Faso ou bien encore en Syrie. Ils sont morts loin des leurs mais, et c’est malgré tout un réconfort pour les familles, leurs corps ont pu être rapatriés et enterrés dans la terre de France. Bien sûr, je pense à l’un des frères du grand-père maternel de notre mère, Auguste, embarqué depuis le port de Marseille et mort aux Dardanelles. Je pense à la détresse de ses parents, à la souffrance de ses trois frères. Je pense au père de notre mère dont le corps n’est jamais revenu du camp de concentration de Mauthausen. Je pense à ce que devait ressentir son beau-père, Emile, le frère d’Auguste, quand, le matin, à Courcelles, il montait dans le 84, en descendait à la station Sèvres-Babylone et, au Lutétia, réquisitionné par la Croix-Rouge, espérait trouver le nom du mari de sa fille, du père de sa première petite-fille sur la liste des rescapés de l’enfer. C’est toujours le coeur lourd qu’il reprenait le 84. Deux fantômes l’accompagnaient.
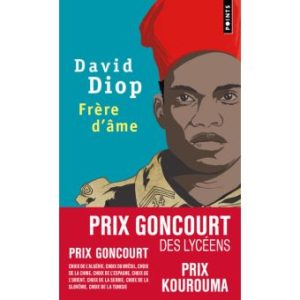 Dans le train qui m’éloigne de Paris et me rapproche de la campagne, je me plonge dans la lecture du livre de David Diop, « Frère d’âme ». Ce roman a été couronné par le prix Goncourt des lycéens l’an passé. En 144 pages d’une écriture dense et poétique, l’auteur raconte la vie de ces tirailleurs sénégalais venus mourir dans la boue de la Grande guerre. Des hommes qui ne parlaient pas notre langue mais auxquels on faisait miroiter des pensions pour leur famille et des croix de guerre, à titre posthume. Quand à l’appel de leur chef, ils s’arrachaient au ventre des tranchées en hurlant pour oublier leur peur, ils terrorisaient les soldats allemands. D’autres pauvres malheureux qui, comme eux, avaient été enlevés à la vie civile pour venir défendre, plus que la patrie, des intérêts supérieurs dont ils ne sauraient rien. Certainement valait-il mieux mourir pour son pays que mourir pour engraisser les marchands de canons et assouvir les instincts rapaces des puissants.
Dans le train qui m’éloigne de Paris et me rapproche de la campagne, je me plonge dans la lecture du livre de David Diop, « Frère d’âme ». Ce roman a été couronné par le prix Goncourt des lycéens l’an passé. En 144 pages d’une écriture dense et poétique, l’auteur raconte la vie de ces tirailleurs sénégalais venus mourir dans la boue de la Grande guerre. Des hommes qui ne parlaient pas notre langue mais auxquels on faisait miroiter des pensions pour leur famille et des croix de guerre, à titre posthume. Quand à l’appel de leur chef, ils s’arrachaient au ventre des tranchées en hurlant pour oublier leur peur, ils terrorisaient les soldats allemands. D’autres pauvres malheureux qui, comme eux, avaient été enlevés à la vie civile pour venir défendre, plus que la patrie, des intérêts supérieurs dont ils ne sauraient rien. Certainement valait-il mieux mourir pour son pays que mourir pour engraisser les marchands de canons et assouvir les instincts rapaces des puissants.
 Le livre de David Diop est bouleversant. L’atrocité de certaines descriptions est rendue supportable par la dimension humaine de celui qui s’y livre. L’auteur fait le récit de deux amis d’enfance, Alfa Ndiaye et Mabenda Diop. C’est Alpha qui raconte leur mémoire commune et son affection pour son « plus que frère ». David Diop dit la violence de la guerre, la folie qui s’empare des hommes au moment des combats, une folie admise seulement à titre temporaire. Revenus à leurs positions dans la boue des tranchées, la folie n’est plus de mise. La folie temporaire sert de blanc-seing à la barbarie des assauts. C’est pourquoi, très durablement, l’armée a refusé de prendre en considération les traumas liés à la guerre. Il aura fallu attendre la guerre au Koweit pour se pencher sur les troubles psychologiques ressentis par les militaires.
Le livre de David Diop est bouleversant. L’atrocité de certaines descriptions est rendue supportable par la dimension humaine de celui qui s’y livre. L’auteur fait le récit de deux amis d’enfance, Alfa Ndiaye et Mabenda Diop. C’est Alpha qui raconte leur mémoire commune et son affection pour son « plus que frère ». David Diop dit la violence de la guerre, la folie qui s’empare des hommes au moment des combats, une folie admise seulement à titre temporaire. Revenus à leurs positions dans la boue des tranchées, la folie n’est plus de mise. La folie temporaire sert de blanc-seing à la barbarie des assauts. C’est pourquoi, très durablement, l’armée a refusé de prendre en considération les traumas liés à la guerre. Il aura fallu attendre la guerre au Koweit pour se pencher sur les troubles psychologiques ressentis par les militaires.
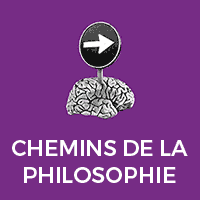 Le train avance sans coup férir. La contrôleuse est passée: petit bout de femme sanglée dans un uniforme impeccable portant un carré blond court sous sa casquette. La dame assise à ma droite, de l’autre côté du couloir, a rangé ses copies dans son cartable. Maintenant, elle écoute de la musique classique à moins que cela ne soit le podcast d’une émission de France Culture. Si Louis, notre unique fils et dernier enfant, était là, il me dirait: « Maman, quel cliché! Quand on est professeur, on écoute forcément de la musique classique ou la rediffusion d’une émission intello? Pourquoi ne pourrait-on pas écouter du heavy metal ou rire des vidéos de Squeezie? ». Louis fait la chasse à tous les préjugés.
Le train avance sans coup férir. La contrôleuse est passée: petit bout de femme sanglée dans un uniforme impeccable portant un carré blond court sous sa casquette. La dame assise à ma droite, de l’autre côté du couloir, a rangé ses copies dans son cartable. Maintenant, elle écoute de la musique classique à moins que cela ne soit le podcast d’une émission de France Culture. Si Louis, notre unique fils et dernier enfant, était là, il me dirait: « Maman, quel cliché! Quand on est professeur, on écoute forcément de la musique classique ou la rediffusion d’une émission intello? Pourquoi ne pourrait-on pas écouter du heavy metal ou rire des vidéos de Squeezie? ». Louis fait la chasse à tous les préjugés.
 Le train progresse. Nous avons quitté la région parisienne pour un paysage de forêt automnale. Le ciel est toujours bas et le brouillard persistant. Ce matin s’est achevé mon second séjour à Paris de l’année. C’est assez frustrant de n’être séparé de Paris que par 110 petits kilomètres et d’y aller si rarement! Cette escapade s’est organisée autour d’un rendez-vous en endocrinologie à la Pitié-Salpêtrière. Ma soeur m’a accueillie dans cet appartement que j’aime tant. Un appartement situé sur la butte Montmartre, rue Caulaincourt. L’appartement est au dernier étage d’un immeuble surplombant la cime des arbres. Du balcon, à gauche, on voit le Sacré-Coeur. Le matin et le soir, quand il fait encore nuit, j’aime regarder les intérieurs des appartements briller comme des ventres de lucioles. Les rideaux sont tombés en désuétude emportant dans leur sillage leurs doubles tout en fin tissu que la pollution rendait gris et terne. Maintenant, comme chez nos voisins protestants du nord, la vie s’offre à voir dès que le soleil disparaît. Les immeubles, la nuit, quand les intérieurs sont allumés, ressemblent à des décors de théâtre. Je n’ai jamais cherché à épier les mouvements des habitants. Je me laisse simplement aller à une sorte de rêverie éveillée dans laquelle Magritte se tient en embuscade à côté d’une cheminée.
Le train progresse. Nous avons quitté la région parisienne pour un paysage de forêt automnale. Le ciel est toujours bas et le brouillard persistant. Ce matin s’est achevé mon second séjour à Paris de l’année. C’est assez frustrant de n’être séparé de Paris que par 110 petits kilomètres et d’y aller si rarement! Cette escapade s’est organisée autour d’un rendez-vous en endocrinologie à la Pitié-Salpêtrière. Ma soeur m’a accueillie dans cet appartement que j’aime tant. Un appartement situé sur la butte Montmartre, rue Caulaincourt. L’appartement est au dernier étage d’un immeuble surplombant la cime des arbres. Du balcon, à gauche, on voit le Sacré-Coeur. Le matin et le soir, quand il fait encore nuit, j’aime regarder les intérieurs des appartements briller comme des ventres de lucioles. Les rideaux sont tombés en désuétude emportant dans leur sillage leurs doubles tout en fin tissu que la pollution rendait gris et terne. Maintenant, comme chez nos voisins protestants du nord, la vie s’offre à voir dès que le soleil disparaît. Les immeubles, la nuit, quand les intérieurs sont allumés, ressemblent à des décors de théâtre. Je n’ai jamais cherché à épier les mouvements des habitants. Je me laisse simplement aller à une sorte de rêverie éveillée dans laquelle Magritte se tient en embuscade à côté d’une cheminée.
 Ma soeur étant très accaparée par les représentations de la pièce qu’elle a co-écrite et co-mise en scène avec l’un de ses amis les plus proches « Fly me to the moon », je me suis proposée d’aller chercher sa petite fille, Charlotte, à la crèche. La première fois, Margot, sa grande soeur, m’accompagnait pour que je ne me perde pas. Mon sens de l’orientation est assez navrant et, la nuit, je perds tous mes repères même si tous les chats sont gris et « tous les sangs sont noirs » comme le dit Alpha, le « plus que frère » de Mademba.
Ma soeur étant très accaparée par les représentations de la pièce qu’elle a co-écrite et co-mise en scène avec l’un de ses amis les plus proches « Fly me to the moon », je me suis proposée d’aller chercher sa petite fille, Charlotte, à la crèche. La première fois, Margot, sa grande soeur, m’accompagnait pour que je ne me perde pas. Mon sens de l’orientation est assez navrant et, la nuit, je perds tous mes repères même si tous les chats sont gris et « tous les sangs sont noirs » comme le dit Alpha, le « plus que frère » de Mademba.
 Je n’ai pas revu Charlotte depuis le week-end des anniversaires de ma soeur, de mon mari et de notre fille aînée, fin septembre. Quand, avec Margot, nous poussons la porte de l’espace dédié aux deux ans et plus, un grand calme règne. Il ne reste que trois enfants. Quand elle me voit, Charlotte se précipite en criant. Je la prends dans mes bras. Je suis si heureuse de la retrouver. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à consacrer du temps à nos neveux et je suis reconnaissante à mon mari d’avoir toujours consenti à partir en vacances avec des enfants surnuméraires. La crèche me fait faire un voyage dans le temps. Je suis propulsée de longues années dans le passé. Je retrouve l’époque où nos trois enfants étaient à la crèche. Une chose a changé: on prend un temps pour les « transmissions ». Un jeune homme charmant m’explique par le menu la journée de Charlotte. Demain matin, en la déposant, je devrai en faire autant. Je vais chercher le manteau suspendu en dessous d’une étiquette à son prénom. Joseph, son meilleur ami, est déjà parti. Charlotte insiste pour que je remonte complètement la fermeture éclair. Son manteau est un peu juste mais elle refuse de porter le nouveau, celui que sa maman lui a offert car elle le trouve trop gros, trop lourd. Elle se sent engoncée.
Je n’ai pas revu Charlotte depuis le week-end des anniversaires de ma soeur, de mon mari et de notre fille aînée, fin septembre. Quand, avec Margot, nous poussons la porte de l’espace dédié aux deux ans et plus, un grand calme règne. Il ne reste que trois enfants. Quand elle me voit, Charlotte se précipite en criant. Je la prends dans mes bras. Je suis si heureuse de la retrouver. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à consacrer du temps à nos neveux et je suis reconnaissante à mon mari d’avoir toujours consenti à partir en vacances avec des enfants surnuméraires. La crèche me fait faire un voyage dans le temps. Je suis propulsée de longues années dans le passé. Je retrouve l’époque où nos trois enfants étaient à la crèche. Une chose a changé: on prend un temps pour les « transmissions ». Un jeune homme charmant m’explique par le menu la journée de Charlotte. Demain matin, en la déposant, je devrai en faire autant. Je vais chercher le manteau suspendu en dessous d’une étiquette à son prénom. Joseph, son meilleur ami, est déjà parti. Charlotte insiste pour que je remonte complètement la fermeture éclair. Son manteau est un peu juste mais elle refuse de porter le nouveau, celui que sa maman lui a offert car elle le trouve trop gros, trop lourd. Elle se sent engoncée.
Charlotte ne veut pas quitter mes bras et cela ne me dérange pas de la porter et de sentir ses boucles caresser ma joue. Je suis heureuse de lui donner son bain, de lui lire des histoires, de chanter des chansons et la voir danser dans un tutu pailleté. Margot est une grande soeur très attentive et attentionnée, Valentin un grand frère à la fois tendre et observateur.
Le week-end, les enfants sont avec leur papa. A leur coeur défendant, ils ont rejoint la grande famille des enfants de parents séparés. Charlotte n’avait pas encore deux ans quand son papa a exprimé son désir de se séparer de sa maman. En grandissant, elle ne pourra pas se rappeler avoir su ce que c’était d’avoir ses deux parents formant un couple cimentant une famille. Comme elle n’avait pas encore accès au langage des mots, Charlotte a exprimé ses émotions par son corps et sa difficulté à se laisser glisser dans le sommeil. Le sommeil est un abandon. Pour s’y livrer totalement, il faut se sentir en sécurité.
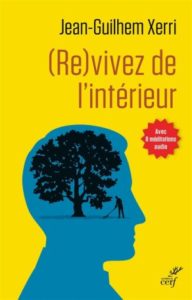 Etre à Paris, c’est prendre un bain familial, amical et culturel. Si Stéphane a été contraint de rester à la maison avec le trio et Fantôme, que, Natalie, la marraine de Victoire est encore à Singapour, Aurélie partie à la campagne avec ses enfants, Alice, sortie de ma vie aussi vite qu’elle y était rentrée à nouveau, Patrick bloqué au Moyen-Orient et que Raphaël se livre à la contemplation nostalgique d’un océan gris et tourmenté depuis la grande plage d’Hossegor, j’ai la joie de trois déjeuners: le premier avec l’un de nos cousins qui me parle de la promotion de son dernier livre (Re)vivez de l’intérieur, écrit dans le prolongement de son ouvrage sur la pensée des Pères du désert, d’un autre avec la marraine de Céleste, ma plus ancienne amie, son mari et leur fille, dans un restaurant taïwanais incroyable au 3 de la rue des Patriarches et du troisième, avec ma soeur, dans une brasserie près de l’Odéon.
Etre à Paris, c’est prendre un bain familial, amical et culturel. Si Stéphane a été contraint de rester à la maison avec le trio et Fantôme, que, Natalie, la marraine de Victoire est encore à Singapour, Aurélie partie à la campagne avec ses enfants, Alice, sortie de ma vie aussi vite qu’elle y était rentrée à nouveau, Patrick bloqué au Moyen-Orient et que Raphaël se livre à la contemplation nostalgique d’un océan gris et tourmenté depuis la grande plage d’Hossegor, j’ai la joie de trois déjeuners: le premier avec l’un de nos cousins qui me parle de la promotion de son dernier livre (Re)vivez de l’intérieur, écrit dans le prolongement de son ouvrage sur la pensée des Pères du désert, d’un autre avec la marraine de Céleste, ma plus ancienne amie, son mari et leur fille, dans un restaurant taïwanais incroyable au 3 de la rue des Patriarches et du troisième, avec ma soeur, dans une brasserie près de l’Odéon.
 En solo, je vais découvrir le travail tout en couleur de Hassan Hajjaj, artiste autodidacte anglo-marocain protéiforme et souvent appelé le Andy Warhol de Marrakech. La maison européenne de la photographie lui a laissé carte blanche pour recréer un café marocain. Ses trois cent photos célèbrent tous les visages de l’Afrique et cherchent à montrer que, même voilées et habillées de manière traditionnelle, les femmes arabes aiment la mode. Hassan Hajjaj pratique naturellement le recyclage. Ces cadres sont ornés de canettes de Coca-cola, de conserves d’olives ou de tomates. Ils sont parfois travaillés avec des morceaux de plastique tressés. Les couleurs sont flashy et les imprimés décalés. Comme l’a écrit Sylvie Rantrua dans un article pour Le Point, Hassan Hajjaj mixe « avec bonheur son héritage marocain et sa culture underground londonienne ».
En solo, je vais découvrir le travail tout en couleur de Hassan Hajjaj, artiste autodidacte anglo-marocain protéiforme et souvent appelé le Andy Warhol de Marrakech. La maison européenne de la photographie lui a laissé carte blanche pour recréer un café marocain. Ses trois cent photos célèbrent tous les visages de l’Afrique et cherchent à montrer que, même voilées et habillées de manière traditionnelle, les femmes arabes aiment la mode. Hassan Hajjaj pratique naturellement le recyclage. Ces cadres sont ornés de canettes de Coca-cola, de conserves d’olives ou de tomates. Ils sont parfois travaillés avec des morceaux de plastique tressés. Les couleurs sont flashy et les imprimés décalés. Comme l’a écrit Sylvie Rantrua dans un article pour Le Point, Hassan Hajjaj mixe « avec bonheur son héritage marocain et sa culture underground londonienne ».
 En solo encore, au musée Maillol, j’admire les toiles réunies autour de l’exposition intitulée « Du Douanier Rousseau à Séraphine ». J’y retrouve Baudelaire qui hante mes nuits avec ses fleurs maladives depuis plusieurs semaines. La toute première dissertation de notre aînée portait sur le rôle de la poésie au travers des Fleurs du mal. En effet, Baudelaire est le premier à avoir employé le terme « naïf » s’agissant de la peinture de Delacroix. Je découvre des peintres dont je n’avais absolument jamais entendu parler et dont l’univers me plait beaucoup comme Ferdinand Desnos, cousin de Robert, André Bauchant, Jean Eve ou bien encore René Rimbert. Les compositions florales de Séraphine sont magnifiques: un feu d’artifice de couleurs! Son oeuvre est si joyeuse, si lumineuse, si pleine de vie qu’on peine à imaginer que Séraphine ait pu souffrir de psychose. Dès lors qu’elle sera internée, elle ne peindra plus jamais.
En solo encore, au musée Maillol, j’admire les toiles réunies autour de l’exposition intitulée « Du Douanier Rousseau à Séraphine ». J’y retrouve Baudelaire qui hante mes nuits avec ses fleurs maladives depuis plusieurs semaines. La toute première dissertation de notre aînée portait sur le rôle de la poésie au travers des Fleurs du mal. En effet, Baudelaire est le premier à avoir employé le terme « naïf » s’agissant de la peinture de Delacroix. Je découvre des peintres dont je n’avais absolument jamais entendu parler et dont l’univers me plait beaucoup comme Ferdinand Desnos, cousin de Robert, André Bauchant, Jean Eve ou bien encore René Rimbert. Les compositions florales de Séraphine sont magnifiques: un feu d’artifice de couleurs! Son oeuvre est si joyeuse, si lumineuse, si pleine de vie qu’on peine à imaginer que Séraphine ait pu souffrir de psychose. Dès lors qu’elle sera internée, elle ne peindra plus jamais.
 En solo toujours, à l’Institut du monde arabe, après avoir déjeuné avec notre cousin, je pars en voyage au nord-ouest de l’Arabie saoudite. Je découvre l’incroyable région d’Alula qui connait la prospérité dés l’antiquité grâce à la fertilité de son oasis et à sa position stratégique sur les pistes caravanières qui traversaient l’Arabie, en particulier celle de la myrrhe, de l’encens et des aromates. Au fil des siècles, la route de l’encens devient celle du pèlerinage à la Mecque. Dans un jardin, je respire les odeurs des dattes, des oranges, du citron et de la menthe tout en écoutant les oiseaux chanter. Je pense à Natalie et à Patrick. Tous deux ont passé plusieurs années à Djeddah, sur les bords de la mer rouge. Il faudra que je leur demande s’ils connaissent les cités antiques et les montagnes de grès d’Alula.
En solo toujours, à l’Institut du monde arabe, après avoir déjeuné avec notre cousin, je pars en voyage au nord-ouest de l’Arabie saoudite. Je découvre l’incroyable région d’Alula qui connait la prospérité dés l’antiquité grâce à la fertilité de son oasis et à sa position stratégique sur les pistes caravanières qui traversaient l’Arabie, en particulier celle de la myrrhe, de l’encens et des aromates. Au fil des siècles, la route de l’encens devient celle du pèlerinage à la Mecque. Dans un jardin, je respire les odeurs des dattes, des oranges, du citron et de la menthe tout en écoutant les oiseaux chanter. Je pense à Natalie et à Patrick. Tous deux ont passé plusieurs années à Djeddah, sur les bords de la mer rouge. Il faudra que je leur demande s’ils connaissent les cités antiques et les montagnes de grès d’Alula.
 Avec ma soeur, nous nous offrons deux expositions au musée des arts décoratifs. La première » Moderne Maharajah » nous déçoit. Elle retrace la construction du tout premier palais moderne commandé par le maharajah d’Indore à l’architecte berlinois Eckart Muthesius. A l’exception des photos que Man Ray a réalisées du maharajah et de sa femme, de meubles et de quelques objets, l’exposition nous ennuie. Le manque de lumière et les caractères liliputiens des descriptions n’arrangent rien. Nous passons de « Moderne Maharajah » à « Marche et démarche ». Alors que nous avons mal aux pieds et aux lombaires, nous revisitons l’histoire de la chaussure tout en voyageant aux quatre coins de la planète. L’étroitesse des chaussures ou la hauteur des talons laissent deviner les souffrances endurées par des générations de femmes pour sacrifier aux dictats d’un mode pensée par des hommes. Je refuse de regarder le documentaire montrant comment une petite fille chinoise de six ans se faisait bander les pieds pour la toute première fois. La barbarie étant sans limite. On n’hésitait pas à fracturer les orteils des enfants pour pouvoir les retourner complètement sous la voute plantaire. Bien sûr, on vendait aux petites filles cette torture comme un rite initiatique visant non seulement à garantir leur beauté mais aussi à éprouver leur courage. Je me rappelle les romans de Pearl Buck lus à l’adolescence.
Avec ma soeur, nous nous offrons deux expositions au musée des arts décoratifs. La première » Moderne Maharajah » nous déçoit. Elle retrace la construction du tout premier palais moderne commandé par le maharajah d’Indore à l’architecte berlinois Eckart Muthesius. A l’exception des photos que Man Ray a réalisées du maharajah et de sa femme, de meubles et de quelques objets, l’exposition nous ennuie. Le manque de lumière et les caractères liliputiens des descriptions n’arrangent rien. Nous passons de « Moderne Maharajah » à « Marche et démarche ». Alors que nous avons mal aux pieds et aux lombaires, nous revisitons l’histoire de la chaussure tout en voyageant aux quatre coins de la planète. L’étroitesse des chaussures ou la hauteur des talons laissent deviner les souffrances endurées par des générations de femmes pour sacrifier aux dictats d’un mode pensée par des hommes. Je refuse de regarder le documentaire montrant comment une petite fille chinoise de six ans se faisait bander les pieds pour la toute première fois. La barbarie étant sans limite. On n’hésitait pas à fracturer les orteils des enfants pour pouvoir les retourner complètement sous la voute plantaire. Bien sûr, on vendait aux petites filles cette torture comme un rite initiatique visant non seulement à garantir leur beauté mais aussi à éprouver leur courage. Je me rappelle les romans de Pearl Buck lus à l’adolescence.
 Le dimanche matin, nous réussissons à entrer sans trop de difficultés au musée d’Orsay et y admirons le travail de Degas autour de l’Opéra. Je pense à notre grand-mère qui a déroulé toute sa carrière à l’Opéra Garnier. Je pense aussi à Céleste qui, cette année, a décidé de parler, en arts plastiques, de « La petite danseuse de 14 ans ». Elle est là. Je la contemple longuement et ne comprends toujours pas que les critiques de l’époque aient osé qualifier son visage de simiesque et lui prêter une expression vicieuse. C’est seulement une petite jeune fille dont les traits expriment son désir de bien faire. Degas, contrairement aux hommes de son époque, ne porte jamais un regard malsain sur les danseuses. Il les peint dans leur intimité mais sans que jamais son regard les salisse. L’usage du pastel confère beaucoup de douceur et de légèreté à ses sujets. Degas sait à merveille jeter des notes de couleurs vives dans ses toiles.
Le dimanche matin, nous réussissons à entrer sans trop de difficultés au musée d’Orsay et y admirons le travail de Degas autour de l’Opéra. Je pense à notre grand-mère qui a déroulé toute sa carrière à l’Opéra Garnier. Je pense aussi à Céleste qui, cette année, a décidé de parler, en arts plastiques, de « La petite danseuse de 14 ans ». Elle est là. Je la contemple longuement et ne comprends toujours pas que les critiques de l’époque aient osé qualifier son visage de simiesque et lui prêter une expression vicieuse. C’est seulement une petite jeune fille dont les traits expriment son désir de bien faire. Degas, contrairement aux hommes de son époque, ne porte jamais un regard malsain sur les danseuses. Il les peint dans leur intimité mais sans que jamais son regard les salisse. L’usage du pastel confère beaucoup de douceur et de légèreté à ses sujets. Degas sait à merveille jeter des notes de couleurs vives dans ses toiles.
 De grandes promenades viennent s’immiscer entre ces visites culturelles. Paris, lentement, entre dans l’esprit de Noël. Les grands magasins ont presque fini leurs vitrines. Au Bon Marché, de grands sapins scintillent de mille feux. Rue Dufour, une jeune femme d’origine sud-américaine promène cinq teckels en laisse. Les trois plus jeunes ouvrent la marche et le plus âgé à barbe blanche la ferme. Au musée d’Orsay, une ravissante caissière est plongée dans la lecture du livre que Camille Laurens a consacré à l’histoire de vraie de « La petite danseuse de 14 ans ». Au métro Lamarck, un sans-abri est pris en charge par le personnel de la RATP. Il a pris du crack et convulse. Rue Saint Honoré, nous passons devant l’église Saint Roch et mon coeur se serre. C’est dans cette église que ma soeur et Mathieu se sont mariés et que deux de leurs trois enfants ont reçu le baptême. Devant la pyramide du Louvre, un groupe de femmes originaires du Moyen-Orient se prennent en photo dans des poses de mannequins. Au Zaoka, samedi, il me semble être au milieu des pages d’un livre que j’ai dégusté comme une vraie gourmandise Les délices de Tokyo. La salle de restaurant et la cuisine sont microscopiques. On se croirait dans une maison de poupée. La jeune cheffe est à la délicatesse même. Au jardin des Plantes, on finit d’installer la promenade lumineuse autour du thème de l’océan. Des tortues, des dauphins, des raies manta ou bien encore des Bernard l’hermite s’élèvent au-dessus des parterres. Le soir, rue Caulaincourt, autour d’un verre de vin blanc, avec ma soeur, dans nos échanges parfois très tendus, je prends toute la mesure de ce qui nous unit et de ce qui nous oppose. Nous nous heurtons autour de l’intransigeance que chacune reproche à l’autre. Et c’est juste: nous le sommes toutes les deux mais pas de la même manière et pas selon le même cheminement.
De grandes promenades viennent s’immiscer entre ces visites culturelles. Paris, lentement, entre dans l’esprit de Noël. Les grands magasins ont presque fini leurs vitrines. Au Bon Marché, de grands sapins scintillent de mille feux. Rue Dufour, une jeune femme d’origine sud-américaine promène cinq teckels en laisse. Les trois plus jeunes ouvrent la marche et le plus âgé à barbe blanche la ferme. Au musée d’Orsay, une ravissante caissière est plongée dans la lecture du livre que Camille Laurens a consacré à l’histoire de vraie de « La petite danseuse de 14 ans ». Au métro Lamarck, un sans-abri est pris en charge par le personnel de la RATP. Il a pris du crack et convulse. Rue Saint Honoré, nous passons devant l’église Saint Roch et mon coeur se serre. C’est dans cette église que ma soeur et Mathieu se sont mariés et que deux de leurs trois enfants ont reçu le baptême. Devant la pyramide du Louvre, un groupe de femmes originaires du Moyen-Orient se prennent en photo dans des poses de mannequins. Au Zaoka, samedi, il me semble être au milieu des pages d’un livre que j’ai dégusté comme une vraie gourmandise Les délices de Tokyo. La salle de restaurant et la cuisine sont microscopiques. On se croirait dans une maison de poupée. La jeune cheffe est à la délicatesse même. Au jardin des Plantes, on finit d’installer la promenade lumineuse autour du thème de l’océan. Des tortues, des dauphins, des raies manta ou bien encore des Bernard l’hermite s’élèvent au-dessus des parterres. Le soir, rue Caulaincourt, autour d’un verre de vin blanc, avec ma soeur, dans nos échanges parfois très tendus, je prends toute la mesure de ce qui nous unit et de ce qui nous oppose. Nous nous heurtons autour de l’intransigeance que chacune reproche à l’autre. Et c’est juste: nous le sommes toutes les deux mais pas de la même manière et pas selon le même cheminement.
 Le soir venu, dans le lit de mon neveu, rue Caulaincourt, je me plonge dans le dernier livre de Sylvain Tesson La panthère des neiges. Je l’aurai fini avant de quitter Paris. Ce livre est magnifique comme « Les chemins noirs ». Sylvain Tesson a eu beaucoup de chance que Vincent Munier lui offre de l’accompagner sur la piste de cet animal aussi merveilleux que difficile à observer. Je finis par ressentir de la tendresse pour Sylvain Tesson, un homme qui avait exprimé le désir de ne pas survivre à ses parents et qui a fait le choix de ne pas avoir d’enfant. J’aurais adoré que Sylvain Tesson consente à venir s’étendre sur mon divan. Il se dit rétif à toute approche analytique. S’il savait que le tissu que je tends sur mon canapé a été acheté à Leh dans la capitale du Ladakh sur une des étapes d’un tour du monde et qu’il conserve encore l’odeur de la petite boutique où nous l’avions trouvé consentirait-il à ce voyage consistant à faire au moins une fois dans sa vie le tour de soi?
Le soir venu, dans le lit de mon neveu, rue Caulaincourt, je me plonge dans le dernier livre de Sylvain Tesson La panthère des neiges. Je l’aurai fini avant de quitter Paris. Ce livre est magnifique comme « Les chemins noirs ». Sylvain Tesson a eu beaucoup de chance que Vincent Munier lui offre de l’accompagner sur la piste de cet animal aussi merveilleux que difficile à observer. Je finis par ressentir de la tendresse pour Sylvain Tesson, un homme qui avait exprimé le désir de ne pas survivre à ses parents et qui a fait le choix de ne pas avoir d’enfant. J’aurais adoré que Sylvain Tesson consente à venir s’étendre sur mon divan. Il se dit rétif à toute approche analytique. S’il savait que le tissu que je tends sur mon canapé a été acheté à Leh dans la capitale du Ladakh sur une des étapes d’un tour du monde et qu’il conserve encore l’odeur de la petite boutique où nous l’avions trouvé consentirait-il à ce voyage consistant à faire au moins une fois dans sa vie le tour de soi?
 Anne-Lorraine Guilllou-Brunner
Anne-Lorraine Guilllou-Brunner




Séjour parisien bien rempli.
Contraste avec la vie du Gâtinais.
Merci de nous faire partager ces moments.
Je vous embrasse.
Dominique
Merci chère Dominique pour votre message. Vivre sur le plateau est pour moi globalement une épreuve, même si j’y ai appris l’art de la contemplation. Je vous embrasse
le tour de soi
3 sur 4 sont motivés
en juin prochain, peut etre…