 Neuf heures sonnent au clocher de l’église du village, une église dans laquelle Victoire et Louis ont reçu le sacrement du baptême. Les rayons du soleil font disparaître les bancs de brume accrochés au-dessus des épis de maïs et dissipent la fraîcheur du matin. Je n’ai pas vu les hirondelles se rassembler sur les fils électriques et tenir de longs conciliabules et, pourtant, elles sont parties. La rentrée est encore dans tous les esprits, sur toutes les lèvres. « Comment s’est passée la rentrée des enfants ? » C’est « LA » question que chacun pose à toute personne rencontrée. Dans la bonne odeur du pain sorti du fournil et des croissants chauds, nous en parlions à la boulangerie.
Neuf heures sonnent au clocher de l’église du village, une église dans laquelle Victoire et Louis ont reçu le sacrement du baptême. Les rayons du soleil font disparaître les bancs de brume accrochés au-dessus des épis de maïs et dissipent la fraîcheur du matin. Je n’ai pas vu les hirondelles se rassembler sur les fils électriques et tenir de longs conciliabules et, pourtant, elles sont parties. La rentrée est encore dans tous les esprits, sur toutes les lèvres. « Comment s’est passée la rentrée des enfants ? » C’est « LA » question que chacun pose à toute personne rencontrée. Dans la bonne odeur du pain sorti du fournil et des croissants chauds, nous en parlions à la boulangerie.
 De la rentrée qui se passe bien ou mal, on glisse vite vers l’Ecole qui laisse encore trop d’enfants différents sur le bord de la cour. Sandie me dit que son fils aime bien lever les yeux au plafond et suivre le vol des mouches. Je lui réponds qu’elle est jolie la chanson des mouches. En ces périodes de rentrée, je pense à Prévert, à son cancre, à tous les enfants que l’école, telle qu’elle est pensée, fait souffrir car ils n’arrivent pas à en intégrer les règles, la verticalité, la pression des notes. Heureusement, maintenant, on a abandonné les classements et, au collège, plus aucun professeur ne s’amuse à distribuer les copies de la meilleure à la pire ou inversement. D’ailleurs, la nouvelle réforme, entrée en vigueur en septembre, abolit les notes. Victoire le regrette. Céleste s’en réjouit !
De la rentrée qui se passe bien ou mal, on glisse vite vers l’Ecole qui laisse encore trop d’enfants différents sur le bord de la cour. Sandie me dit que son fils aime bien lever les yeux au plafond et suivre le vol des mouches. Je lui réponds qu’elle est jolie la chanson des mouches. En ces périodes de rentrée, je pense à Prévert, à son cancre, à tous les enfants que l’école, telle qu’elle est pensée, fait souffrir car ils n’arrivent pas à en intégrer les règles, la verticalité, la pression des notes. Heureusement, maintenant, on a abandonné les classements et, au collège, plus aucun professeur ne s’amuse à distribuer les copies de la meilleure à la pire ou inversement. D’ailleurs, la nouvelle réforme, entrée en vigueur en septembre, abolit les notes. Victoire le regrette. Céleste s’en réjouit !
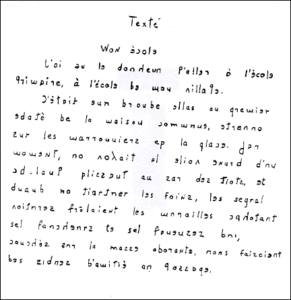 Je l’ai souvent écrit mais j’ai été un de ces enfants-ballons dont l’esprit s’envole en dehors des murs de la classe, poussé par un imaginaire puissant. J’ai été un de ces enfants dont le corps souffre d’être immobilisé de longues heures, un corps plein d’impatience. J’ai été un de ces enfants qui, passé de la méthode syllabique à la méthode globale, n’arrivait même plus à apprendre à lire. J’étais dyslexique à une époque où on n’en parlait pas. En fait, j’ai toujours été à la pointe des problèmes ! C’est comme ça que j’ai aussi goûté à l’anorexie à une époque où le sujet n’était pas encore vulgarisé et où Catherine Eliacheff n’avait pas signé « les indomptables. Figures de l’anorexie ».
Je l’ai souvent écrit mais j’ai été un de ces enfants-ballons dont l’esprit s’envole en dehors des murs de la classe, poussé par un imaginaire puissant. J’ai été un de ces enfants dont le corps souffre d’être immobilisé de longues heures, un corps plein d’impatience. J’ai été un de ces enfants qui, passé de la méthode syllabique à la méthode globale, n’arrivait même plus à apprendre à lire. J’étais dyslexique à une époque où on n’en parlait pas. En fait, j’ai toujours été à la pointe des problèmes ! C’est comme ça que j’ai aussi goûté à l’anorexie à une époque où le sujet n’était pas encore vulgarisé et où Catherine Eliacheff n’avait pas signé « les indomptables. Figures de l’anorexie ».
 Quand j’ai commencé à enseigner à l’Université, le professeur, puis ami, qui m’avait choisie pour dispenser les travaux dirigés, attendait que j’aie soutenu ma thèse et décroché mon poste de maître de conférences pour que nous créions ensemble une faculté privée, loin de l’enseignement traditionnel, avec des passerelles constantes vers l’extérieur, tous les métiers du droit et des stages dès la première année. Rendre l’université vivante quand elle se fossilise ! Jean-Baptiste et moi avons formé un binôme pédagogique bien éloigné des critères universitaires. Notre manière d’aborder notre métier et l’estime que les étudiants nous portaient agaçaient prodigieusement. Je n’ai jamais pensé qu’on pouvait abuser de la confiance de la jeunesse. Les élèves et les étudiants savent vite et bien reconnaître ceux qui travaillent vraiment et se passionnent pour ce qu’ils font et ceux qui subissent leur métier et n’ont que peu ou pas de respect pour ceux qui leur font face. Malheureusement, nos universités sont avant tout des repaires de chercheurs plus que de professeurs ! Les activités de recherche sont essentielles. Elles font rayonner les universités mais elles ne sont pas vraiment utiles aux étudiants pendant leurs premières années.
Quand j’ai commencé à enseigner à l’Université, le professeur, puis ami, qui m’avait choisie pour dispenser les travaux dirigés, attendait que j’aie soutenu ma thèse et décroché mon poste de maître de conférences pour que nous créions ensemble une faculté privée, loin de l’enseignement traditionnel, avec des passerelles constantes vers l’extérieur, tous les métiers du droit et des stages dès la première année. Rendre l’université vivante quand elle se fossilise ! Jean-Baptiste et moi avons formé un binôme pédagogique bien éloigné des critères universitaires. Notre manière d’aborder notre métier et l’estime que les étudiants nous portaient agaçaient prodigieusement. Je n’ai jamais pensé qu’on pouvait abuser de la confiance de la jeunesse. Les élèves et les étudiants savent vite et bien reconnaître ceux qui travaillent vraiment et se passionnent pour ce qu’ils font et ceux qui subissent leur métier et n’ont que peu ou pas de respect pour ceux qui leur font face. Malheureusement, nos universités sont avant tout des repaires de chercheurs plus que de professeurs ! Les activités de recherche sont essentielles. Elles font rayonner les universités mais elles ne sont pas vraiment utiles aux étudiants pendant leurs premières années.
 Mercredi sept septembre, Arte diffusait à 22h20, un remarquable documentaire sur les maîtres à penser de la pédagogie nouvelle et intitulé « Révolution école » et réalisé par Joanna Grudzinska. Si, le jour- même, je n’avais pas entendu Sonia Devillers, chroniqueuse de la matinale de France Inter, l’évoquer avec passion, je serais passée à côté. Sonia Devillers qui a été élève dans une école Decroly rendait un vibrant hommage à son maître, monsieur Billaud, un maître lui ayant appris à ne pas avoir peur des adultes, à penser par elle-même et à s’exprimer clairement haut et fort. L’hommage de Sonia Devillers à son ancien instituteur m’a évoqué celui qu’Emilie Thérond rend au sien dans un magnifique documentaire « Mon maître d’école ». Pendant une année complète, on suit la vie de Jean-Michel Burel, maire et maître, dans le petit village gardois de Saint Just-et-Vacquières. C’est sa dernière année dans cette classe unique. On découvre un homme merveilleux, un grand sage dont le visage buriné, le regard doux et les yeux malicieux, rappellent Pierre Perret. Cet homme a transmis avec passion des connaissances essentielles à deux générations d’enfants. Les enfants qui sont dans sa classe occupent des places qui furent celles de leurs parents avant eux.
Mercredi sept septembre, Arte diffusait à 22h20, un remarquable documentaire sur les maîtres à penser de la pédagogie nouvelle et intitulé « Révolution école » et réalisé par Joanna Grudzinska. Si, le jour- même, je n’avais pas entendu Sonia Devillers, chroniqueuse de la matinale de France Inter, l’évoquer avec passion, je serais passée à côté. Sonia Devillers qui a été élève dans une école Decroly rendait un vibrant hommage à son maître, monsieur Billaud, un maître lui ayant appris à ne pas avoir peur des adultes, à penser par elle-même et à s’exprimer clairement haut et fort. L’hommage de Sonia Devillers à son ancien instituteur m’a évoqué celui qu’Emilie Thérond rend au sien dans un magnifique documentaire « Mon maître d’école ». Pendant une année complète, on suit la vie de Jean-Michel Burel, maire et maître, dans le petit village gardois de Saint Just-et-Vacquières. C’est sa dernière année dans cette classe unique. On découvre un homme merveilleux, un grand sage dont le visage buriné, le regard doux et les yeux malicieux, rappellent Pierre Perret. Cet homme a transmis avec passion des connaissances essentielles à deux générations d’enfants. Les enfants qui sont dans sa classe occupent des places qui furent celles de leurs parents avant eux.
Comme il a occupé un poste dans un petit village, on (entendez l’Inspection d’académie) l’a laissé tranquille et il a pu prendre, avec les programmes, certaines libertés. Il aime emmener les enfants par les sentiers serpentant au milieu de la garrigue et conduisant au grand chêne. Là, les enfants courent, sautent, grimpent dans les arbres, pataugent dans l’eau du ruisseau, construisent des cabanes, tombent, s’écorchent coudes et genoux, se salissent et grandissent. L’émotion qui étreint cet homme à la toute fin de sa dernière journée de classe est vraiment bouleversante ! Quel bonheur d’accomplir avec passion, exigence, doute, curiosité, psychologie, tendresse et fermeté, un métier aussi magnifique ! Jean-Michel Burel est de ces maîtres qui marque à vie le parcours de ses élèves. Un de ces maîtres, la dernière génération de maîtres, qui aura ressenti toute la responsabilité liée à sa fonction et le respect que les villageois lui témoignaient. A son arrivée, il avait vingt-et-un an. Tout juste sorti de l’Ecole normale, il était un peu étonné de voir les anciens lever leur casquette pour le saluer.
 Je n’ai, malheureusement, pas eu la chance, comme tant d’autres, que ma route d’enfant-élève croise celle d’un de ces maîtres passionnés et capables d’emprunter des chemins de traverse, de rattraper l’esprit de l’enfant-ballon par la ficelle. J’ai connu les vexations, les coups de règle assénés sur le bout des doigts, le par cœur, bête et méchant, les questions restées sans réponse, la boule de colère, dans la gorge, montée du ventre, qui empêche de respirer et explosera en larmes plus tard, quand on ne risquera plus de se donner en spectacle. Mon meilleur souvenir à l’école primaire : être chargée de nettoyer l’aquarium contenant des poissons-chats ! Quel triste bilan quand on songe à ma joie d’entrer à l’école maternelle quand j’avais déjà appris à déchiffrer toutes mes lettres sur des cubes en plastique et présentais une vraie soif d’apprendre ! Je sais que nos enfants ont eu cette chance dans nos petites écoles de campagne et je garde pour ces maîtres qui ont jalonné leurs jeunes années une reconnaissance éternelle !
Je n’ai, malheureusement, pas eu la chance, comme tant d’autres, que ma route d’enfant-élève croise celle d’un de ces maîtres passionnés et capables d’emprunter des chemins de traverse, de rattraper l’esprit de l’enfant-ballon par la ficelle. J’ai connu les vexations, les coups de règle assénés sur le bout des doigts, le par cœur, bête et méchant, les questions restées sans réponse, la boule de colère, dans la gorge, montée du ventre, qui empêche de respirer et explosera en larmes plus tard, quand on ne risquera plus de se donner en spectacle. Mon meilleur souvenir à l’école primaire : être chargée de nettoyer l’aquarium contenant des poissons-chats ! Quel triste bilan quand on songe à ma joie d’entrer à l’école maternelle quand j’avais déjà appris à déchiffrer toutes mes lettres sur des cubes en plastique et présentais une vraie soif d’apprendre ! Je sais que nos enfants ont eu cette chance dans nos petites écoles de campagne et je garde pour ces maîtres qui ont jalonné leurs jeunes années une reconnaissance éternelle !
C’est au lycée, enfin, que je m’épanouirai, comprise et stimulée par quelques rares professeurs. Si je n’ai pas eu « mon » maître d’école pour me mettre sur les rails et m’aider à me construire, j’ai eu la chance d’avoir « mon » professeur de français, « mon » professeur d’histoire et de géographie et « MON » professeur de philosophie. Josette, je sais que vous me lirez, alors je profite de la chance qui m’est donnée pour vous redire mon bonheur d’avoir été votre élève à l’âge de dix-sept ans, d’avoir pu entrer, grâce à vous, dans la philosophie, matière tellement ardue pour certains littéraires à l’esprit bohème, et de l’avoir aimée. De l’échec de l’entrée en classe de maternelle à la terminale, la route aura été longue et douloureuse mais, finalement, le plus important, c’est que la rencontre se fasse !
 N’ayant pas aimé l’école classique car elle ne m’aimait pas, je me suis vite intéressée à d’autres approches et c’est pourquoi j’ai suivi avec tant d’intérêt le documentaire diffusé par Arte. J’ai compris que cette pédagogie nouvelle avait pu émerger et se développer à la fois parce que certains de ses pionniers étaient des médecins, psychiatres ou neurologues qui avaient cherché à comprendre comment un enfant se construisait tant physiquement qu’intellectuellement et émotionnellement et parce que ces hommes et ces femmes étaient tous profondément pacifistes. Ces hommes et ces femmes ne voulaient plus que l’Ecole soit mise au service des intérêts d’une Nation, d’une Société, d’un Parti. Ils refusaient que les enfants soient formatés de façon à devenir de futurs bons soldats, des êtres soumis à l’obéissance de chefs les menant à la mort sur les champs de bataille. Les enfants ne seraient plus soumis aux brimades, aux humiliations et aux châtiments corporels. Les enfants devaient être respectés dans les étapes de leur développement, écoutés dans leurs émotions, suivis dans leurs désirs, fortifiés dans leur confiance, unis à leur corps et ancrés dans le monde réel. L’Ecole ne serait plus l’anti-chambre des tranchées. Elle serait vraiment une école de la vie, un espace d’apprentissage, de formation et de liberté.
N’ayant pas aimé l’école classique car elle ne m’aimait pas, je me suis vite intéressée à d’autres approches et c’est pourquoi j’ai suivi avec tant d’intérêt le documentaire diffusé par Arte. J’ai compris que cette pédagogie nouvelle avait pu émerger et se développer à la fois parce que certains de ses pionniers étaient des médecins, psychiatres ou neurologues qui avaient cherché à comprendre comment un enfant se construisait tant physiquement qu’intellectuellement et émotionnellement et parce que ces hommes et ces femmes étaient tous profondément pacifistes. Ces hommes et ces femmes ne voulaient plus que l’Ecole soit mise au service des intérêts d’une Nation, d’une Société, d’un Parti. Ils refusaient que les enfants soient formatés de façon à devenir de futurs bons soldats, des êtres soumis à l’obéissance de chefs les menant à la mort sur les champs de bataille. Les enfants ne seraient plus soumis aux brimades, aux humiliations et aux châtiments corporels. Les enfants devaient être respectés dans les étapes de leur développement, écoutés dans leurs émotions, suivis dans leurs désirs, fortifiés dans leur confiance, unis à leur corps et ancrés dans le monde réel. L’Ecole ne serait plus l’anti-chambre des tranchées. Elle serait vraiment une école de la vie, un espace d’apprentissage, de formation et de liberté.

Je sais bien que ces écoles ne sont pas adaptées à tous les enfants. Beaucoup d’enfants peuvent se sentir perdus quand on ne leur donne pas de consignes, qu’on les laisse évoluer librement et selon leurs propres désirs autour d’ateliers et réaliser en pleine autonomie des expériences dont ils tireront leurs propres enseignements. Une trop grande liberté ne rendrait-elle pas difficile l’insertion dans la vie professionnelle ? Cette question a longtemps été débattue. Tant pis si, plus tard, on peut avoir un peu de mal à se plier aux attentes d’un supérieur hiérarchique. La liberté est toujours gagnante !

Toutes ces méthodes de pédagogie nouvelle ou active avaient en commun de vouloir respecter les enfants et de ne pas les soumettre à l’autorité aveugle du maître. Ces approches sont très fatigantes pour ceux qui les mettent en œuvre. Il est plus facile de faire la classe à un troupeau de moutons qu’à un groupe d’enfants vifs, vivants et ACTIFS !
Tous ces pédagogues nouveaux étaient nés avant le vingtième siècle. L’héritage qu’ils laissent est fondamental et, à notre époque, il perdure et porte des esprits libres et des projets novateurs. C’est à Célestin Freinet que l’on doit le journal de classe, l’autocorrection, la bibliothèque de travail, les moyens audiovisuels, la photographie, l’imprimerie ou bien encore la coopérative scolaire. Même les esprits les plus brillants et novateurs commettent des erreurs et Célestin Freinet en commit une de taille avec l’élaboration de la méthode globale pour l’apprentissage de la lecture. Une catastrophe pour tant d’élèves ! Parmi les esprits qui se revendiquent de l’héritage des pionniers, on peut citer Céline Alvarez, institutrice, qui, pendant trois ans, dans une école maternelle d’Aubervilliers et en s’inspirant des travaux de Maria Montessori et des neurosciences a mené un travail remarquable. Elle a quitté l’Education Nationale et vient de publier un livre « Les lois naturelles de l’enfant » que je n’ai pas encore lu. Cette jeune femme, passionnée, semble agacer car elle bouscule l’Institution et lui administre la preuve que là où il y avait échec scolaire, on peut mettre les enfants en situation de réussite.
 Je voulais aussi parler de cette école fondée en Arles en septembre 2015 par Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, « Le domaine des possibles ». Une école inspirée de la méthode Steiner et portée par les éditeurs de la maison « Actes Sud », une école qui souhaite assurer le plein épanouissement de l’enfant. Elle est née sur la douleur de ce couple ayant vécu le suicide, à l’âge de dix-huit ans, de l’un de leurs enfants, un enfant dont l’intelligence aigue s’accompagnait d’une sensibilité à fleur de peau ayant fait de son parcours scolaire un enfer au quotidien. Ses parents ont souhaité offrir à des enfants en souffrance à l’école un lieu où tout serait à nouveau possible !
Je voulais aussi parler de cette école fondée en Arles en septembre 2015 par Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, « Le domaine des possibles ». Une école inspirée de la méthode Steiner et portée par les éditeurs de la maison « Actes Sud », une école qui souhaite assurer le plein épanouissement de l’enfant. Elle est née sur la douleur de ce couple ayant vécu le suicide, à l’âge de dix-huit ans, de l’un de leurs enfants, un enfant dont l’intelligence aigue s’accompagnait d’une sensibilité à fleur de peau ayant fait de son parcours scolaire un enfer au quotidien. Ses parents ont souhaité offrir à des enfants en souffrance à l’école un lieu où tout serait à nouveau possible !
Je laisse les derniers mots de cette chronique à Janusz Korczak et à Adophe Ferrière.
 « Vous dites :
« Vous dites :
-C’est épuisant de s’occuper des enfants.
Vous avez raison.
Vous ajoutez :
-Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser.
Là, vous vous trompez. Ce n’est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d’être obligé de nous élever jusqu’à la hauteur de leurs sentiments.
De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre.
Pour ne pas les blesser. » Janusz Korczak.
« L’adolescent aime la nature : on le parqua dans des salles closes. L’adolescent aime voir son activité servir à quelque chose : on fit en sorte qu’elle n’eut aucun but. Il aime bouger : on l’obligea à se tenir immobile. Il aime manier des objets : on le mit en contact avec des idées. Il aime se servir de ses main : on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parler : on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner : on le fit mémoriser. Il voudrait chercher la science : on la lui sert toute faite. Il voudrait s’enthousiasmer : on inventa les punitions. Alors les adolescents apprirent ce qu’ils n’auraient jamais appris sans cela. Ils surent dissimuler, ils surent tricher, ils surent mentir ». Adolphe Ferrière.
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner