 Dimanche, un peu avant 16 heures, nous retrouvions le plateau et sa barbe verte, notre maman et notre ainée, le chien et le chat. Comme toujours, au retour, ce sentiment que le trajet ne finirait jamais. La voiture avalait pourtant sagement le Morbihan, l’Ille et Villaine, la Mayenne, la Sarthe, l’Eure et Loire. La traversée de la Beauce était toujours redoutable et je me demandais comment on pouvait vivre dans un univers aussi hostile dont l’horizon était désormais barré par des éoliennes. Le Finistère, Penn-Ar-Bed en breton, porte bien son nom. C’est un authentique bout du monde comme l’est aussi Saint-Véran, dans le Queyras, plus haut village d’Europe. D’où me vient cet attrait pour les bouts du monde? De mes origines? Toute la famille de notre père appartient au sud du Finistère et du côté de notre mère, on compte un berceau à Ceillac, village situé dans les Hautes-Alpes. Il est possible que l’on découvre un jour que notre ADN transporte avec lui toute la mémoire de notre famille sur des siècles et des siècles. Si c’était le cas, cela pourrait alors expliquer pourquoi on peut avoir le sentiment d’être riche de vies non vécues, dépositaire d’autres histoires que la sienne, déjà fort d’une sagesse ancienne.
Dimanche, un peu avant 16 heures, nous retrouvions le plateau et sa barbe verte, notre maman et notre ainée, le chien et le chat. Comme toujours, au retour, ce sentiment que le trajet ne finirait jamais. La voiture avalait pourtant sagement le Morbihan, l’Ille et Villaine, la Mayenne, la Sarthe, l’Eure et Loire. La traversée de la Beauce était toujours redoutable et je me demandais comment on pouvait vivre dans un univers aussi hostile dont l’horizon était désormais barré par des éoliennes. Le Finistère, Penn-Ar-Bed en breton, porte bien son nom. C’est un authentique bout du monde comme l’est aussi Saint-Véran, dans le Queyras, plus haut village d’Europe. D’où me vient cet attrait pour les bouts du monde? De mes origines? Toute la famille de notre père appartient au sud du Finistère et du côté de notre mère, on compte un berceau à Ceillac, village situé dans les Hautes-Alpes. Il est possible que l’on découvre un jour que notre ADN transporte avec lui toute la mémoire de notre famille sur des siècles et des siècles. Si c’était le cas, cela pourrait alors expliquer pourquoi on peut avoir le sentiment d’être riche de vies non vécues, dépositaire d’autres histoires que la sienne, déjà fort d’une sagesse ancienne.
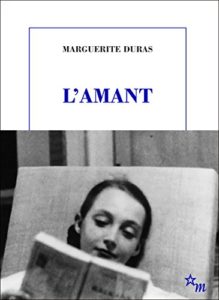 Dans l’Amant, Marguerite Duras écrit qu’à l’âge de 18 ans, son visage a vieilli brutalement. A 18 ans, je me sentais une maturité que certains n’atteindraient pas avant d’avoir trente ans. C’est difficile à expliquer mais c’était un sentiment profond. Je pense que ma forte empathie me faisait éprouver par anticipation de nombreux évènements. Je me suis éloignée de mon sujet: le Finistère. La nuit tombe doucement sur le plateau. Le jeune chien des voisins mis à l’attache pleure douloureusement. Il fait froid dans mon cabinet que je ne chauffe pas. Je réchauffe mes mains en les posant à plat sur le clavier de l’ordinateur. Les oiseaux qui nichent dans le lierre sont très actifs avant la tombée du soir.
Dans l’Amant, Marguerite Duras écrit qu’à l’âge de 18 ans, son visage a vieilli brutalement. A 18 ans, je me sentais une maturité que certains n’atteindraient pas avant d’avoir trente ans. C’est difficile à expliquer mais c’était un sentiment profond. Je pense que ma forte empathie me faisait éprouver par anticipation de nombreux évènements. Je me suis éloignée de mon sujet: le Finistère. La nuit tombe doucement sur le plateau. Le jeune chien des voisins mis à l’attache pleure douloureusement. Il fait froid dans mon cabinet que je ne chauffe pas. Je réchauffe mes mains en les posant à plat sur le clavier de l’ordinateur. Les oiseaux qui nichent dans le lierre sont très actifs avant la tombée du soir.
Voici une semaine, j’étais si heureuse d’avoir retrouvé le Finistère, celui que j’appelle parfois le Finispère. La dernière fois, c’était en 2020. Nous avions loué une maison dans la baie des Trépassés. Nous étions deux adultes pour cinq jeunes. J’avais trouvé plus austère le visage nord du Finistère. J’étais triste de constater à quel point l’association en charge des plus beaux sites naturels de France avait saccagé la pointe du Raz comme elle l’a fait aussi du pont du Gard. Le site avait perdu sa nature sauvage, mythologique. Il ne manquait plus qu’une piste d’hélicoptère pour dépose expresse!
 Depuis que je suis née, je vais dans le Finistère où vivait toute la famille de notre père. L’été, nous avions nos habitudes sur la grande plage de Mousterlin. Nous étions souvent accueillis par la tante Constance, petite soeur de notre grand-père vivant à Concarneau. J’ai encore des images précises de sa salle à manger et du canapé du salon dans lequel son mari suivait toutes les étapes du tour de France. Il avait été champion de Bretagne avant que la guerre ne l’envoie travailler en Allemagne et qu’il n’en revienne moralement brisé. La tante de notre père avait vu partir un homme fort, courageux, un entrepreneur dans l’âme. La guerre lui restituait une épave. Constance et Robert avaient eu une seule fille au regard aussi malicieux et vif que celui de sa mère. Notre père prétendait que sa grande cousine lui avait asséné un coup de poing qui avait eu pour effet de dévier sa cloison nasale. La tante Constance descendait au port acheter du poisson. Elle avait la démarche d’un général de la Légion, la coupe de cheveux qui allait avec et le teint halé des gens de mer. Elle cuisinait remarquablement bien. Comme toutes les Bretonnes, elle ne lésinait pas sur la quantité de beurre salé pour cuire le poisson. Elle avait bien connu Pierre-Jakez Hélias, le père du Cheval d’orgueil. Un livre à la veine anthropologique racontant le quotidien d’une famille pauvre de paysans bigoudens du village de Pouldreuzic peu après la Première Guerre mondiale. L’auteur met l’accent sur les codes très stricts qui rythmaient leur vie, notamment s’agissant de la pratique religieuse qui constituait le ciment de la société paysanne, malgré le développement des écoles communales « rouges » (républicaines) et de la langue française, lesquels s’accompagneront de bouleversements irréversibles. J’avais dévoré ce livre à l’adolescence.
Depuis que je suis née, je vais dans le Finistère où vivait toute la famille de notre père. L’été, nous avions nos habitudes sur la grande plage de Mousterlin. Nous étions souvent accueillis par la tante Constance, petite soeur de notre grand-père vivant à Concarneau. J’ai encore des images précises de sa salle à manger et du canapé du salon dans lequel son mari suivait toutes les étapes du tour de France. Il avait été champion de Bretagne avant que la guerre ne l’envoie travailler en Allemagne et qu’il n’en revienne moralement brisé. La tante de notre père avait vu partir un homme fort, courageux, un entrepreneur dans l’âme. La guerre lui restituait une épave. Constance et Robert avaient eu une seule fille au regard aussi malicieux et vif que celui de sa mère. Notre père prétendait que sa grande cousine lui avait asséné un coup de poing qui avait eu pour effet de dévier sa cloison nasale. La tante Constance descendait au port acheter du poisson. Elle avait la démarche d’un général de la Légion, la coupe de cheveux qui allait avec et le teint halé des gens de mer. Elle cuisinait remarquablement bien. Comme toutes les Bretonnes, elle ne lésinait pas sur la quantité de beurre salé pour cuire le poisson. Elle avait bien connu Pierre-Jakez Hélias, le père du Cheval d’orgueil. Un livre à la veine anthropologique racontant le quotidien d’une famille pauvre de paysans bigoudens du village de Pouldreuzic peu après la Première Guerre mondiale. L’auteur met l’accent sur les codes très stricts qui rythmaient leur vie, notamment s’agissant de la pratique religieuse qui constituait le ciment de la société paysanne, malgré le développement des écoles communales « rouges » (républicaines) et de la langue française, lesquels s’accompagneront de bouleversements irréversibles. J’avais dévoré ce livre à l’adolescence.
 La tante Constance me faisait un peu peur. Il se dégageait d’elle une autorité naturelle redoutable. Les épreuves de la vie s’étaient chargé de la durcir. Elle aurait été certainement différente si la guerre ne lui avait pas volé toutes les qualités de l’homme qu’elle avait épousé. Je préférais la soeur de notre grand-mère paternelle, Jeanne, qui était la marraine de notre père et que tout le monde appelait « Marraine ». Jeanne n’avait pas eu d’enfant et avait pour ses trois neveux, Pierre, Noël et Raymond, une infinie tendresse. Elle habitait une petite ferme. Comme la longère qui faisait également office d’étable pour les vaches prenait l’eau, elle avait fait construire une petite habitation de l’autre côté de la cour. Notre père avait vécu chez elle quelques mois quand il était malade. Il racontait qu’on lui faisait boire à jeun un verre de sang de boeuf pour l’aider à se fortifier. C’était un enfant maigre et rêveur avec un cerveau en ébullition constante. Il aimait beaucoup la ferme de sa marraine et entendre la pluie chanter sur les ardoises du toit. Il aimait se réfugier dans les arbres, manger des cerises ou des pommes cueillies sur les branches. La marraine avait un grand coeur. Je l’accompagnais tirer de l’eau de son puits. Elle avait une belle basse-cour et les canards de barbarie me faisaient peur avec leurs pustules rouges autour du bec. Elle devait avoir la main verte car sa pièce à vivre était remplie de plantes. Les coudes collaient sur la toile cirée. Quand nous venions lui rendre visite, elle demandait à sa voisine de nous rejoindre avec sa crêpière et elle nous préparait des crêpes délicieuses. C’est chez la marraine que j’ai vainement essayé de traire une vache. J’aimais voir tomber dans le seau le lait chaud et fumant. Elle se calait sur un trépied et tirait sur les pis avec vigueur. C’est ce qu’a fait Muguette deux fois par jour de 14 à 24 ans dans une grande ferme dans le Loiret. Elle glissait des chaussons dans ses sabots. Elle portait une robe d’intérieur et ses cheveux gris étaient toujours ramenés sur les côtés avec quelques épingles. Peu de mots sortaient de sa bouche. Je me demande si elle ne préférait pas s’exprimer en breton. Je regrette de n’avoir pas pu passer plus de temps avec elle quand j’étais jeune fille. Elle aurait pu me parler de sa soeur, de notre grand-mère. Les deux soeurs s’aimaient profondément.
La tante Constance me faisait un peu peur. Il se dégageait d’elle une autorité naturelle redoutable. Les épreuves de la vie s’étaient chargé de la durcir. Elle aurait été certainement différente si la guerre ne lui avait pas volé toutes les qualités de l’homme qu’elle avait épousé. Je préférais la soeur de notre grand-mère paternelle, Jeanne, qui était la marraine de notre père et que tout le monde appelait « Marraine ». Jeanne n’avait pas eu d’enfant et avait pour ses trois neveux, Pierre, Noël et Raymond, une infinie tendresse. Elle habitait une petite ferme. Comme la longère qui faisait également office d’étable pour les vaches prenait l’eau, elle avait fait construire une petite habitation de l’autre côté de la cour. Notre père avait vécu chez elle quelques mois quand il était malade. Il racontait qu’on lui faisait boire à jeun un verre de sang de boeuf pour l’aider à se fortifier. C’était un enfant maigre et rêveur avec un cerveau en ébullition constante. Il aimait beaucoup la ferme de sa marraine et entendre la pluie chanter sur les ardoises du toit. Il aimait se réfugier dans les arbres, manger des cerises ou des pommes cueillies sur les branches. La marraine avait un grand coeur. Je l’accompagnais tirer de l’eau de son puits. Elle avait une belle basse-cour et les canards de barbarie me faisaient peur avec leurs pustules rouges autour du bec. Elle devait avoir la main verte car sa pièce à vivre était remplie de plantes. Les coudes collaient sur la toile cirée. Quand nous venions lui rendre visite, elle demandait à sa voisine de nous rejoindre avec sa crêpière et elle nous préparait des crêpes délicieuses. C’est chez la marraine que j’ai vainement essayé de traire une vache. J’aimais voir tomber dans le seau le lait chaud et fumant. Elle se calait sur un trépied et tirait sur les pis avec vigueur. C’est ce qu’a fait Muguette deux fois par jour de 14 à 24 ans dans une grande ferme dans le Loiret. Elle glissait des chaussons dans ses sabots. Elle portait une robe d’intérieur et ses cheveux gris étaient toujours ramenés sur les côtés avec quelques épingles. Peu de mots sortaient de sa bouche. Je me demande si elle ne préférait pas s’exprimer en breton. Je regrette de n’avoir pas pu passer plus de temps avec elle quand j’étais jeune fille. Elle aurait pu me parler de sa soeur, de notre grand-mère. Les deux soeurs s’aimaient profondément.
 Quand la marraine est morte après qu’on ait précipité son entrée dans une maison de retraite et qu’elle soit devenue aphasique, sa pauvre succession a donné lieu à un drame familial digne d’un roman de Balzac ou plutôt d’un conte de Maupassant. Balzac ne se souciait pas des paysans bretons. Voici peu le terme de « paysan » était entendu comme une insulte. Maintenant, la jeune génération d’agriculteurs l’emploie fièrement. Dans paysan, il y a un joli mot « pays ». Autrefois, le paysan s’opposait au riche propriétaire terrien, à celui qu’on appelait un hobereau. Souvent, le paysan exploitait les terres du second. En Bretagne, durablement, les aristocrates propriétaires terriens voyaient les paysans comme des serfs. Quand notre arrière-grand-père, Noël Guillou, forgeron de son état, a ravi à Georges Nouët-Ruinet du Tailly la mairie de Clohars-Fouesnant, de 1919 à 1925, pour retrouver sa place il a menacé ses métayers de leur reprendre leurs terres s’ils continuaient à donner leurs chevaux à ferrer au nouveau maire. Remarquable à Clohars. Noël Guillou, en 1924, fait voter un budget de 824F pour une bibliothèque et l’achat de livres scientifiques et instructifs. La même année, il fait voter le « droit des pauvres » qui est une taxe sur les entrées dans les bals publics.
Quand la marraine est morte après qu’on ait précipité son entrée dans une maison de retraite et qu’elle soit devenue aphasique, sa pauvre succession a donné lieu à un drame familial digne d’un roman de Balzac ou plutôt d’un conte de Maupassant. Balzac ne se souciait pas des paysans bretons. Voici peu le terme de « paysan » était entendu comme une insulte. Maintenant, la jeune génération d’agriculteurs l’emploie fièrement. Dans paysan, il y a un joli mot « pays ». Autrefois, le paysan s’opposait au riche propriétaire terrien, à celui qu’on appelait un hobereau. Souvent, le paysan exploitait les terres du second. En Bretagne, durablement, les aristocrates propriétaires terriens voyaient les paysans comme des serfs. Quand notre arrière-grand-père, Noël Guillou, forgeron de son état, a ravi à Georges Nouët-Ruinet du Tailly la mairie de Clohars-Fouesnant, de 1919 à 1925, pour retrouver sa place il a menacé ses métayers de leur reprendre leurs terres s’ils continuaient à donner leurs chevaux à ferrer au nouveau maire. Remarquable à Clohars. Noël Guillou, en 1924, fait voter un budget de 824F pour une bibliothèque et l’achat de livres scientifiques et instructifs. La même année, il fait voter le « droit des pauvres » qui est une taxe sur les entrées dans les bals publics.
 Maintenant que presque tous les protagonistes de cette si triste histoire ont disparu, je ne saurai jamais vraiment ce qui s’est joué autour de la ferme de la marraine mais il est évident que toutes les tensions dissimulaient des rancoeurs anciennes et des jalousies tenaces. Inhabitées, squattées, dégradées, la longère et la maison étaient envahies par la végétation. C’est à peine si on voyait encore la cour et le puits. Un été à la demande de notre mère, ses deux gendres avaient loué des tronçonneuses et avaient péniblement dégagé un chemin entre les deux habitations. C’était vraiment la jungle! J’ai souhaité qu’on la mette en vente. Cela ne servait à rien de conserver indéfiniment un bien dont personne n’aurait plus jamais l’usage. Il aurait fallu investir des sommes colossales pour lui redonner vie et l’isoler du bruit des voitures de plus en plus nombreuses sur la route la bordant. Cette période n’a pas été facile. Par ailleurs, l’acquéreur, un ancien gendarme, s’est avéré être un personnage malhonnête oeuvrant de mèche avec le notaire. Jusqu’au bout, il aura fallu que ce soit compliqué et je ne fus pas épargnée. Avec le recul, je me félicite que la page ait été tournée sur ce pan de l’histoire familiale. Quand nous étions à Bénodet, je n’ai pas eu envie d’aller voir la maison. Presque toutes les personnes qui s’attachaient à elle sont mortes. Il ne reste plus que des terres agricoles exploitées par la même famille à titre gratuit depuis plusieurs décennies. Il reste aussi les lettres que notre père envoyait à son frère relatives à la propriété de leur tante et aux appétits qu’elle avait pu aiguiser. De son côté, notre mère a archivé les courriers qu’elle a échangés avec le frère ainé de sa mère au moment où nos parents ont exprimé le désir d’acquérir la maison du Gard. Ce n’est pas très joli! A la place de notre mère, je pense que j’aurais sectionné radicalement toute une branche de la famille maternelle. Comment pouvait-on se déchainer de la sorte sur une nièce dont le père n’était jamais revenu de déportation? C’est terrible comme les successions réveillent frustrations et de jalousies! Peu de familles sont épargnées!
Maintenant que presque tous les protagonistes de cette si triste histoire ont disparu, je ne saurai jamais vraiment ce qui s’est joué autour de la ferme de la marraine mais il est évident que toutes les tensions dissimulaient des rancoeurs anciennes et des jalousies tenaces. Inhabitées, squattées, dégradées, la longère et la maison étaient envahies par la végétation. C’est à peine si on voyait encore la cour et le puits. Un été à la demande de notre mère, ses deux gendres avaient loué des tronçonneuses et avaient péniblement dégagé un chemin entre les deux habitations. C’était vraiment la jungle! J’ai souhaité qu’on la mette en vente. Cela ne servait à rien de conserver indéfiniment un bien dont personne n’aurait plus jamais l’usage. Il aurait fallu investir des sommes colossales pour lui redonner vie et l’isoler du bruit des voitures de plus en plus nombreuses sur la route la bordant. Cette période n’a pas été facile. Par ailleurs, l’acquéreur, un ancien gendarme, s’est avéré être un personnage malhonnête oeuvrant de mèche avec le notaire. Jusqu’au bout, il aura fallu que ce soit compliqué et je ne fus pas épargnée. Avec le recul, je me félicite que la page ait été tournée sur ce pan de l’histoire familiale. Quand nous étions à Bénodet, je n’ai pas eu envie d’aller voir la maison. Presque toutes les personnes qui s’attachaient à elle sont mortes. Il ne reste plus que des terres agricoles exploitées par la même famille à titre gratuit depuis plusieurs décennies. Il reste aussi les lettres que notre père envoyait à son frère relatives à la propriété de leur tante et aux appétits qu’elle avait pu aiguiser. De son côté, notre mère a archivé les courriers qu’elle a échangés avec le frère ainé de sa mère au moment où nos parents ont exprimé le désir d’acquérir la maison du Gard. Ce n’est pas très joli! A la place de notre mère, je pense que j’aurais sectionné radicalement toute une branche de la famille maternelle. Comment pouvait-on se déchainer de la sorte sur une nièce dont le père n’était jamais revenu de déportation? C’est terrible comme les successions réveillent frustrations et de jalousies! Peu de familles sont épargnées!
 Revenir dans le Finistère, c’est se confronter à la mort et à une forme de vide. A Pleuven, je suis passée devant la jolie maison située sur le côté de l’église où vivaient notre grand-père et sa seconde femme. Phine ou Fine était tombée amoureuse de notre grand-père mais le sachant marié, elle n’y avait plus pensé. Elle tenait un café-épicerie à l’avant de la maison. Je me souviens de ma joie, enfant, d’apporter les cafés ou de jouer à la marchande. Une odeur spéciale flottait dans la pièce: un mélange de marc de café, de tabac froid et d’humidité. La soeur de Phine, Marie-Thérèse était employée au service d’une famille en qualité de gouvernante. La famille habitait le 7ème à Paris. Quand la famille n’a plus eu besoin d’elle, elle a rejoint sa soeur et est toujours restée en contact avec les enfants. Elles furent nombreuses les Bretonnes à quitter leur pays avec une valise et à débarquer à Montparnasse pour occuper des postes de gouvernantes. Marie-Thérèse ne s’est pas mariée et n’a pas eu d’enfant. Fine et Marie-Thérèse étaient toujours joyeuses. Elles avaient la foi chevillée au corps. A la fin de sa vie, notre mamie était si heureuse d’avoir obtenu de son mari qu’il dise ses prières avec elle le soir. Il venait d’une famille rouge mais son père, maire de son village, avait refusé après la crise violente provoquée par la séparation de l’Eglise et de l’Etat que la croix soit retirée sur le monument aux morts érigé après la Grande Guerre. Sa fille, bien plus tard, ferait enlever la croix sur la tombe de sa mère. Si Marie Kergoat ne croyait pas en Dieu, cette croix n’avait alors aucun sens. Par ailleurs, les convictions des vivants doivent s’effacer devant les volontés des défunts. Je me rappelle combien l’une de mes jeunes patientes avait été choquée d’assister à des scènes très violentes opposant ses grands-parents à la jeune compagne de son père après la mort subite de ce dernier et relatives à son enterrement. Cette jeune fille avait alors 13 ans. J’ai eu une patiente dont les deux parents avaient fait le choix de donner leur corps à la science. Leurs cendres avaient été répandues dans une partie du jardin jouxtant l’hôpital universitaire de Tours. Elle n’arrivait pas à entreprendre le chemin du deuil. Je lui avais suggéré de trouver un lieu lui rappelant ses deux parents. Elle a choisi des mimosas dans le Midi là où ses parents possédaient un pied à terre que la famille a conservé.
Revenir dans le Finistère, c’est se confronter à la mort et à une forme de vide. A Pleuven, je suis passée devant la jolie maison située sur le côté de l’église où vivaient notre grand-père et sa seconde femme. Phine ou Fine était tombée amoureuse de notre grand-père mais le sachant marié, elle n’y avait plus pensé. Elle tenait un café-épicerie à l’avant de la maison. Je me souviens de ma joie, enfant, d’apporter les cafés ou de jouer à la marchande. Une odeur spéciale flottait dans la pièce: un mélange de marc de café, de tabac froid et d’humidité. La soeur de Phine, Marie-Thérèse était employée au service d’une famille en qualité de gouvernante. La famille habitait le 7ème à Paris. Quand la famille n’a plus eu besoin d’elle, elle a rejoint sa soeur et est toujours restée en contact avec les enfants. Elles furent nombreuses les Bretonnes à quitter leur pays avec une valise et à débarquer à Montparnasse pour occuper des postes de gouvernantes. Marie-Thérèse ne s’est pas mariée et n’a pas eu d’enfant. Fine et Marie-Thérèse étaient toujours joyeuses. Elles avaient la foi chevillée au corps. A la fin de sa vie, notre mamie était si heureuse d’avoir obtenu de son mari qu’il dise ses prières avec elle le soir. Il venait d’une famille rouge mais son père, maire de son village, avait refusé après la crise violente provoquée par la séparation de l’Eglise et de l’Etat que la croix soit retirée sur le monument aux morts érigé après la Grande Guerre. Sa fille, bien plus tard, ferait enlever la croix sur la tombe de sa mère. Si Marie Kergoat ne croyait pas en Dieu, cette croix n’avait alors aucun sens. Par ailleurs, les convictions des vivants doivent s’effacer devant les volontés des défunts. Je me rappelle combien l’une de mes jeunes patientes avait été choquée d’assister à des scènes très violentes opposant ses grands-parents à la jeune compagne de son père après la mort subite de ce dernier et relatives à son enterrement. Cette jeune fille avait alors 13 ans. J’ai eu une patiente dont les deux parents avaient fait le choix de donner leur corps à la science. Leurs cendres avaient été répandues dans une partie du jardin jouxtant l’hôpital universitaire de Tours. Elle n’arrivait pas à entreprendre le chemin du deuil. Je lui avais suggéré de trouver un lieu lui rappelant ses deux parents. Elle a choisi des mimosas dans le Midi là où ses parents possédaient un pied à terre que la famille a conservé.
 Quand je reviens dans le Finistère, je suis heureuse et en même temps je ressens un manque. Je suis très attachée à cette terre, aux éléments, à la culture bretonne mais je n’ai pas de lieu à moi. Les maisons sont désormais habitées par des étrangers. Les tombes ne sont pour moi que des coquilles vides. Les âmes sont ailleurs. Nos défunts vivent en nous et leur éternité est liée à notre capacité à entretenir leurs souvenirs. Quand nous étions dans le Finistère, j’ai été très triste de comprendre que nos enfants ne savaient pas que leur grand-père et toute sa famille étaient bretonnes. Ils pensaient que nous venions ici seulement parce que j’aimais cette région. Pourtant, je parle régulièrement aux enfants de leur grand-père et de sa famille. J’essaie de les faire exister. J’ai été très triste pour notre père qui finalement n’existera jamais vraiment dans le coeur de ses petits-enfants. Ce n’est pas pour moi que j’ai eu du chagrin mais pour lui. Contrairement à eux j’ai grandi dans le manque de ma grand-mère paternelle et de mon grand-père maternelle. Ce manque était véhiculé par nos parents qui ne parlaient presque jamais d’eux. Notre père ne possédait rien hormis des livres. C’est sans doute pourquoi il prenait toujours le temps d’écrire une dédicace dans les livres qu’il offrait. Il n’était pas attaché à la maison du Gard, une maison sans jardin sans vue sans horizon. Une maison dont il ne s’appropriait que la cuisine et l’entrée en hiver quand nous faisions du feu dans la cheminée. Son coeur appartenait à la Bretagne. Plus il avançait en âge et plus je pense que la Bretagne lui manquait. Son frère et lui auraient-ils pu s’entendre pour restaurer la maison de leur tante?
Quand je reviens dans le Finistère, je suis heureuse et en même temps je ressens un manque. Je suis très attachée à cette terre, aux éléments, à la culture bretonne mais je n’ai pas de lieu à moi. Les maisons sont désormais habitées par des étrangers. Les tombes ne sont pour moi que des coquilles vides. Les âmes sont ailleurs. Nos défunts vivent en nous et leur éternité est liée à notre capacité à entretenir leurs souvenirs. Quand nous étions dans le Finistère, j’ai été très triste de comprendre que nos enfants ne savaient pas que leur grand-père et toute sa famille étaient bretonnes. Ils pensaient que nous venions ici seulement parce que j’aimais cette région. Pourtant, je parle régulièrement aux enfants de leur grand-père et de sa famille. J’essaie de les faire exister. J’ai été très triste pour notre père qui finalement n’existera jamais vraiment dans le coeur de ses petits-enfants. Ce n’est pas pour moi que j’ai eu du chagrin mais pour lui. Contrairement à eux j’ai grandi dans le manque de ma grand-mère paternelle et de mon grand-père maternelle. Ce manque était véhiculé par nos parents qui ne parlaient presque jamais d’eux. Notre père ne possédait rien hormis des livres. C’est sans doute pourquoi il prenait toujours le temps d’écrire une dédicace dans les livres qu’il offrait. Il n’était pas attaché à la maison du Gard, une maison sans jardin sans vue sans horizon. Une maison dont il ne s’appropriait que la cuisine et l’entrée en hiver quand nous faisions du feu dans la cheminée. Son coeur appartenait à la Bretagne. Plus il avançait en âge et plus je pense que la Bretagne lui manquait. Son frère et lui auraient-ils pu s’entendre pour restaurer la maison de leur tante?
 La maison que Stéphane avait trouvé se situait presqu’à la sortie de Bénodet, non loin d’un lieu appelé Letty où se situe la mer blanche. La mer blanche est un endroit qui se remplit et se vide à la faveur des marées. Il est ouvert sur l’océan. La grande bande de sable rejoint la plage de Mousterlin qui s’étend sur des kilomètres. Tous les matins, je me réveillais bien avant que le ciel s’éclaire. Je quittais la maison et marchais jusqu’à la mer. Souvent, j’étais seule sur la plage. Je restais de longs moments à voir le soleil grimper et à contempler l’océan. Des kitesurfeurs dansaient au-dessus des vagues. Des groupes de cormorans, ailes déployées, faisaient sécher leur ventre au soleil ou au vent. Tous les matins, je me ressourçais auprès des éléments dont je tirais à la fois force et calme. Cela peut dérouter les natures paisibles ou méditerranéennes mais l’océan tempétueux, la vision des rochers assaillis par des vagues furieuses et le vent contre lequel il faut lutter pour marcher sont porteurs d’une énergie puissante et d’un apaisement profond. Les natures volcaniques ressentent ce besoin d’affronter les éléments puissants et d’y trouver des limites aux excès dont elles se savent capables.
La maison que Stéphane avait trouvé se situait presqu’à la sortie de Bénodet, non loin d’un lieu appelé Letty où se situe la mer blanche. La mer blanche est un endroit qui se remplit et se vide à la faveur des marées. Il est ouvert sur l’océan. La grande bande de sable rejoint la plage de Mousterlin qui s’étend sur des kilomètres. Tous les matins, je me réveillais bien avant que le ciel s’éclaire. Je quittais la maison et marchais jusqu’à la mer. Souvent, j’étais seule sur la plage. Je restais de longs moments à voir le soleil grimper et à contempler l’océan. Des kitesurfeurs dansaient au-dessus des vagues. Des groupes de cormorans, ailes déployées, faisaient sécher leur ventre au soleil ou au vent. Tous les matins, je me ressourçais auprès des éléments dont je tirais à la fois force et calme. Cela peut dérouter les natures paisibles ou méditerranéennes mais l’océan tempétueux, la vision des rochers assaillis par des vagues furieuses et le vent contre lequel il faut lutter pour marcher sont porteurs d’une énergie puissante et d’un apaisement profond. Les natures volcaniques ressentent ce besoin d’affronter les éléments puissants et d’y trouver des limites aux excès dont elles se savent capables.
 Tous les matins, je prenais le temps d’observer un couple étonnant: un héron et une aigrette blanche se partageant un bassin. Je ramassais des pierres blanches et polies comme autant de talismans. Maintenant, elles sont dans mon cabinet. Nous avons été nous promener à Quimper où j’ai essayé d’imaginer sans succès la vie que notre oncle et notre père y avaient mené de leur naissance à leur départ pour leurs études supérieures. Tous les deux allaient exercer avec passion des métiers de service. L’un serait aux services de ses patients et le second au service de l’Etat et de ses usagers. A un moment, l’Algérie les réunirait. Le premier serait en poste à Oran et le second à Alger. Je n’ai jamais demandé à notre père quels souvenirs il avait conservés de son expérience algéroise. J’en sais plus sur la vie que notre oncle et sa femme ont mené à Oran avec leur berger allemand. Notre oncle réalisait des photos en noir et blanc magnifiques. Notre tante a tout ordonné dans des albums rangés dans des armoires. Ils constituent l’un de ses trésors si précieux qu’alors que leur maison était menacée par un incendie dans le massif de l’Estérel, elle a demandé à son mari de mettre les albums à l’abri de la cave.
Tous les matins, je prenais le temps d’observer un couple étonnant: un héron et une aigrette blanche se partageant un bassin. Je ramassais des pierres blanches et polies comme autant de talismans. Maintenant, elles sont dans mon cabinet. Nous avons été nous promener à Quimper où j’ai essayé d’imaginer sans succès la vie que notre oncle et notre père y avaient mené de leur naissance à leur départ pour leurs études supérieures. Tous les deux allaient exercer avec passion des métiers de service. L’un serait aux services de ses patients et le second au service de l’Etat et de ses usagers. A un moment, l’Algérie les réunirait. Le premier serait en poste à Oran et le second à Alger. Je n’ai jamais demandé à notre père quels souvenirs il avait conservés de son expérience algéroise. J’en sais plus sur la vie que notre oncle et sa femme ont mené à Oran avec leur berger allemand. Notre oncle réalisait des photos en noir et blanc magnifiques. Notre tante a tout ordonné dans des albums rangés dans des armoires. Ils constituent l’un de ses trésors si précieux qu’alors que leur maison était menacée par un incendie dans le massif de l’Estérel, elle a demandé à son mari de mettre les albums à l’abri de la cave.
 Avec Stéphane, le jour où Claudio s’installait sur la pointe bretonne, nous avons fait une grande sortie en vélo en suivant le GR 34 qui passe au milieu d’une forêt de chênes et de châtaigniers. Les forêts sont magnifiques en Bretagne et on y trouve assez facilement des cèpes. C’est Louis qui a déniché ceux dont nous nous sommes régalés un soir pour le dîner. Pédaler face au vent, se faire doucher par les vagues, cela m’a rappelé la côte ouest de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. C’est euphorisant de lutter contre le vent et de veiller à conserver son équilibre. Parfois, on roule très penché à gauche ou à droite. Nous sommes passés à plusieurs reprises devant l’hôtel qui appartenait à une cousine par alliance de notre grand-père et où Stéphane avait, en septembre 1998, organisé des fiançailles surprises. Depuis cette époque, l’hôtel a changé de propriétaire et de nom. Il se nomme désormais le Bateau Libre et la décoration, très chaleureuse, fait penser à celle de l’un de ces tiers-lieux parisiens comme la Recyclerie, porte de Clignancourt. Nous étions censés aller y boire un verre un soir avec les enfants mais tous les soirs, après le diner, nous manquions de courage pour ressortir.
Avec Stéphane, le jour où Claudio s’installait sur la pointe bretonne, nous avons fait une grande sortie en vélo en suivant le GR 34 qui passe au milieu d’une forêt de chênes et de châtaigniers. Les forêts sont magnifiques en Bretagne et on y trouve assez facilement des cèpes. C’est Louis qui a déniché ceux dont nous nous sommes régalés un soir pour le dîner. Pédaler face au vent, se faire doucher par les vagues, cela m’a rappelé la côte ouest de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. C’est euphorisant de lutter contre le vent et de veiller à conserver son équilibre. Parfois, on roule très penché à gauche ou à droite. Nous sommes passés à plusieurs reprises devant l’hôtel qui appartenait à une cousine par alliance de notre grand-père et où Stéphane avait, en septembre 1998, organisé des fiançailles surprises. Depuis cette époque, l’hôtel a changé de propriétaire et de nom. Il se nomme désormais le Bateau Libre et la décoration, très chaleureuse, fait penser à celle de l’un de ces tiers-lieux parisiens comme la Recyclerie, porte de Clignancourt. Nous étions censés aller y boire un verre un soir avec les enfants mais tous les soirs, après le diner, nous manquions de courage pour ressortir.
 Le vendredi, les enfants ont retrouvé le club de surf où ils ont leurs habitudes à la pointe de la Torche. J’aime l’ambiance très famille de cet endroit où règne un esprit libre et sain. En très peu de temps, Victoire et Louis étaient dans l’eau et nageaient en direction de belles vagues. Sur la plage, Stéphane prenait des photos. De mon côté, je m’abimais dans la contemplation d’un lieu magnifique dont les lumières changent tout au long de la journée. A un moment, un homme m’a souri. Je lui ai rendu son sourire et comme il continuait de me regarder, je lui ai demandé s’il avait un enfant dans l’eau. Il avait son fils de huit ans qui prenait un cours avec un moniteur. Nous nous sommes mis à échanger comme si nous nous connaissions depuis la maternelle et nous retrouvions après une longue période loin l’un de l’autre. Il m’a confié des pans très personnels de son existence. Un peu plus tard, il a pu bavarder avec Stéphane et j’ai fait la connaissance de sa femme et de leurs deux enfants. Ils regagnaient la Belgique le lendemain. Le jour où nous rentrions à la maison, je recevais un très gentil mail. Je ne doute pas que nous nous revoyions. Il a le projet de venir vivre dans le Finistère et d’y exercer son métier d’architecte d’intérieur. Sa femme, sculptrice, a fermé la porte de son atelier en entrant dans la maternité mais elle enseigne à l’université.
Le vendredi, les enfants ont retrouvé le club de surf où ils ont leurs habitudes à la pointe de la Torche. J’aime l’ambiance très famille de cet endroit où règne un esprit libre et sain. En très peu de temps, Victoire et Louis étaient dans l’eau et nageaient en direction de belles vagues. Sur la plage, Stéphane prenait des photos. De mon côté, je m’abimais dans la contemplation d’un lieu magnifique dont les lumières changent tout au long de la journée. A un moment, un homme m’a souri. Je lui ai rendu son sourire et comme il continuait de me regarder, je lui ai demandé s’il avait un enfant dans l’eau. Il avait son fils de huit ans qui prenait un cours avec un moniteur. Nous nous sommes mis à échanger comme si nous nous connaissions depuis la maternelle et nous retrouvions après une longue période loin l’un de l’autre. Il m’a confié des pans très personnels de son existence. Un peu plus tard, il a pu bavarder avec Stéphane et j’ai fait la connaissance de sa femme et de leurs deux enfants. Ils regagnaient la Belgique le lendemain. Le jour où nous rentrions à la maison, je recevais un très gentil mail. Je ne doute pas que nous nous revoyions. Il a le projet de venir vivre dans le Finistère et d’y exercer son métier d’architecte d’intérieur. Sa femme, sculptrice, a fermé la porte de son atelier en entrant dans la maternité mais elle enseigne à l’université.
 La veille, nous étions partis découvrir Landerneau et visiter la magnifique exposition que la fondation Hélène et Edouard Leclerc consacre à Ernest Pignon-Ernest. J’ai été soufflée par le talent de cet homme né en 1942 et ayant appris à dessiner tout seul après avoir découvert à l’âge de 12 ans des dessins de Picasso dans un numéro de Paris-Match. Ernest Pignon-Ernest traque les injustices, dénonce la violence de notre société, redonne leur place aux artistes maudits et rend hommage à des hommes courageux. L’artiste est d’une grande modestie dans son approche ayant fait le choix de déposer ses oeuvres à la vue de tous sur des supports fragiles les condamnant à l’éphémère. Ce sont donc des travaux préparatoires et des photos des oeuvres qui sont exposés dans l’ancienne abbaye. Le trait de l’artiste est à la fois puissant et universel. Si je connaissais son Rimbaud, je ne savais pas qu’il en était le père. On sent qu’Ernest Pignon-Ernest ne cherche pas la lumière. Je suis entrée d’autant plus facilement dans son univers qu’il y est entre autre question de Pablo Neruda, de Jean Genet, de Robert Desnos, de Pier Paolo Pasolini et de Victor Segalen.
La veille, nous étions partis découvrir Landerneau et visiter la magnifique exposition que la fondation Hélène et Edouard Leclerc consacre à Ernest Pignon-Ernest. J’ai été soufflée par le talent de cet homme né en 1942 et ayant appris à dessiner tout seul après avoir découvert à l’âge de 12 ans des dessins de Picasso dans un numéro de Paris-Match. Ernest Pignon-Ernest traque les injustices, dénonce la violence de notre société, redonne leur place aux artistes maudits et rend hommage à des hommes courageux. L’artiste est d’une grande modestie dans son approche ayant fait le choix de déposer ses oeuvres à la vue de tous sur des supports fragiles les condamnant à l’éphémère. Ce sont donc des travaux préparatoires et des photos des oeuvres qui sont exposés dans l’ancienne abbaye. Le trait de l’artiste est à la fois puissant et universel. Si je connaissais son Rimbaud, je ne savais pas qu’il en était le père. On sent qu’Ernest Pignon-Ernest ne cherche pas la lumière. Je suis entrée d’autant plus facilement dans son univers qu’il y est entre autre question de Pablo Neruda, de Jean Genet, de Robert Desnos, de Pier Paolo Pasolini et de Victor Segalen.
 Après Landerneau, nous avons roulé jusqu’à Morgat et avons marché à nouveau sur le GR 34 jusqu’à la crique de l’île Vierge malheureusement interdite d’accès. Une marche exigeante faite de montées et de descentes raides. Des points de vue superbes sur l’océan. L’odeur des pins. Louis a beaucoup râlé avant de reconnaitre que c’était chouette d’avoir entrepris cette randonnée. Plus d’une heure trente de route pour aller de Morgat à Bénodet. Dans les champs fraichement labourés une terre d’un bel ocre brun et des dizaines de mouettes se nourrissant de vers. Encore un déjeuner dans une crêperie à Sainte Marine de l’autre côté de l’Odet, un plat de langoustines et des coques, une étape au cimetière de Saint Evarzec où repose cette grand-mère morte un mois avant le mariage de nos parents et une partie des cendres de notre père. Alors que coupions le lierre et mettions des pieds de bruyère en terre, le ciel s’est ouvert laissant tomber des semaines de larmes. Nous étions trempés.
Après Landerneau, nous avons roulé jusqu’à Morgat et avons marché à nouveau sur le GR 34 jusqu’à la crique de l’île Vierge malheureusement interdite d’accès. Une marche exigeante faite de montées et de descentes raides. Des points de vue superbes sur l’océan. L’odeur des pins. Louis a beaucoup râlé avant de reconnaitre que c’était chouette d’avoir entrepris cette randonnée. Plus d’une heure trente de route pour aller de Morgat à Bénodet. Dans les champs fraichement labourés une terre d’un bel ocre brun et des dizaines de mouettes se nourrissant de vers. Encore un déjeuner dans une crêperie à Sainte Marine de l’autre côté de l’Odet, un plat de langoustines et des coques, une étape au cimetière de Saint Evarzec où repose cette grand-mère morte un mois avant le mariage de nos parents et une partie des cendres de notre père. Alors que coupions le lierre et mettions des pieds de bruyère en terre, le ciel s’est ouvert laissant tomber des semaines de larmes. Nous étions trempés.
 Toujours un peu triste de lire des dates de naissance et de mort si proches. Notre grand-mère est partie prématurément à l’âge de 53 ans sans doute épuisée par une vie de labeur auprès d’un homme qui ne la respectait pas et a si douloureusement fait souffrir les siens. Notre père s’est accroché quatre ans de plus mais il est parti un peu plus de deux mois avant que Stéphane et moi nous nous marions. Notre grand-mère est morte sans avoir jamais habité la maison qu’elle avait fait construire en face de la ferme de sa soeur. Elle n’aura pas connu ses trois petites-filles. Phine a épousé celui dont elle était tombée amoureuse de longues années avant. Elle n’aura pas connu la maternité mais elle nous aura aimées comme ses petites-filles et elle aura réussi à faire rentrer dans le rang un homme provocateur, se plaisant à insulter notre mère en breton et ayant durablement surtout aimé faire la noce avec ses copains. On a toujours dit que le père de notre grand-père dont il fut question au début de ce texte était un sage, un homme extraordinaire. Notre grand-père était son fils ainé et c’est pourquoi il portait le même prénom que son père. Quand ce dernier est mort sur une table d’opération à l’hôpital Saint-Louis à Paris, notre grand-père avait 15 ans. Sa mère s’est occupée d’un restaurant à Quimper et lui était aux fourneaux. Il a aidé sa mère à élever sa soeur et ses frères et a financé leurs études notamment celles de Joseph, futur vétérinaire. Ses frasques futures sont elles à mettre sur le dos d’un homme qui voulait rattraper des années d’insouciance volée? Je ne le saurai jamais mais il fut un gentil grand-père et j’ai conservé les très belles lettres qu’il nous écrivait car on ne s’appelait jamais. Quand ses doigts ont commencé à se recroqueviller et qu’une opération lui aurait rendu sa mobilité il l’a refusée. Je pense qu’il avait peur de rester sur la table comme son père avant lui.
Toujours un peu triste de lire des dates de naissance et de mort si proches. Notre grand-mère est partie prématurément à l’âge de 53 ans sans doute épuisée par une vie de labeur auprès d’un homme qui ne la respectait pas et a si douloureusement fait souffrir les siens. Notre père s’est accroché quatre ans de plus mais il est parti un peu plus de deux mois avant que Stéphane et moi nous nous marions. Notre grand-mère est morte sans avoir jamais habité la maison qu’elle avait fait construire en face de la ferme de sa soeur. Elle n’aura pas connu ses trois petites-filles. Phine a épousé celui dont elle était tombée amoureuse de longues années avant. Elle n’aura pas connu la maternité mais elle nous aura aimées comme ses petites-filles et elle aura réussi à faire rentrer dans le rang un homme provocateur, se plaisant à insulter notre mère en breton et ayant durablement surtout aimé faire la noce avec ses copains. On a toujours dit que le père de notre grand-père dont il fut question au début de ce texte était un sage, un homme extraordinaire. Notre grand-père était son fils ainé et c’est pourquoi il portait le même prénom que son père. Quand ce dernier est mort sur une table d’opération à l’hôpital Saint-Louis à Paris, notre grand-père avait 15 ans. Sa mère s’est occupée d’un restaurant à Quimper et lui était aux fourneaux. Il a aidé sa mère à élever sa soeur et ses frères et a financé leurs études notamment celles de Joseph, futur vétérinaire. Ses frasques futures sont elles à mettre sur le dos d’un homme qui voulait rattraper des années d’insouciance volée? Je ne le saurai jamais mais il fut un gentil grand-père et j’ai conservé les très belles lettres qu’il nous écrivait car on ne s’appelait jamais. Quand ses doigts ont commencé à se recroqueviller et qu’une opération lui aurait rendu sa mobilité il l’a refusée. Je pense qu’il avait peur de rester sur la table comme son père avant lui.
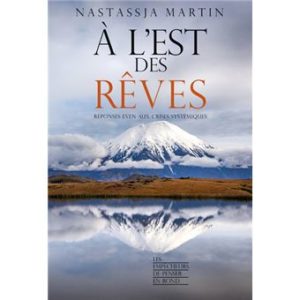 Ces quelques jours m’ont fait le plus grand bien. Je me suis vraiment ressourcée. C’est dans le Finistère et en montagne que je me repose le mieux et c’est à Paris que ma curiosité est nourrie. Mais je vis accrochée au dos souvent rugueux d’un plateau sur lequel je sais heureusement porter un regard tendre. J’ai vieilli d’une année le 27 octobre et chaque année qui passe m’éloigne de la possibilité de me sentir un jour quelque part vraiment chez moi. J’envie celles et ceux qui ont un vrai berceau, un endroit où ils ont grandi avec des repères stables et où ils savent pouvoir revenir. Je suis une âme errante. C’est peut-être pour cela que je me sens si fortement animiste. Aujourd’hui, c’est la pleine lune. On pouvait assister à une éclipse. C’est la lune du castor. En novembre, les castors se préparent au froid : ils construisent des barrages et font des réserves de nourriture dans leurs huttes. C’est peut-être pour cela que les Amérindiens ont nommé la pleine lune en leur honneur, en observant l’activité de ces animaux laborieux. Comme tous les peuples ayant vécu au plus près de la nature, les Amérindiens ne l’ont jamais dégradé. Je lis avec passion le livre que j’avais demandé à ma soeur de m’offrir et qui a été écrit par Nastassja Martin A l’Est des rêves. Elle y explique pourquoi et comment un collectif d’Evènes vivant au Kamtchatka a fait le choix de quitter un village pour renouer avec son mode de vie ancestrale dans la forêt.
Ces quelques jours m’ont fait le plus grand bien. Je me suis vraiment ressourcée. C’est dans le Finistère et en montagne que je me repose le mieux et c’est à Paris que ma curiosité est nourrie. Mais je vis accrochée au dos souvent rugueux d’un plateau sur lequel je sais heureusement porter un regard tendre. J’ai vieilli d’une année le 27 octobre et chaque année qui passe m’éloigne de la possibilité de me sentir un jour quelque part vraiment chez moi. J’envie celles et ceux qui ont un vrai berceau, un endroit où ils ont grandi avec des repères stables et où ils savent pouvoir revenir. Je suis une âme errante. C’est peut-être pour cela que je me sens si fortement animiste. Aujourd’hui, c’est la pleine lune. On pouvait assister à une éclipse. C’est la lune du castor. En novembre, les castors se préparent au froid : ils construisent des barrages et font des réserves de nourriture dans leurs huttes. C’est peut-être pour cela que les Amérindiens ont nommé la pleine lune en leur honneur, en observant l’activité de ces animaux laborieux. Comme tous les peuples ayant vécu au plus près de la nature, les Amérindiens ne l’ont jamais dégradé. Je lis avec passion le livre que j’avais demandé à ma soeur de m’offrir et qui a été écrit par Nastassja Martin A l’Est des rêves. Elle y explique pourquoi et comment un collectif d’Evènes vivant au Kamtchatka a fait le choix de quitter un village pour renouer avec son mode de vie ancestrale dans la forêt.
 Tout ce qui a trait à l’anthropologie, à l’animisme et au chamanisme à le vent en poupe. En étudiant la manière dont des collectifs ont toujours vécu en harmonie avec la nature les anthropologues proposent des pistes à explorer pour l’homme moderne désireux de sortir de cette spirale infernale de surconsommation menant la terre a sa perte. Maintenant que la religion chrétienne est en fin de course, on redécouvre ce qu’on avait voulu nous faire oublier: avant l’émergence des grandes religions monothéistes, nous avons tous été des païens animistes vivant non seulement en communion avec la nature environnante mais aussi avec le monde des esprits de la nature mais également des défunts.
Tout ce qui a trait à l’anthropologie, à l’animisme et au chamanisme à le vent en poupe. En étudiant la manière dont des collectifs ont toujours vécu en harmonie avec la nature les anthropologues proposent des pistes à explorer pour l’homme moderne désireux de sortir de cette spirale infernale de surconsommation menant la terre a sa perte. Maintenant que la religion chrétienne est en fin de course, on redécouvre ce qu’on avait voulu nous faire oublier: avant l’émergence des grandes religions monothéistes, nous avons tous été des païens animistes vivant non seulement en communion avec la nature environnante mais aussi avec le monde des esprits de la nature mais également des défunts.
 Il est possible que nous en ayons enfin fini avec le mythe de la suprématie de l’homme blanc et que tous les peuples asservis, bafoués ou acculturés retrouvent leur dignité et nous montrent la voie! Ce mouvement de retour à l’animisme va de pair avec la reconnaissance de plus en plus forte de la dignité des animaux. Si nous voulons mettre nos pas dans ceux de nos très lointains ancêtres ou prendre exemple sur les peuples qui ne tuent que pour survivre alors nous devons repenser notre manière de considérer les animaux que nous élevons pour qu’ils assouvissent nos besoins en nourriture. Ce n’est pas simple mais c’est possible et quand je vois à quel point le Finistère a été abimé par l’élevage intensif de malheureux porcs qu’on fait pousser à grand renfort d’hormones et qu’on expédie aux quatre coins de l’Europe dans des conditions monstrueuses, il y a vraiment urgence à agir!
Il est possible que nous en ayons enfin fini avec le mythe de la suprématie de l’homme blanc et que tous les peuples asservis, bafoués ou acculturés retrouvent leur dignité et nous montrent la voie! Ce mouvement de retour à l’animisme va de pair avec la reconnaissance de plus en plus forte de la dignité des animaux. Si nous voulons mettre nos pas dans ceux de nos très lointains ancêtres ou prendre exemple sur les peuples qui ne tuent que pour survivre alors nous devons repenser notre manière de considérer les animaux que nous élevons pour qu’ils assouvissent nos besoins en nourriture. Ce n’est pas simple mais c’est possible et quand je vois à quel point le Finistère a été abimé par l’élevage intensif de malheureux porcs qu’on fait pousser à grand renfort d’hormones et qu’on expédie aux quatre coins de l’Europe dans des conditions monstrueuses, il y a vraiment urgence à agir!
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Chère Anne-Lorraine,
Je découvre ce soir une belle et longue chronique qui m’a beaucoup émue. J’ai beaucoup appris sur ta famille….je crois que nous avons tous nos propres histoire familiales douloureuses et heureuses… Certains vivent aussi plus de complications que d’autres… Je sens beaucoup d’émotions dans ton écrit et des fêlures. Je me permets de te serrer très fort dans mes bras pour t’apporter de la force et de quoi te mettre un peu de baume au coeur.
Si ces vacances ont été propices à une plongée dans tes souvenirs, je vois que tu as aussi pu savourer de magnifiques moments au coeur de la nature. Le Finistère m’est inconnu mais ce que tu en dépeint me donne envie de m’y rendre un jour. Je regarderai rêveusement la mer et j’irai aux cèpes car j’adore les champignons… Je constate que même dans le Finistère on peut découvrir de jolis artistes. Paris n’a pas le monopole de la culture !
Enfin je suis étonnée par tes propos sur l’église chrétienne ..je te sais croyante et pratiquante…. Moi même élevée dans un courant catholique je n’ai pas la foi au sens de l’église mais je sais tout au fond de moi que je fais partie de forces puissantes et que nous sommes tous unis dans cette ronde… Reliés par la nature que j’aime profondément. C’est ce sentiment de lien qui me donne, je pense, ma sensibilité et mon empathie…pour en revenir à tes propos, penses tu que l’église chrétienne en soit à sa fin? Ce serait déroutant….
Je te souhaite un bon anniversaire en retard!
Amicalement
Alexandra
Chère Alexandra,
Je ne découvre qu’aujourd’hui ton si gentil message qui m’a beaucoup touchée. Je pense que tu aimerais le Finistère, une terre encore authentique mais qui risque de changer avec l’arrivée de non bretons fuyant les effets du dérèglement climatique. Je suis investie dans la paroisse depuis de longues années même si je ne vais que rarement à la messe. Si Stéphane avait été croyant, je pense que cela m’aurait plus motivée. Victoire m’accompagne parfois. Je n’aime pas l’institution et si je me sens vraiment proche de Jésus et de l’Esprit Saint, Dieu est très loin pour moi. Je ne sais pas si la religion catholique va disparaître mais les églises se vident et les gens cherchent des réponses ailleurs notamment du côté du chamanisme très en vogue depuis 10 ans. Jésus était un authentique écologiste et tant de saints à sa suite. Notre Céleste a commencé ce matin son stage. J’attends des nouvelles ce soir. Je te raconterai. Je t’embrasse avec affection,
Anne-Lorraine
Chère Anne Lorraine,
Tu sais que j’allais te répondre.
Nous n’étions qu’à 2 km l’une de l’autre.
La tante qu’on appelait Marie, Marraine ou cousine pour moi,Yvonne était son prénom à l’état civil.
Elle n’a pas été précipitée dans 1 maison de retraite. c’et son médecin qui l’a hospitalisée (ce n’était pas marrant pour Pierrot d’aller changer ses draps tous les jours et tu sais aussi bien que moi, il n’y avait ni chauffage ni eau , ni toilettes, l’électricité était défectueuse. Aucune infirmière ne voulait venir dans cette maison .
Quant à l’héritage, il n’y en a pas eu vu, que Marie avait fait un testament en faveur de Noël et de Raymond .A partir de ce moment là Pierrot n’a plus jamais remis les pieds à Menez Rohou et nous avons continué à fréquenter Françoise.
Il reste un terrain qui appartient à Nicolas .
Quand je relis toutes les lettres de Marie ,je ne vois que joie et bonheur dans cette ferme ,on était toujours bien accueillie ,un café même s’il y avait une mouche dedans .
Ce que je voulais te dire :Arrêtes de penser négatif , c’était 3 cousins comme 3 frères ,la vie les a séparer .
Tu aurais du venir me voir ,j’aurais invité ma soeur et mon frère ,ils aurait beaucoup de choses positive à te raconter
Je t’embrasse
Je n’ai jamais écrit qu’on avait pas été heureux dans cette ferme que notre père adorait. J’ai écrit que des gens s’étaient mené autour d’elle une guerre ridicule. Ce que je constate; c’est que des cousins qui s’aimaient vraiment ne se sont jamais réconciliés, que notre grand-mère n’a jamais habité sa maison et que la ferme est tombée en ruine. J’aurais aimé avoir un petit quelque chose dans cette Bretagne où je me sens si bien. Ce ne sera jamais le cas.