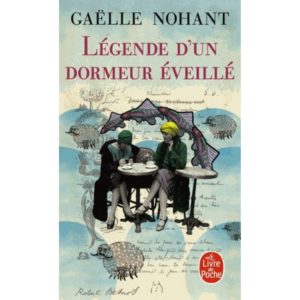 Hier soir, enfin, je suis venue à bout des 597 pages du magnifique roman de Gaëlle Nohant « Légende d’un dormeur éveillé » retraçant la vie de Robert Desnos. Pas facile de dégager du temps pour lire quand on a un cabinet de sophrologue en sabots, trois enfants, un berger australien chronophage, une grande maison à entretenir, de nombreux amis de passage, des études à surveiller de près, un mari qui aime à jouer l’Arlésien et pas de famille en soutien. Pas facile d’avancer, le soir, dans la lecture quand, depuis 5h30, on est sur le pont par vents et marées et que le soir venu, les yeux piquent et les paupières sont aussi lourdes que la devanture en fer d’une bijouterie.
Hier soir, enfin, je suis venue à bout des 597 pages du magnifique roman de Gaëlle Nohant « Légende d’un dormeur éveillé » retraçant la vie de Robert Desnos. Pas facile de dégager du temps pour lire quand on a un cabinet de sophrologue en sabots, trois enfants, un berger australien chronophage, une grande maison à entretenir, de nombreux amis de passage, des études à surveiller de près, un mari qui aime à jouer l’Arlésien et pas de famille en soutien. Pas facile d’avancer, le soir, dans la lecture quand, depuis 5h30, on est sur le pont par vents et marées et que le soir venu, les yeux piquent et les paupières sont aussi lourdes que la devanture en fer d’une bijouterie.
 Hier, tandis que Stéphane et Louis, notre benjamin, regardent une partie du « Facteur cheval », que Victoire s’amuse à se soumettre à un test de personnalité dont elle viendra bientôt, les cheveux mouillés et les pieds nus dans tes tongs jaunes, partager avec moi le résultat, que Céleste s’est couchée en omettant de mettre de l’ordre sur son bureau et le dessus de sa commode où les vêtements s’empilent à la manière d’un mille-feuilles gourmand, que Fantôme est lové sur les grands coussins rectangulaires glissés sous l’escalier, je suis déterminée à terminer mon roman. Dans tous les cas, je dois l’avoir rendu à la médiathèque samedi prochain. Impossible de le prolonger une seconde fois.
Hier, tandis que Stéphane et Louis, notre benjamin, regardent une partie du « Facteur cheval », que Victoire s’amuse à se soumettre à un test de personnalité dont elle viendra bientôt, les cheveux mouillés et les pieds nus dans tes tongs jaunes, partager avec moi le résultat, que Céleste s’est couchée en omettant de mettre de l’ordre sur son bureau et le dessus de sa commode où les vêtements s’empilent à la manière d’un mille-feuilles gourmand, que Fantôme est lové sur les grands coussins rectangulaires glissés sous l’escalier, je suis déterminée à terminer mon roman. Dans tous les cas, je dois l’avoir rendu à la médiathèque samedi prochain. Impossible de le prolonger une seconde fois.
 Enfant, nous avons tous appris au moins un poème de Robert Desnos ou, devenu parent, nous l’avons fait réciter à l’un de nos enfants. Celui que deux des trois nôtres ont appris est le suivant:
Enfant, nous avons tous appris au moins un poème de Robert Desnos ou, devenu parent, nous l’avons fait réciter à l’un de nos enfants. Celui que deux des trois nôtres ont appris est le suivant:
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi parlant français,
Parlant latin et javanais,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Eh ! Pourquoi pas ?
 Quand nos enfants me récitaient ce poème et que je voyais vraiment défiler devant mes yeux cet étonnant caravansérail mené par une fourmi polyglotte, je n’aurais jamais pu penser qu’en réalité, Robert Desnos parlait de ces wagons à bestiaux déportant dans la nuit et le brouillard des êtres nés aux quatre coins de l’Europe, cette Europe s’étendant de l’Atlantique à l’Oural.
Quand nos enfants me récitaient ce poème et que je voyais vraiment défiler devant mes yeux cet étonnant caravansérail mené par une fourmi polyglotte, je n’aurais jamais pu penser qu’en réalité, Robert Desnos parlait de ces wagons à bestiaux déportant dans la nuit et le brouillard des êtres nés aux quatre coins de l’Europe, cette Europe s’étendant de l’Atlantique à l’Oural.
 Robert Desnos aimait profondément les enfants. Il aimait leur raconter et leur écrire des histoires. Mort à 45 ans, le 8 juin 1945 à Terezin, dans les bras d’un étudiant tchèque nommé Joseph Stuna qui l’avait reconnu et l’a accompagné dans la maladie et l’agonie, il n’aura pas eu le temps de devenir père. Les cendres de Robert Desnos seront restituées à sa femme. Après la cérémonie, Joseph Stuna et Alena Tesarova viendront se présenter à Youki et elle les invitera rue Mazarine. Ils ont pu raconter à sa femme les derniers jours de la vie de son mari après que les Russes aient libéré le camp de Terezin. Robert Desnos souffrait de dysentrie et avait contracté le typhus. Les deux jeunes étudiants en médecine savaient que le poète était condamné. Lui, de son côté, demeurait, comme toujours, résolument optimiste et formait des projets pour son retour à Paris.
Robert Desnos aimait profondément les enfants. Il aimait leur raconter et leur écrire des histoires. Mort à 45 ans, le 8 juin 1945 à Terezin, dans les bras d’un étudiant tchèque nommé Joseph Stuna qui l’avait reconnu et l’a accompagné dans la maladie et l’agonie, il n’aura pas eu le temps de devenir père. Les cendres de Robert Desnos seront restituées à sa femme. Après la cérémonie, Joseph Stuna et Alena Tesarova viendront se présenter à Youki et elle les invitera rue Mazarine. Ils ont pu raconter à sa femme les derniers jours de la vie de son mari après que les Russes aient libéré le camp de Terezin. Robert Desnos souffrait de dysentrie et avait contracté le typhus. Les deux jeunes étudiants en médecine savaient que le poète était condamné. Lui, de son côté, demeurait, comme toujours, résolument optimiste et formait des projets pour son retour à Paris.
 Il voulait écrire sur tout ce qu’il avait traversé depuis son arrestation par la Gestapo, quand le mouvement de résistance Action immédiate dans lequel l’avait fait entrer son ami André Verdet avait été démantelé jusqu’à Terezin en passant par le camp de Royallieu, à Compiègne, l’horreur des conditions de vie, trois jours durant, dans le convoi du 27 avril à destination d’Auschwitz-Birkenau, les deux semaines qu’il y avait passées, l’envoi à Buchenwald, où, pour rester, sur sa feuille de renseignement, il fallait préciser qu’on exerçait un métier manuel, son refus de le faire pour ne pas dévier sa destinée, son départ pour le camp de Flossenbürg où l’usine Messerschmitt profitait de la main d’oeuvre des déportés, les passages à tabac et la marche forcée jusqu’à Terezin pour fuir l’arrivée de la 4e D.B américaine.
Il voulait écrire sur tout ce qu’il avait traversé depuis son arrestation par la Gestapo, quand le mouvement de résistance Action immédiate dans lequel l’avait fait entrer son ami André Verdet avait été démantelé jusqu’à Terezin en passant par le camp de Royallieu, à Compiègne, l’horreur des conditions de vie, trois jours durant, dans le convoi du 27 avril à destination d’Auschwitz-Birkenau, les deux semaines qu’il y avait passées, l’envoi à Buchenwald, où, pour rester, sur sa feuille de renseignement, il fallait préciser qu’on exerçait un métier manuel, son refus de le faire pour ne pas dévier sa destinée, son départ pour le camp de Flossenbürg où l’usine Messerschmitt profitait de la main d’oeuvre des déportés, les passages à tabac et la marche forcée jusqu’à Terezin pour fuir l’arrivée de la 4e D.B américaine.
 Tous les proches de Robert Desnos témoigneront de cet amour de la vie qui l’a animé jusqu’au bout et qu’il était capable d’insuffler aux autres dans les conditions les plus horribles. Ainsi, il lisait l’avenir dans les lignes de la main, inventait l’arrivée d’une belle femme pour obliger ses camarades à remettre de l’ordre dans leur chambrée et continuait inlassablement d’écrire sur des petits morceaux de papier de cigarette qu’il cachait dans une boite en fer.
Tous les proches de Robert Desnos témoigneront de cet amour de la vie qui l’a animé jusqu’au bout et qu’il était capable d’insuffler aux autres dans les conditions les plus horribles. Ainsi, il lisait l’avenir dans les lignes de la main, inventait l’arrivée d’une belle femme pour obliger ses camarades à remettre de l’ordre dans leur chambrée et continuait inlassablement d’écrire sur des petits morceaux de papier de cigarette qu’il cachait dans une boite en fer.
 A aucun moment dans les rares lettres qu’il a pu adresser à Youki, Robert Desnos ne parle de la faim qui le tenaille sans cesse, de la barbarie nazie ou du froid. Il se soucie toujours de la savoir, elle, en bonne santé et ne manquant de rien. Il lui fait part de ses projets d’écriture. Dans une lettre en date du 29 juillet 1944, il lui écrit: « J’aurais voulu t’offrir 100 000 cigarettes blondes, douze robes des grands couturiers, l’appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de Compiègne, celle de Belle-Isle et un petit bouquet à quatre sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard. Mais, avant toute chose, bois une bouteille de bon vin et pense à moi. »
A aucun moment dans les rares lettres qu’il a pu adresser à Youki, Robert Desnos ne parle de la faim qui le tenaille sans cesse, de la barbarie nazie ou du froid. Il se soucie toujours de la savoir, elle, en bonne santé et ne manquant de rien. Il lui fait part de ses projets d’écriture. Dans une lettre en date du 29 juillet 1944, il lui écrit: « J’aurais voulu t’offrir 100 000 cigarettes blondes, douze robes des grands couturiers, l’appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de Compiègne, celle de Belle-Isle et un petit bouquet à quatre sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard. Mais, avant toute chose, bois une bouteille de bon vin et pense à moi. »
 Alors que les déportés commencent à arriver en France, Youki va faire la connaissance d’un jeune homme qui avait rejoint le camp de Terezin en même temps que Robert Desnos. Il lui raconte comment, à Flöha, un adjudant avait puni les prisonniers en les gardant toute la nuit dans la cour à l’appel. Le jeune homme s’est alors rappelé qu’il avait 19 ans ce jour-là. Quand il s’est penché vers Desnos pour le lui dire, ce dernier lui a chuchoté: « C’est gentil de m’avoir invité à ton anniversaire! ». Le lendemain, Robert Desnos lui avait lu les lignes de la main. Il lui avait prédit qu’il aurait trois enfants, travaillerait en entreprise et galèrerait avant de faire fortune dans le dernier tiers de sa vie. Quand, pendant la marche à laquelle les SS les soumettait pour gagner le camp de Terezin, il n’avait eu de cesse de se raccrocher aux prédictions du poète et se répétait pour avancer qu’il ne pouvait pas mourir car il serait père de trois enfants.
Alors que les déportés commencent à arriver en France, Youki va faire la connaissance d’un jeune homme qui avait rejoint le camp de Terezin en même temps que Robert Desnos. Il lui raconte comment, à Flöha, un adjudant avait puni les prisonniers en les gardant toute la nuit dans la cour à l’appel. Le jeune homme s’est alors rappelé qu’il avait 19 ans ce jour-là. Quand il s’est penché vers Desnos pour le lui dire, ce dernier lui a chuchoté: « C’est gentil de m’avoir invité à ton anniversaire! ». Le lendemain, Robert Desnos lui avait lu les lignes de la main. Il lui avait prédit qu’il aurait trois enfants, travaillerait en entreprise et galèrerait avant de faire fortune dans le dernier tiers de sa vie. Quand, pendant la marche à laquelle les SS les soumettait pour gagner le camp de Terezin, il n’avait eu de cesse de se raccrocher aux prédictions du poète et se répétait pour avancer qu’il ne pouvait pas mourir car il serait père de trois enfants.
 Quand je finis le livre, mes yeux sont remplis de larmes. La vie de Robert Desnos a rouvert cette blessure familiale qui n’est la mienne que par ricochet: la mort de notre grand-père maternel à l’âge de 33 ans en avril 1944 exécuté au camp de Mauthausen. Après sa dernière évasion, il avait été remis par le directeur du camp de prisonniers de Lübeck à la Gestapo. C’est dans un wagon à bestiaux et les mains et les pieds pris dans des fers qu’il avait rejoint Mauthausen. Notre mère n’a jamais connu son père. Elle avait déjà sept ans quand on a cessé de lui parler de ce papa qui aurait dû revenir. Pendant de longs mois, le père de notre grand-mère montait dans le 84, près du parc Monceau et en descendait à Sèvres-Babylone pour aller consulter les listes de déportés rentrés affichés à l’hôtel Lutétia. Avec le beau-père de sa fille, magistrat, ils écrivaient des courriers au Ministère de la Guerre en Allemagne pour savoir ce qu’était devenu leur fils et gendre.
Quand je finis le livre, mes yeux sont remplis de larmes. La vie de Robert Desnos a rouvert cette blessure familiale qui n’est la mienne que par ricochet: la mort de notre grand-père maternel à l’âge de 33 ans en avril 1944 exécuté au camp de Mauthausen. Après sa dernière évasion, il avait été remis par le directeur du camp de prisonniers de Lübeck à la Gestapo. C’est dans un wagon à bestiaux et les mains et les pieds pris dans des fers qu’il avait rejoint Mauthausen. Notre mère n’a jamais connu son père. Elle avait déjà sept ans quand on a cessé de lui parler de ce papa qui aurait dû revenir. Pendant de longs mois, le père de notre grand-mère montait dans le 84, près du parc Monceau et en descendait à Sèvres-Babylone pour aller consulter les listes de déportés rentrés affichés à l’hôtel Lutétia. Avec le beau-père de sa fille, magistrat, ils écrivaient des courriers au Ministère de la Guerre en Allemagne pour savoir ce qu’était devenu leur fils et gendre.
 Les derniers chapitres du roman sont si tristes qu’ils pourraient faire oublier toute la gaieté et l’effervescence artistique du Paris de l’entre-deux guerres, le Paris des Années folles. Les artistes avaient déserté les ruelles escarpées de la butte Montmartre pour élire domicile autour de Montparnasse et de Saint-Germain-des-Prés. Ils se donnaient rendez-vous au Dôme, au Flore, à la Coupole ou encore aux Deux Magots. Si Robert Desnos avait assez vite claqué la porte du mouvement surréaliste qu’André Breton entendait diriger en despote absolu et pas forcément éclairé, il fréquentait tous les artistes de son époque: Cocteau, Neruda, Heredia, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, Prévert et Carpentier, Picasso et Foujita, Aragon et Eluard, Crevel et Artaud qu’il avait réussi à arracher à l’asile où il était si maltraité.
Les derniers chapitres du roman sont si tristes qu’ils pourraient faire oublier toute la gaieté et l’effervescence artistique du Paris de l’entre-deux guerres, le Paris des Années folles. Les artistes avaient déserté les ruelles escarpées de la butte Montmartre pour élire domicile autour de Montparnasse et de Saint-Germain-des-Prés. Ils se donnaient rendez-vous au Dôme, au Flore, à la Coupole ou encore aux Deux Magots. Si Robert Desnos avait assez vite claqué la porte du mouvement surréaliste qu’André Breton entendait diriger en despote absolu et pas forcément éclairé, il fréquentait tous les artistes de son époque: Cocteau, Neruda, Heredia, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, Prévert et Carpentier, Picasso et Foujita, Aragon et Eluard, Crevel et Artaud qu’il avait réussi à arracher à l’asile où il était si maltraité.
 Tout au long de sa vie, Robert Desnos va témoigner de cet amour pour la liberté. C’est ce qui le conduit à se détacher du groupe surréaliste dirigé par André Breton, s’engager dans la Résistance, cacher un jeune homme cherchant à fuir le STO, gifler publiquement le journaliste et écrivain Alain Laubreaux, surtout connu pour ses critiques de théâtre dans l’épouvantable « Je suis partout ».
Tout au long de sa vie, Robert Desnos va témoigner de cet amour pour la liberté. C’est ce qui le conduit à se détacher du groupe surréaliste dirigé par André Breton, s’engager dans la Résistance, cacher un jeune homme cherchant à fuir le STO, gifler publiquement le journaliste et écrivain Alain Laubreaux, surtout connu pour ses critiques de théâtre dans l’épouvantable « Je suis partout ».
 Dans le train qui les menait à Buchenwald, Robert Desnos avait confié à André Verdet avoir laissé une partie de lui à Auschwitz. Cette partie de lui correspondait à son enfance. C’est certainement à l’eau de cette enfance conservée qu’il puisait pour nourrir ses poésies et écrire des textes qui ont su toucher le coeur de plusieurs générations d’enfants. Je n’ai rien oublié de la poésie « Les hiboux » qui avait été transposée en chanson. Elle avait le mérite de nous faire retenir de manière ludique la règles des noms communs en « ou » qui, au pluriel, prenaient un « x ». C’est d’ailleurs l’une des seules règles en matière d’orthographe que j’ai apprise si facilement.
Dans le train qui les menait à Buchenwald, Robert Desnos avait confié à André Verdet avoir laissé une partie de lui à Auschwitz. Cette partie de lui correspondait à son enfance. C’est certainement à l’eau de cette enfance conservée qu’il puisait pour nourrir ses poésies et écrire des textes qui ont su toucher le coeur de plusieurs générations d’enfants. Je n’ai rien oublié de la poésie « Les hiboux » qui avait été transposée en chanson. Elle avait le mérite de nous faire retenir de manière ludique la règles des noms communs en « ou » qui, au pluriel, prenaient un « x ». C’est d’ailleurs l’une des seules règles en matière d’orthographe que j’ai apprise si facilement.
Ce sont les mères des hiboux
Qui désiraient chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.
Leurs yeux d’or valent des bijoux,
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux !
Votre histoire se passait où ?
Chez les Zoulous ? les Andalous ?
Ou dans la cabane Bambou ?
À Moscou ou à Tombouctou ?
En Anjou ou dans le Poitou ?
Au Pérou ou chez les Mandchous ?
Hou ! Hou !
Pas du tout c’était chez les fous.
 Victoire m’a aussi sollicitée -fait rarissime tant elle aime tout faire seule- pour des questions relatives au livre du psychanalyste Philippe Grimbert « Un secret ». Je l’avais lu quand notre aînée était également en troisième. Ce roman permet de faire comprendre aux élèves le sort des familles juives françaises pendant les années d’Occupation et le poids dramatique des secrets de famille sur le parcours de ceux qui n’y ont pas accès. Il y a deux ans la lecture de cette histoire m’avait profondément bouleversée.
Victoire m’a aussi sollicitée -fait rarissime tant elle aime tout faire seule- pour des questions relatives au livre du psychanalyste Philippe Grimbert « Un secret ». Je l’avais lu quand notre aînée était également en troisième. Ce roman permet de faire comprendre aux élèves le sort des familles juives françaises pendant les années d’Occupation et le poids dramatique des secrets de famille sur le parcours de ceux qui n’y ont pas accès. Il y a deux ans la lecture de cette histoire m’avait profondément bouleversée.
 Voici quinze jours, j’ai été contactée par un monsieur, professeur d’histoire en Moselle, qui avait été visiter le lycée Fabert de Metz à l’occasion des journées du patrimoine. Son fils y est actuellement élève en classe préparatoire. Il s’étonnait qu’une plaque ait été déposée dans l’établissement pour rendre hommage à notre grand-père qui y fut scolarisé avant de partir en maths sup à Louis-le-Grand. De la bouche du Proviseur, il avait appris que notre grand-mère maternel y avait vécu avec ses parents, sa soeur et ses deux frères. Leur père était Proviseur. Il serait ensuite nommé à Carnot et à Janson-de-Sailly. Sa première fille allait y rencontrer celui qui deviendrait son mari et le père de son unique fille. Après que j’aie échangé plusieurs mails avec ce monsieur, je me suis rendue compte que revenir à nouveau sur ce chapitre si douloureux de notre histoire familiale me faisait du mal. Dans mon dernier mail, je crois lui avoir écrit que ce que la famille de notre mère avait traversé avait été si dur que j’aurais préféré que notre grand-père ne risque pas sa vie dans des évasions dans le but de rejoindre les forces libres du Général de Gaulle et que notre mère ait un père. La vie est compliquée dans l’ombre de ceux que la mythologie familiale veut transformer en héros.
Voici quinze jours, j’ai été contactée par un monsieur, professeur d’histoire en Moselle, qui avait été visiter le lycée Fabert de Metz à l’occasion des journées du patrimoine. Son fils y est actuellement élève en classe préparatoire. Il s’étonnait qu’une plaque ait été déposée dans l’établissement pour rendre hommage à notre grand-père qui y fut scolarisé avant de partir en maths sup à Louis-le-Grand. De la bouche du Proviseur, il avait appris que notre grand-mère maternel y avait vécu avec ses parents, sa soeur et ses deux frères. Leur père était Proviseur. Il serait ensuite nommé à Carnot et à Janson-de-Sailly. Sa première fille allait y rencontrer celui qui deviendrait son mari et le père de son unique fille. Après que j’aie échangé plusieurs mails avec ce monsieur, je me suis rendue compte que revenir à nouveau sur ce chapitre si douloureux de notre histoire familiale me faisait du mal. Dans mon dernier mail, je crois lui avoir écrit que ce que la famille de notre mère avait traversé avait été si dur que j’aurais préféré que notre grand-père ne risque pas sa vie dans des évasions dans le but de rejoindre les forces libres du Général de Gaulle et que notre mère ait un père. La vie est compliquée dans l’ombre de ceux que la mythologie familiale veut transformer en héros.
J’avais dit à ce monsieur que je lui ferais parvenir un exemplaire du poème que j’avais écrit sur notre grand-père qui s’intitulait « Le choix de la liberté ». Je l’avais envoyé au frère aîné de notre grand-mère qui fut son meilleur ami. Il m’avait écrit que mon poème l’avait ému aux larmes et lui avait enfin permis, plus de cinquante ans après la mort de celui qu’il aimait comme un frère, de connaitre l’apaisement. J’ai essayé de retrouver mon poème mais mes premières recherches n’ont rien donné. Il va falloir que je procède à des fouilles plus approfondies!
 Dans un registre infiniment plus léger, Stéphane et moi sommes allés nous délecter des aventures de la famille Crowley et de leur fidèle personnel de maison avec le film « Downton Abbey ». Si, comme nous, vous avez suivi avec passion les six saisons de la série dont l’action commence le 15 avril 1912, jour du naufrage du Titanic, pour s’achever au 1er janvier de l’année 1926, vous serez ravis de ces retrouvailles avec des personnages hauts en couleur portés par des acteurs remarquables. Vous jubilerez à l’écoute des passes d’arme entre Lady Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham (fabuleuse Maggie Smith!) et Isabelle Grey. Vous vous régalerez devant le raffinement des intérieurs, la décoration des tables, les tenues portées par les femmes. Les dialogues sont toujours aussi subtils et les personnages travaillés avec beaucoup de psychologie. La scène du bal n’est pas sans rappeler une autre scène très célèbre: celle du « Guépard ». Si, en plus, vous avez la chance de voir le film en version original, vous pourrez alors exercer votre oreille aux différents accents des personnages: le queen’s english, le cockney, les accents gallois, écossais ou encore irlandais.
Dans un registre infiniment plus léger, Stéphane et moi sommes allés nous délecter des aventures de la famille Crowley et de leur fidèle personnel de maison avec le film « Downton Abbey ». Si, comme nous, vous avez suivi avec passion les six saisons de la série dont l’action commence le 15 avril 1912, jour du naufrage du Titanic, pour s’achever au 1er janvier de l’année 1926, vous serez ravis de ces retrouvailles avec des personnages hauts en couleur portés par des acteurs remarquables. Vous jubilerez à l’écoute des passes d’arme entre Lady Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham (fabuleuse Maggie Smith!) et Isabelle Grey. Vous vous régalerez devant le raffinement des intérieurs, la décoration des tables, les tenues portées par les femmes. Les dialogues sont toujours aussi subtils et les personnages travaillés avec beaucoup de psychologie. La scène du bal n’est pas sans rappeler une autre scène très célèbre: celle du « Guépard ». Si, en plus, vous avez la chance de voir le film en version original, vous pourrez alors exercer votre oreille aux différents accents des personnages: le queen’s english, le cockney, les accents gallois, écossais ou encore irlandais.
https://www.youtube.com/watch?v=EPVLbHWOgWs
 Hier soir, quand mes paupières sont tombées sur mes yeux comme les rideaux de velours rouge d’une scène de théâtre, j’avais bon espoir de bien dormir. Malheureusement, le roman de Gaëlle Nohant avait mis mon inconscient en ébullition. La nuit fut courte et chaotique. Je crois, simplement, que j’avais peur de prendre place dans le train du sommeil, un train conduit par une fourmi de dix-huit mètres parlant français, latin et javanais.
Hier soir, quand mes paupières sont tombées sur mes yeux comme les rideaux de velours rouge d’une scène de théâtre, j’avais bon espoir de bien dormir. Malheureusement, le roman de Gaëlle Nohant avait mis mon inconscient en ébullition. La nuit fut courte et chaotique. Je crois, simplement, que j’avais peur de prendre place dans le train du sommeil, un train conduit par une fourmi de dix-huit mètres parlant français, latin et javanais.
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Encore une belle chronique et une blessure qui ne s’est pas refermée pour beaucoup de familles
Merci d’avoir pris le temps de me lire et de m’écrire un petit mot.