 J’avais consacré une chronique à Simone Weil. J’aurais aimé avoir le temps de vous dire toute mon admiration pour Françoise Héritier dont je trouverai le dernier livre « au gré des jours » au pied du sapin et qui, j’en suis sûre, nous a donné les clés pour bâtir de nouvelles relations hommes/femmes. Je ne parlerai ni de Jean d’O ni de Johnny Hallyday. D’autres le font et le feront tellement mieux que moi. Je dirai juste qu’il aura fallu que les rides se fassent sillons profonds sur le visage éternellement hâlé de Jean d’Ormesson, comme pour mieux faire ressortir l’éclat de ses prunelles bleu provençal, pour que je commence à avoir de la tendresse pour lui. Avec le temps, il s’était libéré de sa quête de reconnaissance. S’il ne pouvait pas s’empêcher de rechercher le bon mot pour le plaisir de l’esprit, il avait appris à écouter les autres. La mère de l’une de mes amies avec laquelle j’avais partagé un appartement à Paris quand je commençais à enseigner à l’Université avait bien connu Jean d’O. Ils appartenaient au même petit monde. Comme tant d’autres femmes, elle lui vouait une admiration sans borne et, dans le secret de son coeur, l’aimait. Cette maman était frappée par une folie qui n’avait pas toujours été douce pour ses enfants. A chaque passage de son amoureux sur un plateau de Pivot, elle était certaine qu’il lui avait adressé des messages secrets. Ses messages la réchauffaient dans sa vie de longs couloirs froids. Ses messages lui redonnaient des ailes.
J’avais consacré une chronique à Simone Weil. J’aurais aimé avoir le temps de vous dire toute mon admiration pour Françoise Héritier dont je trouverai le dernier livre « au gré des jours » au pied du sapin et qui, j’en suis sûre, nous a donné les clés pour bâtir de nouvelles relations hommes/femmes. Je ne parlerai ni de Jean d’O ni de Johnny Hallyday. D’autres le font et le feront tellement mieux que moi. Je dirai juste qu’il aura fallu que les rides se fassent sillons profonds sur le visage éternellement hâlé de Jean d’Ormesson, comme pour mieux faire ressortir l’éclat de ses prunelles bleu provençal, pour que je commence à avoir de la tendresse pour lui. Avec le temps, il s’était libéré de sa quête de reconnaissance. S’il ne pouvait pas s’empêcher de rechercher le bon mot pour le plaisir de l’esprit, il avait appris à écouter les autres. La mère de l’une de mes amies avec laquelle j’avais partagé un appartement à Paris quand je commençais à enseigner à l’Université avait bien connu Jean d’O. Ils appartenaient au même petit monde. Comme tant d’autres femmes, elle lui vouait une admiration sans borne et, dans le secret de son coeur, l’aimait. Cette maman était frappée par une folie qui n’avait pas toujours été douce pour ses enfants. A chaque passage de son amoureux sur un plateau de Pivot, elle était certaine qu’il lui avait adressé des messages secrets. Ses messages la réchauffaient dans sa vie de longs couloirs froids. Ses messages lui redonnaient des ailes.
 J’ajouterai que j’ai beaucoup aimé cette belle série télévisée adaptée du roman « Au plaisir de Dieu », dans la même veine que « les gens de Mogador » ou « la famille Boussardel ». Jean d’Ormesson y racontait son enfance dans la propriété familiale, le château de Saint Fargeau, situé non loin d’ici, dans l’Yonne, une région baptisée la Puisaye, berceau de la grande Colette. Un été, sans les enfants partis dans le Gard, nous avons été nous y promener. Les propriétaires actuels de Saint Fargeau se donnent beaucoup de mal pour faire vivre les spectacles son et lumière et accueillir les enfants de colonies haut de gamme. L’intérieur du château ressemble à une succession de coquilles d’escargots, de celles qu’on trouve parfois dans les jardins à la fin de l’hiver, vides, remplies de terre. On a du mal à imaginer que la chapelle a pu y accueillir les membres vivants d’une vraie famille. Tout est si poussiéreux!
J’ajouterai que j’ai beaucoup aimé cette belle série télévisée adaptée du roman « Au plaisir de Dieu », dans la même veine que « les gens de Mogador » ou « la famille Boussardel ». Jean d’Ormesson y racontait son enfance dans la propriété familiale, le château de Saint Fargeau, situé non loin d’ici, dans l’Yonne, une région baptisée la Puisaye, berceau de la grande Colette. Un été, sans les enfants partis dans le Gard, nous avons été nous y promener. Les propriétaires actuels de Saint Fargeau se donnent beaucoup de mal pour faire vivre les spectacles son et lumière et accueillir les enfants de colonies haut de gamme. L’intérieur du château ressemble à une succession de coquilles d’escargots, de celles qu’on trouve parfois dans les jardins à la fin de l’hiver, vides, remplies de terre. On a du mal à imaginer que la chapelle a pu y accueillir les membres vivants d’une vraie famille. Tout est si poussiéreux!
 Quant à l’idole des jeunes, à celui qui a permis à chacun de savoir où se trouvait la ville de Tennessee, à l’ami de toujours de l’autre grand amoureux des Etats-Unis, Eddy Mitchell, il ne faisait pas partie de ma culture musicale. Il n’a marqué ni mon enfance ni mon adolescence ni ma vie d’adulte. Je n’ai jamais eu le sentiment qu’il était comme un oncle, un ami de la famille, que nous appartenions à la même tribu. Comme tout le monde, je connais presque par coeur certaines de ses chansons tant je les ai entendues passer sur les ondes. Je ne doute pas qu’il ait été un homme attachant et forcément intelligent pour avoir su se tailler une telle place dans le coeur des Français si longtemps.
Quant à l’idole des jeunes, à celui qui a permis à chacun de savoir où se trouvait la ville de Tennessee, à l’ami de toujours de l’autre grand amoureux des Etats-Unis, Eddy Mitchell, il ne faisait pas partie de ma culture musicale. Il n’a marqué ni mon enfance ni mon adolescence ni ma vie d’adulte. Je n’ai jamais eu le sentiment qu’il était comme un oncle, un ami de la famille, que nous appartenions à la même tribu. Comme tout le monde, je connais presque par coeur certaines de ses chansons tant je les ai entendues passer sur les ondes. Je ne doute pas qu’il ait été un homme attachant et forcément intelligent pour avoir su se tailler une telle place dans le coeur des Français si longtemps.
 J’imagine que la mort de Brel m’aurait infiniment plus touchée. J’allais avoir neuf ans quand l’ami de Jojo qui, six pieds sous terre frère encore, est parti rejoindre Gauguin dans le ciel des Marquises et, une fois pour toute, cesser de résister à l’appel de la lionne tapie dans la jungle humide et épaisse. Brel fait partie de mon histoire. Il est une des mosaïques qui compose ma culture. Je me tourne souvent vers lui pour mettre des mots sur une émotion. La plupart de ses chansons m’emportent dans une valse à mille temps, un grand voyage depuis le port d’Amsterdam, une escapade sous les ciels de Paris, un barbotage dans l’eau des ruisseaux. Je pleure à chaque fois que j’écoute « Orly » tant sa description de ce couple qui se quitte sans rien se promettre est poignante. Je chavire dès que j’entends « mon enfance ». Je souris avec « les bonbons ». Encore plus avec « les bonbons 67 ». Je déambule « sur les remparts de Varsovie ». Je revois nos enfants nourrissons « quand Isabelle dort ». La nuit, adolescente, j’ai souvent écouté pousser mes cheveux. J’ai beaucoup de tendresse pour les couples dépeints par le grand Jacques. Des couples tout en passion, déchirement, retrouvailles, portes qui claquent et, tristement, parfois aussi, dont les chambres demeurent sans berceau. Chez Brel dont mon père m’avait offert un livre rassemblant tous ses textes, un livre qui a doublé de volume tant les pages en ont été tournées, il y a l’être humain dans toutes ses qualités, ses défauts, son courage, ses lâchetés ordinaires, ses rêves, sa liberté, ses souffrances, ses silences, ses attachements à l’enfance.
J’imagine que la mort de Brel m’aurait infiniment plus touchée. J’allais avoir neuf ans quand l’ami de Jojo qui, six pieds sous terre frère encore, est parti rejoindre Gauguin dans le ciel des Marquises et, une fois pour toute, cesser de résister à l’appel de la lionne tapie dans la jungle humide et épaisse. Brel fait partie de mon histoire. Il est une des mosaïques qui compose ma culture. Je me tourne souvent vers lui pour mettre des mots sur une émotion. La plupart de ses chansons m’emportent dans une valse à mille temps, un grand voyage depuis le port d’Amsterdam, une escapade sous les ciels de Paris, un barbotage dans l’eau des ruisseaux. Je pleure à chaque fois que j’écoute « Orly » tant sa description de ce couple qui se quitte sans rien se promettre est poignante. Je chavire dès que j’entends « mon enfance ». Je souris avec « les bonbons ». Encore plus avec « les bonbons 67 ». Je déambule « sur les remparts de Varsovie ». Je revois nos enfants nourrissons « quand Isabelle dort ». La nuit, adolescente, j’ai souvent écouté pousser mes cheveux. J’ai beaucoup de tendresse pour les couples dépeints par le grand Jacques. Des couples tout en passion, déchirement, retrouvailles, portes qui claquent et, tristement, parfois aussi, dont les chambres demeurent sans berceau. Chez Brel dont mon père m’avait offert un livre rassemblant tous ses textes, un livre qui a doublé de volume tant les pages en ont été tournées, il y a l’être humain dans toutes ses qualités, ses défauts, son courage, ses lâchetés ordinaires, ses rêves, sa liberté, ses souffrances, ses silences, ses attachements à l’enfance.
 J’ai perdu mon père quelques mois avant d’avoir trente ans, quelques semaines avant de me marier et, par amour pour mon mari, j’ai accepté de renoncer à mon nom de famille. Je ne voulais pas changer mon nom. J’avais existé pendant presque trente ans avec ce nom que j’étais heureuse de porter même si, très honnêtement, je l’ai toujours trouvé dénué de poésie. J’avais enseigné et écrit sous ce nom. Ce nom que je n’avais pas choisi à ma naissance, j’avais commencé à lui donner mes couleurs, à lui composer des rimes, toute une symphonie intime. Par ailleurs, notre père et notre oncle n’ayant pas eu de fils, le nom allait mourir, se diluer dans la terre tellurique des cimetières du Finistère. Je me suis toujours révoltée contre cette tradition qui impose à la femme de renoncer à son nom pour prendre celui de la famille paternelle de son mari. Je réalise que ce passage n’a plus rien à voir avec Brel. Je ne sais pas trop comment j’ai glissé de l’oeuvre de Brel, de son univers à mon nom que je ne voulais pas sacrifier sur l’autel le jour du mariage. Peut-être est-ce la rencontre, dans mon esprit, entre Françoise Hériter, Brel et mon père. Comme aurait dit ma grand-mère maternelle « mystère et boule de gomme ».
J’ai perdu mon père quelques mois avant d’avoir trente ans, quelques semaines avant de me marier et, par amour pour mon mari, j’ai accepté de renoncer à mon nom de famille. Je ne voulais pas changer mon nom. J’avais existé pendant presque trente ans avec ce nom que j’étais heureuse de porter même si, très honnêtement, je l’ai toujours trouvé dénué de poésie. J’avais enseigné et écrit sous ce nom. Ce nom que je n’avais pas choisi à ma naissance, j’avais commencé à lui donner mes couleurs, à lui composer des rimes, toute une symphonie intime. Par ailleurs, notre père et notre oncle n’ayant pas eu de fils, le nom allait mourir, se diluer dans la terre tellurique des cimetières du Finistère. Je me suis toujours révoltée contre cette tradition qui impose à la femme de renoncer à son nom pour prendre celui de la famille paternelle de son mari. Je réalise que ce passage n’a plus rien à voir avec Brel. Je ne sais pas trop comment j’ai glissé de l’oeuvre de Brel, de son univers à mon nom que je ne voulais pas sacrifier sur l’autel le jour du mariage. Peut-être est-ce la rencontre, dans mon esprit, entre Françoise Hériter, Brel et mon père. Comme aurait dit ma grand-mère maternelle « mystère et boule de gomme ».
 Lundi, assise dans l’Intercité de 14h14, côté couloir, j’attendais que le train s’ébranle. S’achevait mon troisième et dernier court séjour à Paris de l’année 2017. Nous devions y retourner avec les enfants le week-end suivant mais l’état de fatigue dans lequel j’avais trouvé notre mère, le vendredi à son arrivée chez nous, m’amenait à reporter ce projet. Je savais que les enfants seraient très déçus. Je leur avais déjà « vendu » la magie de Noël à Paris mais je voulais surtout que ma mère ait le temps de s’occuper de sa santé et se sente mieux avant les fêtes. Comme à chaque fois, je m’interrogeais sur ma place, pourtant très confortable, dans ce train à l’ambiance feutrée. Pourquoi devais-je rentrer? Pourquoi ne restais-je pas à Paris? Pendant de très longues années, c’est la même question que je m’étais posée mais à l’envers quand, le dimanche soir venu, nos amis parisiens et ma famille repartaient. Pourquoi devais-je demeurer ici?
Lundi, assise dans l’Intercité de 14h14, côté couloir, j’attendais que le train s’ébranle. S’achevait mon troisième et dernier court séjour à Paris de l’année 2017. Nous devions y retourner avec les enfants le week-end suivant mais l’état de fatigue dans lequel j’avais trouvé notre mère, le vendredi à son arrivée chez nous, m’amenait à reporter ce projet. Je savais que les enfants seraient très déçus. Je leur avais déjà « vendu » la magie de Noël à Paris mais je voulais surtout que ma mère ait le temps de s’occuper de sa santé et se sente mieux avant les fêtes. Comme à chaque fois, je m’interrogeais sur ma place, pourtant très confortable, dans ce train à l’ambiance feutrée. Pourquoi devais-je rentrer? Pourquoi ne restais-je pas à Paris? Pendant de très longues années, c’est la même question que je m’étais posée mais à l’envers quand, le dimanche soir venu, nos amis parisiens et ma famille repartaient. Pourquoi devais-je demeurer ici?
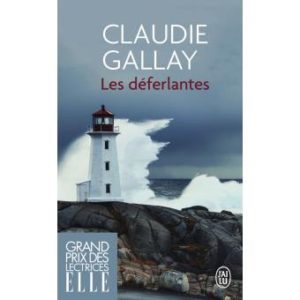 Dans l’Intercités de 14h14, un couple était installé devant moi. La femme tendait à son mari un sandwich qu’elle venait de sortir d’un morceau de papier d’argent. Sur ma gauche, une dame retraitée avait échangé un long moment avec sa soeur venue l’accompagner. Maintenant, la soeur avait quitté le wagon. Bientôt, elle ne serait plus qu’une tache de couleur sur le quai. La dame m’avait souri avant de se plonger dans la lecture d’un roman que j’avais adoré « les déferlantes » de Claudie Gallay. Ma belle-mère m’en avait fait cadeau pour mon trente-huitième anniversaire. Louis n’avait pas encore un an. Je l’avais lu dans la maison louée à Port-Blanc, dans le Morbihan, non loin de l’embarcadère pour l’île aux Moines. J’étais en Bretagne et cette histoire faisait monter en moi l’envie de partir à la découverte de la péninsule du Cotentin.
Dans l’Intercités de 14h14, un couple était installé devant moi. La femme tendait à son mari un sandwich qu’elle venait de sortir d’un morceau de papier d’argent. Sur ma gauche, une dame retraitée avait échangé un long moment avec sa soeur venue l’accompagner. Maintenant, la soeur avait quitté le wagon. Bientôt, elle ne serait plus qu’une tache de couleur sur le quai. La dame m’avait souri avant de se plonger dans la lecture d’un roman que j’avais adoré « les déferlantes » de Claudie Gallay. Ma belle-mère m’en avait fait cadeau pour mon trente-huitième anniversaire. Louis n’avait pas encore un an. Je l’avais lu dans la maison louée à Port-Blanc, dans le Morbihan, non loin de l’embarcadère pour l’île aux Moines. J’étais en Bretagne et cette histoire faisait monter en moi l’envie de partir à la découverte de la péninsule du Cotentin.
 Le train s’était mis en route. Un brouillard digne d’une enquête de Maigret enveloppait dans sa longue chevelure les arbres aux silhouettes dénudées. J’essayais de fermer les yeux. En vain! Mes paupières se refusaient à jouer les rideaux. Comme à chaque fois, j’étais triste de partir. Ces deux jours étaient passés trop vite. Samedi, j’avais été heureuse, enfin, de découvrir l’exposition du peintre Anders Zorn. Sans une patiente suédoise venue consulter la première fois à la fin du mois de septembre, je n’aurais jamais rien su de ce peintre. Grâce à elle, ma belle-mère, ma soeur et ma mère et quelques amis ont tous pu découvrir le génie d’aquarelliste de Zorn. Il n’avait pas été exposé à Paris depuis cent-onze ans. Nous étions nombreux à nous demander comment nous avions pu déjà traverser une bonne moitié de notre existence dans l’ignorance de cet artiste extraordinaire. On devine dans certaines toiles l’influence d’un Delacroix ou d’un Caillebotte. Je restais un long moment devant un tableau représentant un homme dans son bureau et celui de sa grand-mère faisant cuire des pommes de terre en pleine nature. Les aquarelles de Zorn sont incroyablement lumineuses, à la fois douces et puissantes.
Le train s’était mis en route. Un brouillard digne d’une enquête de Maigret enveloppait dans sa longue chevelure les arbres aux silhouettes dénudées. J’essayais de fermer les yeux. En vain! Mes paupières se refusaient à jouer les rideaux. Comme à chaque fois, j’étais triste de partir. Ces deux jours étaient passés trop vite. Samedi, j’avais été heureuse, enfin, de découvrir l’exposition du peintre Anders Zorn. Sans une patiente suédoise venue consulter la première fois à la fin du mois de septembre, je n’aurais jamais rien su de ce peintre. Grâce à elle, ma belle-mère, ma soeur et ma mère et quelques amis ont tous pu découvrir le génie d’aquarelliste de Zorn. Il n’avait pas été exposé à Paris depuis cent-onze ans. Nous étions nombreux à nous demander comment nous avions pu déjà traverser une bonne moitié de notre existence dans l’ignorance de cet artiste extraordinaire. On devine dans certaines toiles l’influence d’un Delacroix ou d’un Caillebotte. Je restais un long moment devant un tableau représentant un homme dans son bureau et celui de sa grand-mère faisant cuire des pommes de terre en pleine nature. Les aquarelles de Zorn sont incroyablement lumineuses, à la fois douces et puissantes.
 Aurélie, la marraine de Louis, était avec nous. Je peux me tromper mais je pense que nous n’avions pas visité une exposition ensemble depuis que le musée d’Orsay avait exposé la collection de la fondation Barnes à l’automne 1994. Aurélie m’avait offert l’affiche d’un tableau de Toulouse-Lautrec représentant une jeune femme à la chevelure rousse. Le visage à l’expression rebelle de ce modèle m’a suivi tout au long de mes pérégrinations. Après un déjeuner dans un restaurant italien bondé de la place du marché Saint Honoré, Stéphane rentrait à l’appartement de sa soeur et de son beau-frère et Aurélie et moi passions l’après-midi à aller d’une boutique à une autre entre Marais et Châtelet. Chez « Mariage frères », nous nous amusions à respirer toutes sortes de thé. Deux paquets partiraient pour Malmö, en Suède. La nuit était tombée depuis longtemps quand Aurélie et moi nous sommes séparées à hauteur de Châtelet. Nous étions heureuses toutes les deux de ce moment passé à flâner, à échanger nos souvenirs, à rire, à communier autour d’une amitié scellée dans les escaliers d’Assas un après-midi de passage d’oraux. Comme il est doux, parfois, de renouer avec une forme de légèreté!
Aurélie, la marraine de Louis, était avec nous. Je peux me tromper mais je pense que nous n’avions pas visité une exposition ensemble depuis que le musée d’Orsay avait exposé la collection de la fondation Barnes à l’automne 1994. Aurélie m’avait offert l’affiche d’un tableau de Toulouse-Lautrec représentant une jeune femme à la chevelure rousse. Le visage à l’expression rebelle de ce modèle m’a suivi tout au long de mes pérégrinations. Après un déjeuner dans un restaurant italien bondé de la place du marché Saint Honoré, Stéphane rentrait à l’appartement de sa soeur et de son beau-frère et Aurélie et moi passions l’après-midi à aller d’une boutique à une autre entre Marais et Châtelet. Chez « Mariage frères », nous nous amusions à respirer toutes sortes de thé. Deux paquets partiraient pour Malmö, en Suède. La nuit était tombée depuis longtemps quand Aurélie et moi nous sommes séparées à hauteur de Châtelet. Nous étions heureuses toutes les deux de ce moment passé à flâner, à échanger nos souvenirs, à rire, à communier autour d’une amitié scellée dans les escaliers d’Assas un après-midi de passage d’oraux. Comme il est doux, parfois, de renouer avec une forme de légèreté!
 Le dimanche matin, Stéphane avait rendez-vous avec son associé dans le dixième arrondissement et, avant que nous ne nous retrouvions tous avec ma soeur, notre beau-frère et leur adorable petite Charlotte au Petit Thaï, délicieux restaurant de la rue du roi de Sicile, je décidais de marcher jusqu’à la Monnaie de Paris et de visiter l’exposition « Women House ». Quand je suis arrivée, la Monnaie n’était pas encore ouverte. Une pluie fine mouillait les toits et les trottoirs. Nous étions déjà un petit groupe massé devant l’entrée. Cette exposition montre comment la maison peut être une prison pour la femme qui y vit et se retrouve esclave des taches domestiques.
Le dimanche matin, Stéphane avait rendez-vous avec son associé dans le dixième arrondissement et, avant que nous ne nous retrouvions tous avec ma soeur, notre beau-frère et leur adorable petite Charlotte au Petit Thaï, délicieux restaurant de la rue du roi de Sicile, je décidais de marcher jusqu’à la Monnaie de Paris et de visiter l’exposition « Women House ». Quand je suis arrivée, la Monnaie n’était pas encore ouverte. Une pluie fine mouillait les toits et les trottoirs. Nous étions déjà un petit groupe massé devant l’entrée. Cette exposition montre comment la maison peut être une prison pour la femme qui y vit et se retrouve esclave des taches domestiques.
 Comme ce travail me parlait! Comme cette vision d’une maison-prison résonnait en moi! Je découvrais des artistes dont je n’avais jamais entendu parler: l’Autrichienne Birgit Jürgenssen, les Américaines Cindy Sherman et Laurie Simmons, la Portugaise Helena Almeida, la Française Claude Cahun, la Danoise Kirsten Justesen, les Anglaise Penny Slinger et Rachel Whiteread et encore tant d’autres. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt le petit film dans lequel Niki de Saint Phalle raconte la naissance de ses « Nanas-Maisons » lesquelles à force de grandir deviennent architectures et dont les corps aux formes généreuses s’ouvrent pour laisser entrer les visiteurs. Les corps des Nanas se font alors refuge, rêve éveillé. Niki de Saint Phalle explique comment son compagnon, Jean Tinguely, Per Olof Ultvedt et elle ont accouché ensemble, à Stockholm, en quelques semaines, d’une énorme Nana, baptisée « Hon », « elle » en suédois. Cette attraction allait connaître un succès incroyable et on avait noté dans les mois qui suivirent une hausse des naissances significative en Suède.
Comme ce travail me parlait! Comme cette vision d’une maison-prison résonnait en moi! Je découvrais des artistes dont je n’avais jamais entendu parler: l’Autrichienne Birgit Jürgenssen, les Américaines Cindy Sherman et Laurie Simmons, la Portugaise Helena Almeida, la Française Claude Cahun, la Danoise Kirsten Justesen, les Anglaise Penny Slinger et Rachel Whiteread et encore tant d’autres. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt le petit film dans lequel Niki de Saint Phalle raconte la naissance de ses « Nanas-Maisons » lesquelles à force de grandir deviennent architectures et dont les corps aux formes généreuses s’ouvrent pour laisser entrer les visiteurs. Les corps des Nanas se font alors refuge, rêve éveillé. Niki de Saint Phalle explique comment son compagnon, Jean Tinguely, Per Olof Ultvedt et elle ont accouché ensemble, à Stockholm, en quelques semaines, d’une énorme Nana, baptisée « Hon », « elle » en suédois. Cette attraction allait connaître un succès incroyable et on avait noté dans les mois qui suivirent une hausse des naissances significative en Suède.
 Avant de sortir de l’exposition, j’échangeais avec la jeune femme, étudiante en histoire de l’art, qui s’occupait de la librairie. Elle m’expliquait que l’exposition était programmée depuis de longs mois, bien avant que les violences faites aux femmes ne deviennent le grand sujet de cette fin d’année. Je l’invitais à aller, au printemps, découvrir le Cyclop, caché au coeur de la forêt de Milly-la-Forêt. Louis qui, comme moi, adore Niki de Saint Phalle s’était passionné pour cette oeuvre monumentale construite sans permis de construire par un collectif d’artistes tous épris de liberté.
Avant de sortir de l’exposition, j’échangeais avec la jeune femme, étudiante en histoire de l’art, qui s’occupait de la librairie. Elle m’expliquait que l’exposition était programmée depuis de longs mois, bien avant que les violences faites aux femmes ne deviennent le grand sujet de cette fin d’année. Je l’invitais à aller, au printemps, découvrir le Cyclop, caché au coeur de la forêt de Milly-la-Forêt. Louis qui, comme moi, adore Niki de Saint Phalle s’était passionné pour cette oeuvre monumentale construite sans permis de construire par un collectif d’artistes tous épris de liberté.
 Avant de gagner la rue du roi de Sicile, je m’arrêtais dans une petite librairie que j’aime beaucoup, non loin de l’hôtel de Ville. J’y achetais un livre souvent cité pendant l’exposition « Women House » « une chambre à soi » de Virginia Woolf. Je ne l’avais jamais lu. La jeune femme, derrière la caisse, venait d’en achever la lecture. Je lui parlais de l’exposition de la Monnaie de Paris. Elle en notait le nom dans un petit carnet noir. J’ai, parmi mes patientes, des femmes qui souffrent de ne pas avoir dans leur maison un lieu qui soit le leur, un lieu qui ne soit pas envahi par les autres membres de la famille, une sorte de sanctuaire dans lequel on peut s’étaler à sa guise, entreposer ses objets, ses grigris, ses souvenirs. Je les aide à trouver des moyens pour réussir à avoir leur refuge, leur maison dans les arbres, leur grotte, leur espace vital.
Avant de gagner la rue du roi de Sicile, je m’arrêtais dans une petite librairie que j’aime beaucoup, non loin de l’hôtel de Ville. J’y achetais un livre souvent cité pendant l’exposition « Women House » « une chambre à soi » de Virginia Woolf. Je ne l’avais jamais lu. La jeune femme, derrière la caisse, venait d’en achever la lecture. Je lui parlais de l’exposition de la Monnaie de Paris. Elle en notait le nom dans un petit carnet noir. J’ai, parmi mes patientes, des femmes qui souffrent de ne pas avoir dans leur maison un lieu qui soit le leur, un lieu qui ne soit pas envahi par les autres membres de la famille, une sorte de sanctuaire dans lequel on peut s’étaler à sa guise, entreposer ses objets, ses grigris, ses souvenirs. Je les aide à trouver des moyens pour réussir à avoir leur refuge, leur maison dans les arbres, leur grotte, leur espace vital.
 J’étais arrivée la première au « Petit Thaï ». Virginie, Mathieu et Charlotte avaient fait leur apparition quelques minutes après. Quand Stéphane nous avait rejoints, il avait sur nous un verre de Chablis de retard. Nous étions bien dans le petit ventre chaleureux de ce restaurant que ma soeur m’a fait découvrir à leur retour des Etats-Unis. Charlotte était tout sourire. Ses parents la couvaient de leurs regards tendres. Margot était restée à la maison pour travailler. Valentin était à un marché de Noël avec l’un de ses amis. Après une promenade dans le Marais toujours si vivant le dimanche, nous nous étions quittés rue de Rivoli. La pluie tombait. En me retournant pour regarder ma soeur tenant Charlotte dans ses bras et son mari, j’avais senti toute la force de l’amour qui les unissait. Les années américaines les avaient rendus plus forts encore. Charlotte en était la preuve éclatante.
J’étais arrivée la première au « Petit Thaï ». Virginie, Mathieu et Charlotte avaient fait leur apparition quelques minutes après. Quand Stéphane nous avait rejoints, il avait sur nous un verre de Chablis de retard. Nous étions bien dans le petit ventre chaleureux de ce restaurant que ma soeur m’a fait découvrir à leur retour des Etats-Unis. Charlotte était tout sourire. Ses parents la couvaient de leurs regards tendres. Margot était restée à la maison pour travailler. Valentin était à un marché de Noël avec l’un de ses amis. Après une promenade dans le Marais toujours si vivant le dimanche, nous nous étions quittés rue de Rivoli. La pluie tombait. En me retournant pour regarder ma soeur tenant Charlotte dans ses bras et son mari, j’avais senti toute la force de l’amour qui les unissait. Les années américaines les avaient rendus plus forts encore. Charlotte en était la preuve éclatante.
 Notre petit week-end a pris fin avec le dernier film de Robert Guediguian, « la villa ». Nous ne nous attendions pas à ce qu’il y ait autant de monde devant le cinéma l’Escurial. Depuis « Marius et Jeannette », depuis vingt ans maintenant, Stéphane et moi restons fidèles à ce réalisateur, notre Ken Loach hexagonal mais un Ken Loach moins sombre, plus poétique. Nous aimons beaucoup les acteurs qui l’entourent depuis trente-sept ans et qui ont presque tous soixante-trois ans comme lui: Ariane Ascaride, sa femme, Jean-Pierre Daroussin et Gérard Meylan, les amis. Je ne m’attendais pas à ce que cette histoire nous rende si triste.
Notre petit week-end a pris fin avec le dernier film de Robert Guediguian, « la villa ». Nous ne nous attendions pas à ce qu’il y ait autant de monde devant le cinéma l’Escurial. Depuis « Marius et Jeannette », depuis vingt ans maintenant, Stéphane et moi restons fidèles à ce réalisateur, notre Ken Loach hexagonal mais un Ken Loach moins sombre, plus poétique. Nous aimons beaucoup les acteurs qui l’entourent depuis trente-sept ans et qui ont presque tous soixante-trois ans comme lui: Ariane Ascaride, sa femme, Jean-Pierre Daroussin et Gérard Meylan, les amis. Je ne m’attendais pas à ce que cette histoire nous rende si triste.
 Au creux de l’hiver, dans l’une des calanques de Marseille, une fratrie se reconstitue autour d’un père qui, après une attaque, ne communique plus avec son entourage. Le frère aîné n’est jamais parti. Il est resté auprès de ses parents. Il fait tourner le restaurant familial où on sert des plats simples et bon marché pour ceux qui ont des petits revenus. Le second frère traîne une dépression cyclique depuis qu’il a perdu son poste, un poste qui l’avait éloigné de ses origines et de sa foi communiste. A la suite d’un drame, la soeur, comédienne, n’était pas revenue depuis vingt ans. « La villa » est un film comme une pièce de théâtre. On ne quitte presque jamais la calanque et les petites maisons qui la bordent. Le temps semble figé. De plats de pâtes concoctés avec amour par le frère aîné en paquets de cigarettes partagés, les souvenirs remontent. La tendresse et la complicité renaissent. Les liens se resserrent autour de trois enfants syriens sauvés d’un naufrage. La famille fait bloc. Bien que le film, petit à petit, laisse revenir la joie, on en sort empli de nostalgie et de tristesse. Même si la fratrie se retrouve, tout le temps qui passe ne se rattrape guère, tout le temps perdu ne se rattrape plus comme le chantait Barbara. Dans une calanque à Marseille comme dans un vallon ardéchois, la fuite est un frein à l’accomplissement de soi. On ne se réalise que dans le dépassement.
Au creux de l’hiver, dans l’une des calanques de Marseille, une fratrie se reconstitue autour d’un père qui, après une attaque, ne communique plus avec son entourage. Le frère aîné n’est jamais parti. Il est resté auprès de ses parents. Il fait tourner le restaurant familial où on sert des plats simples et bon marché pour ceux qui ont des petits revenus. Le second frère traîne une dépression cyclique depuis qu’il a perdu son poste, un poste qui l’avait éloigné de ses origines et de sa foi communiste. A la suite d’un drame, la soeur, comédienne, n’était pas revenue depuis vingt ans. « La villa » est un film comme une pièce de théâtre. On ne quitte presque jamais la calanque et les petites maisons qui la bordent. Le temps semble figé. De plats de pâtes concoctés avec amour par le frère aîné en paquets de cigarettes partagés, les souvenirs remontent. La tendresse et la complicité renaissent. Les liens se resserrent autour de trois enfants syriens sauvés d’un naufrage. La famille fait bloc. Bien que le film, petit à petit, laisse revenir la joie, on en sort empli de nostalgie et de tristesse. Même si la fratrie se retrouve, tout le temps qui passe ne se rattrape guère, tout le temps perdu ne se rattrape plus comme le chantait Barbara. Dans une calanque à Marseille comme dans un vallon ardéchois, la fuite est un frein à l’accomplissement de soi. On ne se réalise que dans le dépassement.
 23h02, la maison sommeille. La pluie ruisselle sur le velux de mon Ar-Men. Pour que Louis s’endorme, j’ai laissé la télévision allumée et, tandis que j’écrivais, j’entendais la voix de Catherine Frot dans « les saveurs du palais ». Maintenant, c’est un « divan » consacré à Jean d’Ormesson qui est rediffusé. Déjà trois jours que je suis rentrée de Paris. Trois jours comme une éternité. Ici, sur le plateau souvent torturé par un vent violent que rien ne freine dans sa course folle, le temps n’est pas le même. Il est plus épais, plus dense. Une odeur de feu de cheminée flotte dans l’air. Avant d’aller me coucher et après avoir longuement caressé notre Fantôme, notre tendre berger australien qui a eu sept ans aujourd’hui, je me recueillerai quelques instants devant la crèche. Nous l’avons installée avec les enfants jeudi dernier. Comme tous les ans, ils étaient si heureux de sortir de leur boite en carton les petits santons, de les démailloter délicatement de leurs bandelettes faites dans des morceaux de papier absorbant et de les redécouvrir. Victoire s’étonnait, petite fille, d’avoir eu si peur du pauvre Michaud aux bras manquants. Comme tous les ans, la crèche s’enrichira de trois nouveaux santons offerts par ma mère à ses petits-enfants et qu’elle achète à la foire aux santons organisés depuis trente-sept ans par la ville de Sceaux. Quand les enfants quitteront la maison, ils emporteront leurs santons et, chacun, une paire de sabots et une paire de draps en lin brodés du trousseau de ma grand-mère maternelle. Pour les sabots, j’attends que leurs pieds aient atteint leur taille définitive.
23h02, la maison sommeille. La pluie ruisselle sur le velux de mon Ar-Men. Pour que Louis s’endorme, j’ai laissé la télévision allumée et, tandis que j’écrivais, j’entendais la voix de Catherine Frot dans « les saveurs du palais ». Maintenant, c’est un « divan » consacré à Jean d’Ormesson qui est rediffusé. Déjà trois jours que je suis rentrée de Paris. Trois jours comme une éternité. Ici, sur le plateau souvent torturé par un vent violent que rien ne freine dans sa course folle, le temps n’est pas le même. Il est plus épais, plus dense. Une odeur de feu de cheminée flotte dans l’air. Avant d’aller me coucher et après avoir longuement caressé notre Fantôme, notre tendre berger australien qui a eu sept ans aujourd’hui, je me recueillerai quelques instants devant la crèche. Nous l’avons installée avec les enfants jeudi dernier. Comme tous les ans, ils étaient si heureux de sortir de leur boite en carton les petits santons, de les démailloter délicatement de leurs bandelettes faites dans des morceaux de papier absorbant et de les redécouvrir. Victoire s’étonnait, petite fille, d’avoir eu si peur du pauvre Michaud aux bras manquants. Comme tous les ans, la crèche s’enrichira de trois nouveaux santons offerts par ma mère à ses petits-enfants et qu’elle achète à la foire aux santons organisés depuis trente-sept ans par la ville de Sceaux. Quand les enfants quitteront la maison, ils emporteront leurs santons et, chacun, une paire de sabots et une paire de draps en lin brodés du trousseau de ma grand-mère maternelle. Pour les sabots, j’attends que leurs pieds aient atteint leur taille définitive.
 Anne-Lorraine Guillou-Brunner
Anne-Lorraine Guillou-Brunner